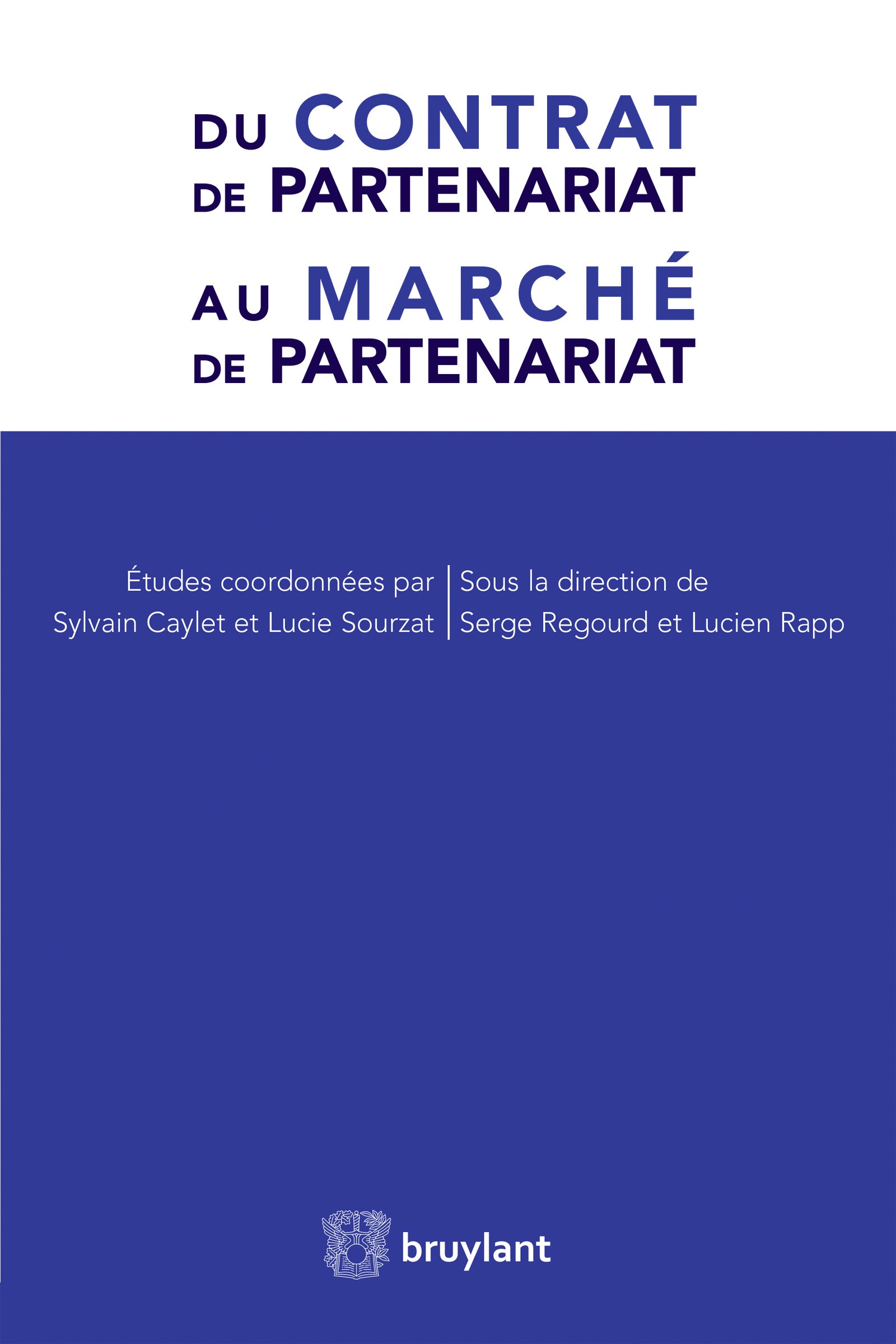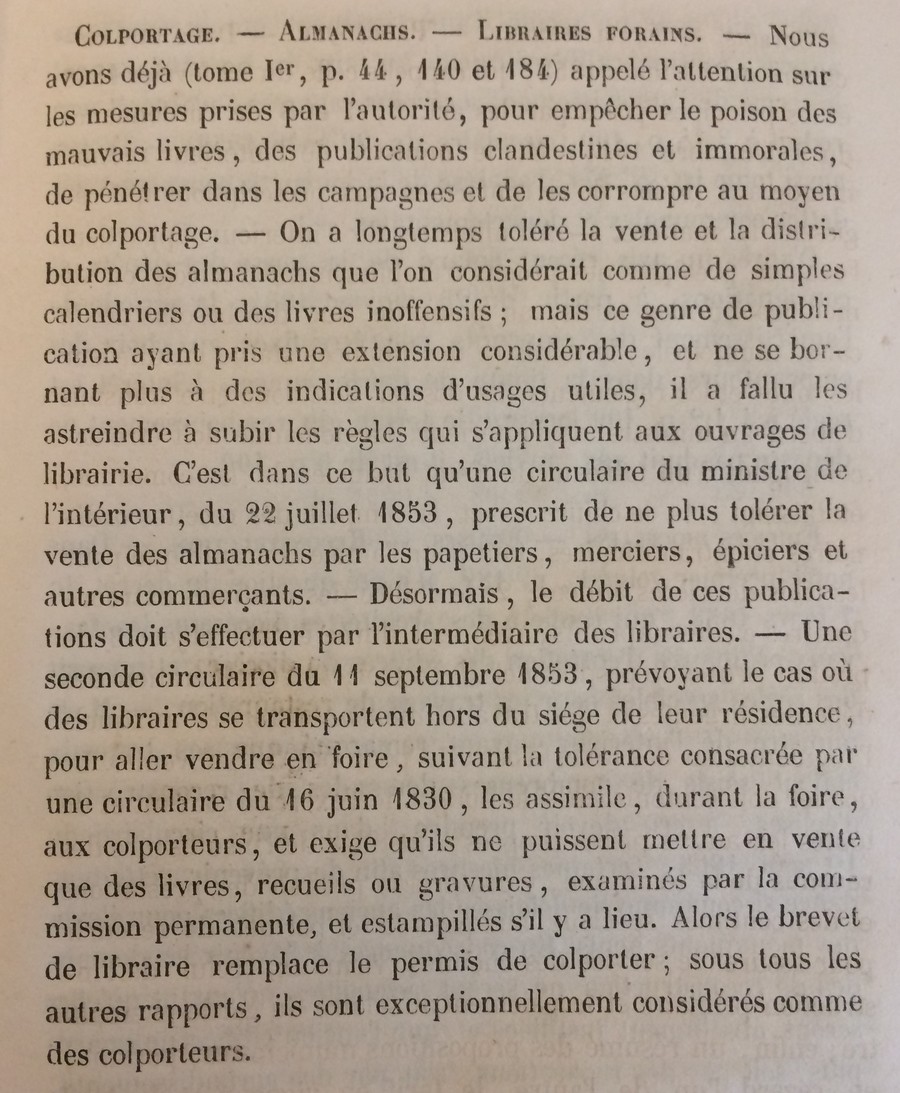Art. 59.
Un commentaire de la présente décision & de ses conclusions se trouve en ligne ici.
N°1203445 – Mme Nanette GLUSHAK
Audience du 21 janvier 2016
Lecture du 18 février 2016
Rapporteur : C. Kanté
Rapporteur public : D. Dubois

CONCLUSIONS
Née aux Etats-Unis en 1951, Mme Nanette Glushak, dont le prénom renvoie inévitablement à l’une des plus belles chansons de la comédie musicale américaine, Tea for two, a appris l’art de la danse à la prestigieuse School of American Ballet, fondée en janvier 1934 à New York par George Balanchine et Lincoln Kirstein. A l’âge de seize ans à peine, elle rejoint la troupe du New York City Ballet sur l’invitation de George Balanchine. En 1970, elle devient membre de l’American Ballet Theatre, autre compagnie new-yorkaise, plus ancienne, et non moins célèbre, où Mme Glushak est promue soliste en 1972. Elle danse les rôles principaux des plus grandes œuvres du répertoire : Le Lac des Cygnes, La Bayadère,[1] La Belle au bois dormant,[2] Don Quichotte[3], La Fille mal gardée,[4] Giselle,[5] Coppélia,[6] La Sylphide.[7]
A partir de 1983, elle co-dirige le Fort Worth Ballet, situé au Texas, et dirige également l’école attachée à cette compagnie, avec son époux, Michel Rahn, danseur issu de l’Opéra de Lyon.
Puis, à partir de 1987, Nanette Glushak remonte le répertoire de Balanchine, qui est décédé quatre ans plus tôt à New York, ainsi que le répertoire classique, et est invitée en tant que professeur dans de nombreuses compagnies étrangères, parmi lesquelles le Royal Ballet d’Angleterre, le Ballet du Deutsche Opera de Berlin, le Ballet de la Scala de Milan mais également des compagnies françaises, telles que le Ballet National de Marseille, le Ballet de l’Opéra de Lyon, et le Ballet du Grand Théâtre de Bordeaux.
En 1989, elle est engagée comme directrice artistique du Scottish Ballet à Glasgow, puis elle est recrutée par la commune de Toulouse comme directrice de la danse et chorégraphe du ballet du Théâtre du Capitole en septembre 1994, par le biais d’un contrat à durée déterminée régi par le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale. Notons au passage que son époux, M. Rahn, est alors également recruté comme maître de ballet.
Vous le savez, le ballet, au même titre que le théâtre et l’orchestre du Capitole sont directement gérés, en régie, par la ville de Toulouse, et leur activité constitue un service public administratif, ainsi que l’a jugé au moins deux fois le Tribunal des Conflits avant qu’il ne simplifie grandement la jurisprudence en la matière par l’arrêt Berkani (cf. à propos de deux danseuses du ballet : TC, 15 janvier 1979, Dames Le Cachey & Guiguère et autres c/ Ville de Toulouse, n°2106, en A sur ce point[8], ccl. Morisot ; TC, 22 novembre 1993, Martinucci c/ Ville de Toulouse, n°2879, en A sur ce point[9]).
Précisons toutefois, en passant, que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d’entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail (cf. TC, 6 juin 2011, Mme Bussière-Meyer c/ Communauté de l’agglomération belfortaine, n°3792, en A sur ce point[10] ; TC, 17 juin 2013, Mme Olteanu c/ Ville de Saint-Etienne, n°3910[11]).
Le contrat de Mme Glushak répondait quant à lui à un besoin permanent et a été régulièrement renouvelé, de sorte qu’il a été transformé en contrat à durée indéterminée, le 14 décembre 2005, avec effet rétroactif à la date du 27 juillet 2005, conformément à l’article 15-II de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Pour rappel, ces dispositions imposaient aux employeurs publics la transformation d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée lorsqu’au 1er juin 2004 ou au plus tard au terme du contrat en cours, soit le 31 août 2005 s’agissant de Mme Glushak, l’agent non-titulaire concerné était âgé d’au moins cinquante ans, était en fonction, justifiait d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années, et assuraient, notamment, des fonctions pour lesquelles il n’existe pas de cadres d’emploi de fonctionnaire.
Toutefois, lors de la séance du conseil municipal du 21 janvier 2011, le maire de Toulouse a annoncé la nomination de M. Kader Belarbi, ancien danseur étoile de l’Opéra de Paris, comme directeur de la danse du Théâtre du Capitole en remplacement de Mme Glushak. Un premier contrat ayant été signé le 12 janvier 2011, M. Belarbi a pris ses fonctions dès le 1er février 2011. Ce n’est qu’un an plus tard que le maire de Toulouse a convoqué Mme Glushak pour un entretien préalable à son licenciement, et l’a ensuite licenciée par décision du 13 février 2012.
Par la présente requête, Mme Glushak vous demande d’annuler cette décision et de condamner la commune de Toulouse à lui verser une indemnité de 180.000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moraux.
*****
L’administration peut toujours licencier un agent non-titulaire pour des motifs tirés de l’intérêt du service. C’est là la principale question posée par ce litige, d’autant plus délicate en l’espèce que les activités artistiques telles que celles qui peuvent être confiées à un directeur de la danse, chorégraphe, sont intimement liées, non pas à la personnalité, mais à la personne même, de celui qui occupe ces fonctions. La ville de Toulouse a recruté Mme Glushak, non seulement en raison de ses compétences techniques et pédagogiques dans le domaine de la danse, mais également, du moins peut-on légitimement le penser, en raison de sa notoriété et de son influence dans ce milieu artistique. Pour autant, le contrat de Mme Glushak n’était pas un emploi discrétionnaire, qui aurait permis à son employeur de la révoquer ad nutum, c’est-à-dire, rappelons l’étymologie, sur un signe de tête. La requérante n’était donc pas placée dans une situation comparable à celle des fonctionnaires territoriaux occupant des emplois de cabinet, ou encore des emplois fonctionnels, qui sont strictement et limitativement énumérés par les textes.
C’est pourquoi il nous paraît opportun de rappeler dans quels cas un employeur public peut se séparer d’un agent contractuel de droit commun, conformément à l’intérêt du service.
La première hypothèse qui vient immédiatement à l’esprit, mais qui ne correspond pas au cas qui nous occupe aujourd’hui, est celle de la suppression de l’emploi, notamment pour des raisons budgétaires (cf. par ex. pour la suppression de 15 postes de danseurs de l’opéra de Marseille : CE, 13 octobre 1997, Gardi, n°161957).
Le second motif de licenciement dans l’intérêt du service tient à la réorganisation de celui-ci. A titre d’exemple, le maire de Pantin avait pu licencier un professeur de musique du conservatoire municipal en raison de la réorientation des cours d’esthétique et de théâtre musical assurés par l’intéressé, compte tenu d’une réorganisation qui avait pour objet, d’une part, de permettre l’exécution d’œuvres musicales dans le cours d’esthétique en confiant ce cours à un professeur instrumentiste, et d’autre part, d’assurer la formation de chanteurs comédiens dans le cours de théâtre musical en confiant ce cours à un professionnel du théâtre. Le Conseil d’Etat, qui a noté qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier l’opportunité de cette réorganisation, a simplement constaté qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier, que l’agent concerné, qui n’était pas instrumentiste, ait possédé les qualifications désormais demandées par la commune (cf. CE, 17 janvier 1986, Tapie, n°52628).[12]
Troisième possibilité qui a fait l’objet d’un arrêt topique : l’employeur public peut mettre fin à la relation contractuelle en cas d’inadaptation de l’artiste aux besoins du service public culturel, sans que celui-ci n’ait connu de changement particulier d’organisation. Ainsi, à propos d’un danseur soliste à l’opéra de Lyon qui n’était plus choisi par les chorégraphes invités depuis quatre ans (au motif, justement, d’une prétendue incapacité à adopter une forme d’expression contemporaine de la danse)[13], danseur qui n’avait participé depuis trois ans qu’à une seule tournée en qualité de remplaçant au cours de laquelle il n’avait pas dansé et qui n’avait, depuis lors, été sélectionné pour aucune création, le Conseil d’Etat a jugé que ces faits ne caractérisaient pas une insuffisance professionnelle mais une inadaptation aux besoins du théâtre, pouvant le cas échéant justifier le non renouvellement du contrat à durée déterminée qui liait le danseur à l’opéra de Lyon lors de ses échéances (cf. CE, 29 juillet 1994, Ville de Lyon, n°133701, en B sur ce point).
Enfin, les motifs d’éviction peuvent résulter plus classiquement d’une faute disciplinaire ou d’une insuffisance professionnelle imputable à l’agent concerné. Il s’agit là de motifs qui, s’ils ne sont pas directement tirés de l’intérêt du service, ne lui sont pas, bien évidemment, étrangers, selon la formule de la jurisprudence (cf. CE, 13 mars 1968, Commune de Malaussène, n°68999, en A sur cette question[14] ; CE, 12 mars 1975, Ville de Pau, n°91151, en A sur ce point[15]).
*****
En l’espèce, la décision attaquée du 13 février 2012 est motivée par la circonstance que Mme Glushak n’aurait pas su s’adapter aux nouveaux objectifs fixés par le directeur artistique du théâtre du Capitole dans le cadre du changement de projet culturel de la ville de Toulouse depuis 2008, à savoir l’introduction d’une modernité dans le ballet du Capitole, impliquant une nouvelle direction artistique se traduisant par l’ouverture du répertoire à des chorégraphes contemporains, et par des partenariats avec l’environnement local dans le domaine de la danse, croisements des genres et des styles par le biais de cours publics, de performances, etc.
Puis, le maire de Toulouse a reproché à Mme Glushak de ne pas avoir souhaité engager sa troupe de ballet vers un répertoire autre que néoclassique, de s’être opposée à toutes les ouvertures du ballet sur l’environnement local, d’où une mauvaise implication des danseurs lors des différentes éditions de la manifestation « Osons danser » et de la lecture-démonstration avec l’association de danse hip-hop le CACDU.
Le maire reprochait également à la requérante une perte de notoriété du Ballet du Capitole, qui s’est traduite par une diminution des propositions de tournées nationales et internationales.
Enfin, le maire a estimé que le fait pour Mme Glushak de mener des missions régulières comme maîtresse de ballet auprès d’autres troupes en France et à l’étranger n’était pas compatible avec l’investissement requis par ses fonctions toulousaines.
*****
D’emblée, nous vous proposerons d’écarter ce motif tiré de l’incompatibilité des fonctions de Mme Glushak comme maîtresse de ballet accréditée auprès du Banlanchine Trust avec ses fonctions de directrice de la danse du Théâtre du Capitole. Car s’il est vrai que l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires oblige les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public à consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent, en principe, exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, les mêmes dispositions prévoient que les agents publics peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité, qu’elle soit ou non lucrative, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
En particulier, le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités, notamment, des agents non-titulaires de droit public, prévoit, parmi les activités accessoires susceptibles d’être autorisées l’enseignement et la formation, ainsi que les activités à caractère sportif ou culturel.
En l’espèce, le contrat conclu avec Mme Glushak prévoyait expressément que l’intéressée pourrait exercer des activités extérieures à celles du Théâtre du Capitole après autorisation du directeur artistique. Par suite, si les absences régulières de Mme Glushak liées à ses fonctions de répétitrice du Balanchine Trust nuisaient à l’intérêt du service, il suffisait au directeur artistique d’y mettre fin conformément aux termes du contrat, sans qu’il fût pour autant besoin de la licencier. D’ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’antérieurement à l’annonce de la nomination de M. Belarbi, la ville de Toulouse ait fait un quelconque reproche à Mme Glushak sur ce sujet et ait entendu remettre en cause ses activités accessoires.
Le deuxième motif qui nous paraît également fragile est tiré de la perte de notoriété du ballet, ainsi qu’en attesterait la diminution des propositions de tournées nationales et internationales de la part de Mme Glushak.
Tout d’abord, il n’est pas contesté que Mme Glushak a satisfait aux exigences de la nouvelle municipalité de doubler le nombre de représentations du ballet en trois saisons, et de proposer pour chaque saison, six programmes au lieu de quatre. Dans le même temps, Mme Glushak explique très logiquement la diminution des tournées en 2009 et en 2010 par cette augmentation concomitante de l’activité du ballet, mais également par une diminution du budget alloué au Ballet. Toutefois, sans entrer dans le détail de ces explications qui sont contestées par le défendeur, il vous suffira de jeter un œil sur le récapitulatif des tournées du Ballet du Capitole produit par la requérante, pour constater que le nombre des tournées entre 1998 et 2010 a été très variable d’une année sur l’autre. Ainsi, en 1998 comme en 2010, le Ballet ne s’est produit qu’une seule fois, en province, et une seule fois en 2011, à Pampelune, contre 5 fois en 2009, et 24 fois en 2008, notamment à Catane en Sicile. En moyenne, sur la période, le nombre de représentations en tournées est de 9 par an, et le nombre de localités visitées par le Ballet est de sept par an. Par suite, compte tenu à la fois du rythme aléatoire des tournées et du nombre très important de tournées en 2008, avec 15 localités visitées, il ne nous semble pas que le seul nombre de tournées en 2009, 2010 et 2011 fasse la démonstration d’une perte de notoriété du Ballet du Capitole.
Surtout, Mme Glushak était chargée, aux termes de son contrat, du fonctionnement et de la programmation du Ballet du Capitole, « sous l’autorité et avec l’accord du directeur artistique ». Ainsi, il n’est pas allégué par le défendeur que la nouvelle municipalité aurait fixé à Mme Glushak un objectif chiffré de tournées à atteindre, ni même que la direction artistique aurait demandé à l’intéressée de prévoir davantage de tournées pour 2009 et 2010, et que Mme Glushak aurait été incapable de réaliser cet objectif faute pour le Ballet du Capitole et, indirectement, de sa chorégraphe et directrice, d’être suffisamment côtés sur le marché, si vous nous permettez l’expression, mais c’est bien de cela qu’il s’agit.
Restent alors en débat les deux motifs tirés d’une part, d’une divergence esthétique quant aux choix de programmation, d’autre part, d’un refus de Mme Glushak de faire coopérer le Ballet du Capitole avec des acteurs locaux.
Au soutien de cette décision, vous disposez de deux attestations, non datées, du directeur artistique du théâtre du Capitole, qui indiquent, pour la première, que Mme Glushak n’a pas su s’adapter à la volonté d’élargissement du projet artistique du Ballet du Capitole à d’autres esthétiques que le ballet académique et la danse néoclassique, pour la seconde, que l’intéressée n’a pas souhaité établir des passerelles avec d’autres institutions ou associations toulousaines intervenant dans le domaine de la danse.
Toutefois, dans le premier cas, le défendeur ne produit aucun autre document susceptible d’établir que des directives précises auraient été données à Mme Glushak pour encadrer son pouvoir de proposition sur l’esthétique des spectacles à programmer.
Certes, la commune de Toulouse tente bien de vous convaincre que la nouvelle municipalité issue des urnes en 2008 a souhaité imprimer sa marque dans le domaine culturel en bâtissant un nouveau projet fondé sur quatre objectifs : donner l’envie de culture à tous les Toulousains, miser sur l’avenir et l’innovation culturelle, inscrire la culture au centre du développement urbain durable et imaginer la culture ensemble.
Toutefois, il s’agit d’un document aux termes très généraux, dont il n’est aucunement démontré qu’il a fait l’objet d’une déclinaison concrète au sein du Ballet du Capitole. Rappelons, là encore, que s’il incombait à Mme Glushak d’être force de proposition, le choix définitif de la programmation incombait au directeur artistique. Ainsi, la commune de Toulouse reproche à Mme Glushak, en dépit des demandes en ce sens de M. Chambert, directeur artistique, de ne pas avoir souhaité programmer le ballet Les forains, qui a été créé pour la première fois en 1945 par le chorégraphe Roland Petit, sur une musique du compositeur bordelais Henri Sauguet, ou encore de ne pas avoir souhaité collaborer avec tel ou tel chorégraphe contemporain : Angelin Preljocaj, Jean-Claude Gallotta, Inbal Pinto, Pina Bausch, etc, mais également des chorégraphes toulousains, comme Pierre Rigal, Aurélien Bory ou Heddy Maalem.
Mais de deux choses l’une : soit ces demandes ont fait l’objet de directives précises de la part du directeur artistique, et dans ce cas, Mme Glushak a refusé de s’y conformer, ce qui ne révèle pas une inaptitude de sa part à l’évolution du service culturel, mais un refus d’obéissance passible d’une faute disciplinaire, ce qui n’est aucunement allégué. Soit, et c’est plutôt ce que nous déduisons à la lecture des pièces du dossier, il s’agissait plutôt de recommandations informelles de la part du directeur artistique, et Mme Glushak a purement et simplement continué, pour les années 2008 à 2010, de proposer une programmation avec l’autonomie que lui conféraient, non seulement les termes de son contrat, mais également une ancienneté dans le poste de près de quinze ans, avec la circonstance non-contestée que la programmation proposée par Mme Glushak rencontrait l’adhésion d’un public toulousain important, ainsi que le notait M. Chambert lui-même dans l’une des attestations.
Vous noterez en passant que le défendeur ne produit aucune fiche d’évaluation qui formaliserait des objectifs que l’autorité territoriale aurait assignés à Mme Glushak dans le cadre de son activité professionnelle.
En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Glushak aurait été incapable d’aborder d’autres esthétiques que l’esthétique classique ou néo-classique et de modifier la programmation du Ballet du Capitole en vue de l’ouvrir à la danse dite contemporaine, si une demande formelle de la part de son employeur lui avait été faite en ce sens.
S’agissant du dernier motif, de coloration disciplinaire, tiré de ce que Mme Glushak aurait fait preuve d’une forte résistance à l’égard du second axe d’évolution que la nouvelle municipalité aurait décidé, la requérante ne conteste pas qu’il lui avait été demandé d’associer le ballet du Capitole à des acteurs locaux évoluant notamment dans le hip-hop ou la danse moderne en vue de réaliser des projets communs.
La commune fait ainsi état du désintérêt de la requérante pour la mise en place du projet « Place de la Danse » en juin 2011, événement auquel elle n’aurait pas assisté. Vous noterez toutefois qu’à cette date, M. Belarbi était déjà directeur de la danse « désigné » depuis presque six mois, de sorte que l’absence de Mme Glushak est aisément compréhensible, et ne saurait justifier une sanction telle qu’une exclusion définitive du service.
Le défendeur fait également valoir que Mme Glushak n’a jamais pris l’initiative d’associer le Ballet du Capitole à des actions de sensibilisation conduites par le Théâtre du Capitole dans les quartiers défavorisés, ou d’avoir limité une rencontre artistique organisée le 23 mars 2010 entre les danseurs du Ballet et ceux de la compagnie de hip-hop du centre d’art chorégraphique des danses urbaines à deux présentations successives en lieu et place d’un spectacle commun.
Toutefois, là encore, il ne ressort pas des pièces du dossier que des instructions précises avaient été données à Mme Glushak en ce sens.
Enfin, si le maire de Toulouse reprochait également à Mme Glushak la mauvaise implication des danseurs lors des différentes éditions de la manifestation « Osons danser », la requérante soutient sans être contestée en défense que ce projet avait été mis en place par M. Belarbi dès le début, soit en janvier 2010, et que Mme Glushak n’avait pas même été informée de la participation de certains des danseurs du Ballet à ces actions, de sorte que ceux-ci ont été effectivement indisponibles pour l’une des représentations de ce spectacle.
En conséquence, il ne nous semble pas que la commune de Toulouse établisse que l’éviction de Mme Glushak au profit de M. Belarbi aurait été justifiée par des motifs tirés de l’intérêt du service, et vous annulerez la décision attaquée.
*****
Vous le savez, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, vous devez déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction (cf. CE, 6 décembre 2013, Commune d’Ajaccio, n°365155, en A sur ce point).
Or en l’espèce, si Mme Glushak vous demande de condamner son ancien employeur à lui verser la somme de 80.000 euros au titre de la diminution de ses revenus, elle n’établit ni le montant des allocations de retour à l’emploi qu’elle aurait perçues, le cas échéant, ni surtout, que son licenciement ne lui a pas permis d’exercer ses activités artistiques, notamment au titre du Balanchine Trust, beaucoup plus librement qu’elle ne pouvait le faire lorsqu’elle était liée au Ballet du Capitole, et donc de manière bien plus lucrative. En bref, la requérante n’établit aucunement la réalité de ce préjudice financier.
En revanche, s’agissant du préjudice moral, que Mme Glushak évalue à 100.000 euros, il est difficilement contestable, eu égard à la durée indéterminée du contrat dont Mme Glushak était bénéficiaire, compte tenu également de son ancienneté lors de son licenciement et de son âge, mais aussi et surtout, compte tenu de la nature de ses fonctions. Ainsi, au regard d’une décision du Conseil d’Etat qui a octroyé, en tant que juge du fond, une indemnité de 300.000 francs, soit plus de 45.000 euros, à raison du préjudice moral et professionnel occasionné à un musicien de l’orchestre philarmonique des Pays-de-Loire, irrégulièrement évincé de son contrat à durée indéterminée après vingt ans de bons et loyaux services, nous vous proposons de limiter l’indemnisation de Mme Glushak, qui n’a invoqué qu’un préjudice moral, à la somme de 20.000 euros (cf. CE 8 novembre 2000, Thévenet, n°200835, en A mais pas sur ce point[16] ; cf. également : CE, 26 juin 1989, Ville d’Aix-en-Provence, n°99763[17] : 1.500 euros pour une directrice de crèche en CDI depuis deux ans).
*****
Par ces motifs, nous concluons :
- A l’annulation de la décision de licenciement de Mme Glushak en date du 13 février 2012 ;
- A ce que vous condamniez la commune de Toulouse à verser à Mme Glushak la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Au rejet du surplus des conclusions indemnitaires ;
- Et dans les circonstances de l’espèce, à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2016 ; Art. 59.
[1] Ballet chorégraphié par Marius Petipa sur une musique de Léon Minkus, créé en 1877 au Théâtre du Bolchoï de Saint-Pétersbourg.
[2] Ballet chorégraphié par Petipa sur une musique de Tchaïkovski, créé en 1890 au Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg.
[3] Ballet chorégraphié par Petipa sur une musique de Minkus, créé en 1869 au Théâtre du Bolchoï de Saint-Pétersbourg.
[4] Ballet créé en 1789 par Jean Bercher, dit Dauberval, au Grand Théâtre de Bordeaux.
[5] Ballet créé en 1841 à l’Académie royale de musique (actuellement l’Opéra de Paris), chorégraphié par Jean Coralli & Jules Perrot, sur une musique d’Adolphe Adam.
[6] Ballet d’Arthur Saint-Léon, sur une musique de Léo Delibes, créé en 1870 à l’Opéra de Paris.
[7] Ballet créé en 1832 par Filippo Taglioni à l’Opéra de Paris, sur un livret d’Adolphe Nourrit et une musique de Jean Schneitzhoeffer.
[8] « CONSIDERANT QUE MME LE CACHEY ET MME GUIGUERE, QUI AVAIENT ETE ENGAGEES PAR LA VILLE DE TOULOUSE EN QUALITE DE DANSEUSES DU CORPS DE BALLET DU THEATRE MUNICIPAL DU CAPITOLE SUIVANT CONTRATS SUCCESSIVEMENT PASSES POUR CHAQUE SAISON LYRIQUE DE 1972 A 1977, ONT ATTRAIT LADITE VILLE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOULOUSE EN VUE D’OBTENIR PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES POUR LICENCIEMENT ET RUPTURE ABUSIVE DE LEURS CONTRATS DE TRAVAIL ; QUE M. FEGELE, ENGAGE PAR LA MEME COLLECTIVITE PUBLIQUE SUIVANT CONTRAT DU 10 JUILLET 1974 EN QUALITE DE MUSICIEN DE L’ORCHESTRE REGIONAL DU CAPITOLE, A SAISI LA MEME JURIDICTION D’UNE DEMANDE EN PAIEMENT D’UN RAPPEL DE SALAIRES ; CONS. QUE LA VILLE DE TOULOUSE QUI, PAR L’ORGANISATION ET LA GESTION DU THEATRE MUNICIPAL ET DE L’ORCHESTRE REGIONAL DU CAPITOLE, ASSUME UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, LA REMPLIT DANS DES CONDITIONS EXCLUSIVES DE TOUT CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ; QUE LE PERSONNEL ARTISTIQUE ENGAGE PAR ELLE POUR ASSURER LES ACTIVITES DE CES THEATRES ET ORCHESTRE PARTICIPE DIRECTEMENT A L’EXECUTION DUDIT SERVICE PUBLIC ; QUE, DES LORS, LES LITIGES CONCERNANT L’EXECUTION OU LA RUPTURE DES CONTRATS PASSES ENTRE LA VILLE DE TOULOUSE, MME LE CACHEY ET MME GUIGUERE ET M. FEGELE SONT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; (CONFIRMATION DE L’ARRETE DE CONFLIT). »
[9] « Est administratif le contrat passé entre une ville, qui assure la mission de service public consistant en l’organisation et la gestion du théâtre municipal, et les artistes, quels que soient le nombre de leurs représentations et leur mode de rémunération. »
[10] « 1) Il résulte des dispositions spécifiques des articles L. 620-9 et L. 762-1 du code du travail et 1-1 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d’entrepreneur de spectacle vivant engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail. / 2) Si, par l’organisation et la gestion d’un festival, la communauté d’agglomération a assumé une mission de service public et l’a remplie dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial, les contrats par lesquels elle s’est assurée, comme entrepreneur de spectacles vivants, de la participation d’un musicien à des concerts, sans que cette participation puisse être regardée comme constituant soit une obligation de service hebdomadaire incombant à celui-ci en application du statut particulier de son cadre d’emplois, soit l’accessoire nécessaire d’une telle obligation, dès lors que ces concerts n’avaient pas pour objet de lui permettre, avec ses élèves, de pratiquer la musique en public pour valoriser l’enseignement dispensé, entrent dans le champ des dispositions précitées. Par suite, le litige relatif au montant des salaires réclamés au titre de l’exécution de ces contrats relève de la compétence du juge judiciaire. »
[11] « Considérant que si, par l’intermédiaire de son orchestre symphonique, la commune de Saint-Etienne assume une mission de service public et la remplit dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial, les contrats par lesquels elle s’est assurée en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants la participation de Mme Olteanu à des concerts, en tant que violoniste, entrent dans le champ des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, le litige relatif aux obligations de l’employeur découlant de tels contrats relève de la compétence du juge judiciaire ; »
[12] « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X…, professeur non titulaire au conservatoire municipal de musique de Pantin, a été licencié par décision du 1er juillet 1982 du maire de Pantin en raison de la réorientation des cours d’esthétique et de théâtre musical assurés par l’intéressé ; que cette réorganisation avait pour objet de permettre l’exécution d’oeuvres musicales dans le cours d’esthétique en confiant ce cours à un professeur instrumentiste et d’assurer la formation de chanteurs comédiens dans le cours de théâtre musical en confiant ce cours à un professionnel du théâtre ; qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité de cette réorganisation ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. X…, qui n’est pas instrumentiste, ait possédé les qualifications désormais demandées par la commune, qu’il ait été remplacé pour le cours d’esthétique par un professeur non instrumentiste, ou qu’il ait été licencié en raison de sa participation aux mouvements de grève qui ont précédé la réorganisation du conservatoire pour des motifs étrangers à l’intérêt du service ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du maire de Pantin prononçant son licenciement. »
[13] Cf. CAA Lyon, 28 avril 2000, n°96LY01864, en A.
[14] « Secrétaire de mairie stagiaire, licenciée pour insuffisance professionnelle, soutenant qu’elle a été en réalité licenciée pour des motifs politiques. La requérante qui s’est vu interdire l’accès de son bureau depuis le renouvellement de la municipalité, et dont le mari a été également licencié par le nouveau maire, doit être regardée, en l’absence de contestation de ces faits par la commune, comme ayant été en réalité licenciée pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Confirmation du jugement ayant annulé l’arrêté de licenciement. »
[15] « Appel formé par une commune contre un jugement annulant le licenciement d’un agent municipal. La commune avait invoqué devant le tribunal administratif un ensemble de griefs précis, sur lesquels l’intéressé avait fourni des justifications circonstanciées et convaincantes. Elle n’a opposé à celles-ci aucun argument, se bornant à affirmer que le licenciement serait intervenu, en vertu du pouvoir discrétionnaire du maire, pour insuffisance professionnelle. La décision ayant été prise en réalité pour des motifs étrangers à l’intérêt du service, rejet de la requête. »
[16] « Considérant que la délibération du comité du syndicat mixte prévoyant la suppression progressive des emplois à temps incomplet au sein de l’orchestre, en application de laquelle a été prise la décision de licencier M. THEVENET, a été annulée par le juge administratif pour un motif tiré du vice de la procédure précédant l’adoption de la délibération annulée, qui résultait du défaut de consultation du comité technique paritaire ; que, par ailleurs, M. THEVENET a perçu une indemnité de licenciement équivalant à un an de traitement qui constitue la réparation normale de la rupture d’un contrat à durée indéterminée ; que toutefois, il est en droit de prétendre à la réparation du préjudice financier, professionnel et moral que lui a causé la faute résultant de l’irrégularité de la délibération dont procède la décision de le licencier ; que si M. THEVENET est fondé à invoquer l’existence d’un préjudice financier, il ne peut pas pour autant prétendre, en l’absence de service fait, au versement de sa rémunération pendant la période qu’il invoque ; que l’intéressé, compte tenu des liens existant entre l’exercice des fonctions de professeur de musique et celles de musicien, est également fondé à invoquer le préjudice professionnel que lui a causé son éviction de l’orchestre ; que l’intéressé enfin, compte tenu de sa réputation de musicien, est fondé à invoquer le préjudice moral que lui a causé cette même éviction ; / Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. THEVENET à raison de son licenciement en fixant l’indemnité qui lui est due, en sus de l’indemnitéde licenciement de 160 722,78 F qu’il a perçue, à 300 000 F, tous intérêts compris ; que, dans cette mesure, le syndicat mixte est fondé à demander la réformation du jugement attaqué tandis que la requête de M. THEVENET doit être rejetée ; »
[17] « Considérant, enfin que le tribunal administratif n’a pas fait une évaluation exagérée du préjudice moral que la mesure de licenciement a causé à Mme Biètry, en condamnant, pour ce chef de préjudice, la VILLE D’AIX-EN-PROVENCE à verser à l’intéressée une indemnité de 10 000 F ; »