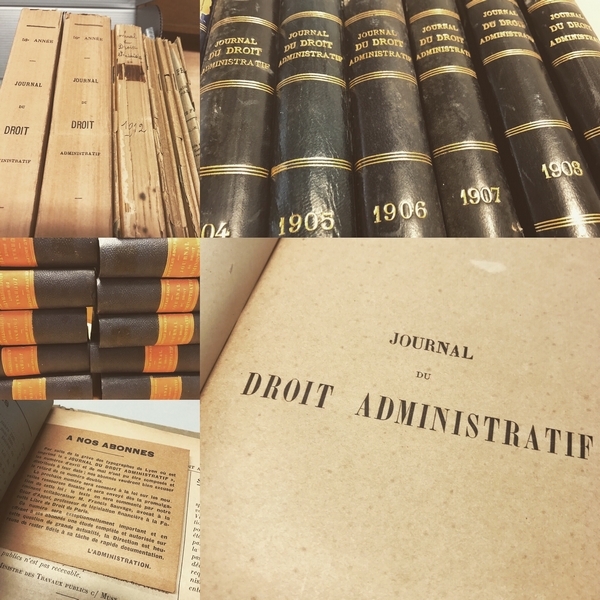par Mathias AMILHAT,
Maître de conférences en Droit public – Université de Lille
Art. 236.
Le droit de la commande publique a connu des changements importants au cours de l’année 2018. Parmi ces changements, ce sont les évolutions textuelles qui focaliseront l’attention des observateurs lors des prochains mois. Trois changements d’importance inégale sont en effet survenus. Tout d’abord, la loi de programmation militaire est venue modifier les règles applicables aux marchés publics de défense et de sécurité afin de mieux tenir compte de la spécificité de ces contrats et des potentialités offertes par le droit de l’Union à ce sujet. Ensuite, la dématérialisation imposée par les directives de 2014 est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 – après une période d’adaptation fixée par les textes de transposition. Il est difficile de déterminer si cette dématérialisation permettra d’atteindre les bénéfices escomptés : facilitera-t-elle notamment l’accès des opérateurs économiques aux procédures de passation en entraînant un accroissement de la concurrence ? Permettra-t-elle vraiment aux acheteurs de réaliser des économies ? Enfin et surtout, le code de la commande publique a été publié le 5 décembre 2018 pour une entrée en vigueur le 1er avril 2019. Cette publication éait attendue depuis l’adoption de la loi Sapin 2 mais la consultation publique organisée au printemps 2018 permettait de s’interroger sur le contenu exact de ce code. Comme pour la dématérialisation, ce sont les mois voire les années à venir qui permettront de saisir véritablement l’impact de la codification opérée. De plus, une analyse plus détaillée du contenu du code devrait être proposée avant son entrée en vigueur. Malgré tout, quelques remarques initiales méritent d’être formulées dès à présent.
Au-delà des révolutions textuelles, la jurisprudence de ces
derniers mois mérite elle aussi l’attention des observateurs. Elle permet,
notamment, de mieux saisir le contenu des textes adoptés lors de la réforme de
la commande publique de 2015 et 2016 et d’anticiper certaines interprétations
qui seront données des dispositions du code lorsqu’il entrera en vigueur. Les
décisions rendues permettent par ailleurs, comme à leur habitude, de croiser
les points de vue des juges français et européen et de mesurer la convergence
progressive des solutions retenues.
Première
(r)évolution : des modifications substantielles pour les règles
applicables aux marchés publics de défense et de sécurité
La loi de programmation militaire est venue modifier –
entre autres dispositions – un certain nombre de règles fixées par l’Ordonnance
du 23 juillet 2015 (L. n° 2018-607, 13
juill. 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025
et portant diverses dispositions intéressant la défense : JO 14 juill. 2018,
texte n° 1 ; Contrats-Marchés publ. 2018, comm. 206, note G. Clamour).
Les réformes introduites s’agissant des marchés publics de défense et de
sécurité poursuivent une double logique : la volonté de remettre en cause
les sur-transpositions opérées par l’Ordonnance et la recherche de davantage de
souplesse pour les acheteurs qui passent de tels marchés. Parmi les changements
introduits, la loi modifie la définition organique des marchés publics de
défense ou de sécurité fixée par l’article 6 de l’Ordonnance pour permettre la
prise en compte des marchés passés par les établissements publics industriels
et commerciaux de l’Etat. Auparavant, les seuls acheteurs susceptibles de
passer de tels marchés étaient l’Etat et ses établissements publics
administratifs, ce qui signifiait que les établissements publics industriels et
commerciaux de l’Etat passaient en principe des marchés publics
« ordinaires », y compris lorsque ces marchés portaient sur la
défense ou la sécurité. Cette distinction parmi les établissements publics de
l’Etat n’étant pas imposées par les directives, la loi corrige la définition
sur ce point. De la même manière, la loi modifie l’article 47 de l’Ordonnance.
Cet article, qui concerne les dérogations possibles aux interdictions de
soumissionner, envisageait de la même manière les marchés publics
« ordinaires » et les marchés publics de défense et de sécurité en
fixant trois conditions cumulatives. Or, les directives européennes
n’imposaient ces trois conditions que pour les marchés publics
« ordinaires » : il faut que l’admission de l’opérateur
économique normalement exclu soit justifiée par des raisons impérieuses
d’intérêt général, que le marché public en cause ne puisse être confié qu’à ce
seul opérateur économique et qu’un jugement définitif d’une juridiction d’un
Etat membre de l’Union européenne n’exclut pas expressément l’opérateur
concerné des marchés publics. A l’inverse, les textes européens n’exigent
qu’une seule condition pour les marchés de défense et de sécurité. Cette
distinction est désormais reprise et l’article 47 permet aux acheteurs
d’admettre des dérogations aux interdictions de soumissionner sans exiger
d’autres conditions que des raisons impérieuses d’intérêt général pour les
marchés de défense et de sécurité. La sur-transposition est, sur ce point
également, gommée par la loi. De plus, la loi est venue introduire de nouvelles
exclusions spécifiques pour les marchés publics de défense ou de sécurité à
l’article 16 de l’Ordonnance (16, 3° et
16, 4° de l’Ordonnance). Ces exclusions sont prévues par les directives
européennes mais elles avaient été « oubliées » lors de la
transposition en 2015 et 2016… Enfin, la loi supprime l’obligation de
communiquer les données essentielles fixée par l’article 56 de l’Ordonnance s’agissant
des marchés publics de défense et de sécurité car les textes européens
n’imposaient cette communication, là encore, que pour les marchés publics
« ordinaires ». Ces différentes modifications assurent une
simplification des règles applicables aux marchés publics de défense et de
sécurité mais elles permettent aussi de mesurer à quel point les opérations de
transposition peuvent conduire à adopter des règles contraignantes en avançant
des exigences européennes, y compris lorsque ces dernières n’existent pas.
Espérons donc que le législateur français continuera d’œuvrer en ce sens, les
rapports avec le droit de l’Union ne s’en porteront que mieux.
Deuxième
(r)évolution : la dématérialisation entre en vigueur !
Longtemps
annoncée, la dématérialisation des marchés publics est devenue une réalité
depuis le 1er octobre 2018. La direction des affaires juridiques de
Bercy propose deux guides complets, l’un à destination des acheteurs (https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/20180601_Guide-MP-dematerialisation-2018-A.pdf ), l’autre pour les opérateurs économiques ( https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/20180601_Guide-MP-dematerialisation-2018-OE.pdf ). Pour les acheteurs, l’entrée en vigueur de la
dématérialisation implique tout d’abord de se doter d’un « profil
d’acheteur ». Ils doivent en effet utiliser cette plateforme pour publier
les documents de la consultation de tous leurs marchés publics dont la valeur
estimée est égale ou supérieure à 25 000 € HT. Les communications et
échanges d’informations doivent également être effectués par voie
dématérialisée. Toutes ces obligations n’admettent que des dérogations
limitées. Pour les opérateurs économiques, en-dehors là aussi de quelques
exceptions, la dématérialisation impose que les candidatures et les offres
soient communiquées par voie dématérialisée. Par ailleurs, il faut souligner
que la signature électronique n’est – pour l’heure – pas encore imposée. Les
guides semblent toutefois indiquer que la signature électronique de l’offre
finale s’impose en quelque sorte lorsque la procédure de passation est
dématérialisée dans la mesure où toutes les communications et les échanges
d’information sont dans ce cas dématérialisés. Les acheteurs et les opérateurs
économiques ont donc tout intérêt à suivre ces conseils et ils devront, pour
signer électroniquement, utiliser une signature avancée reposant sur un
certificat qualité (Arrêté du 12 avril
2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique ; JO 20
avril 2018, texte n° 30). Enfin, au-delà des obligations liées à la
dématérialisation, les acheteurs sont également tenus depuis le 1er
octobre de transmettre par voie électronique les informations concernant leurs
marchés de plus de 90 000 € HT à l’Observatoire économique de la commande
publique (OECP). Une application
dénommée « REAP » (Recensement
économique de l’achat public) a été créée pour permettre ces transmissions
(https://www.reap.economie.gouv.fr/reap/servlet/authentificationAcheteur.html ).
Troisième
– et véritable – (r)évolution : adoption du « nouveau » code de
la commande publique !
Le code de la
commande publique vient enfin d’être publié (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative
du code de la commande publique et Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018
portant partie réglementaire du code de la commande publique ; JORF du 5
décembre 2018). Il entrera en vigueur le 1er avril 2019 ce qui
signifie que, jusqu’à cette date, ce sont les règles des ordonnances de 2015 et
de 2016 relatives aux marchés publics et aux contrats de concession, ainsi que
leurs décrets d’application, qui continueront de s’appliquer. Parmi les
arguments avancés par la Direction des affaires juridiques (L. Bédier, « Une boîte à outils organisée
selon la vie du contrat », AJDA 2018, p.2364) pour justifier la
codification, le principal est le souci de simplifier une matière dont les
effets économiques sont particulièrement importants. En effet, « les
marchés publics et les concessions représentent environ 200 Md€ par an, soit 8
% du PIB et un débouché très important pour les PME » (ibidem).
Pour atteindre cet objectif de simplification, la DAJ s’est appuyée sur
des experts et sur les praticiens du droit de la commande publique, ainsi que
sur la consultation publique organisée au printemps 2018. La question
principale reste de savoir si le code atteint ses objectifs : permet-il
vraiment une simplification de la matière ? Va-t-il permettre une meilleure
concurrence et, notamment, un accès facilité des PME à la commande
publique ? Il n’est pas possible, dans l’immédiat, de répondre de manière
tranchée à ces questions. L’adoption du code méritera en effet de faire l’objet
d’une chronique spéciale ou d’un dossier spécial au sein du Journal du droit
administratif. Pour autant, plusieurs remarques peuvent d’ores et déjà être
formulées.
Tout d’abord, le
code de la commande publique n’introduit pas d’innovations qui bouleversent la
matière par rapport aux textes de 2015 et 2016. Ce constat est tout à fait
logique dans la mesure où la codification a été effectuée à droit
constant : les auteurs du code ne pouvaient donc pas aller au-delà du
droit existant.
Par ailleurs, le code adopté a tenu compte des suggestions effectuées lors de la consultation publique ainsi que des modifications suggérées par le Conseil d’Etat. Il ne correspond donc pas exactement au projet de code de la commande publique tel qu’il avait été soumis à la consultation. Parmi les changements principaux, il faut noter la rédaction d’un titre préliminaire qui fait la part belle aux principes fondamentaux de la commande publique, là où le projet de code ne faisait que les intégrer parmi les dispositions spécifiques applicables aux marchés publics et aux contrats de concession. Il en ressort donc que tous les contrats de la commande publique sont soumis à ces principes fondamentaux, y compris lorsqu’il s’agit de « contrats exclus » tels qu’ils sont désignés par le code. Ce champ d’application étendu paraissait évident si l’on tient compte de l’ascendance européenne des principes fondamentaux de la commande publique et de leur application au-delà des contrats intégrant strictement le droit de la commande publique. La Cour de justice avait eu l’occasion de nous le rappeler très clairement dans son arrêt Promoimpresa qui a conduit aux évolutions que l’on connaît en matière de passation des conventions d’occupation du domaine public (CJUE, 14 juill. 2016, aff. C-458/14 et C-67/15 : JurisData n° 2016-015812 ; AJDA 2016, p. 2176, note R. Noguellou ; Contrats-Marchés publ. 2016 comm. 291 et repère 11 par F. Llorens et P. Soler-Couteaux ; sur ce sujet, v. Journal du Droit Administratif (JDA), 2017 ; chronique administrative 03 ; Art. 128 http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=1385 ; Journal du Droit Administratif (JDA), 2017 ; chronique contrats publics 02 ; Art. 190 http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=1869 ). Malgré tout, l’intégration de ce titre préliminaire constitue une avancée et la question du régime juridique des contrats exclus est d’ores et déjà posée (G. Clamour, « Les marchés exclus », Contrats-Marchés publ. 2015, dossier 3 ; S. de la Rosa, « Les exclusions », RFDA 2016, p. 227 ; H. Hoepffner et F. Llorens, « Dans quoi les contrats exclus des ordonnances marchés publics et concessions sont-ils inclus ? », Contrats-Marchés publ. 2018, repère 4 ; G. Eckert, « Quelle place pour les principes de la commande publique », Contrats-Marchés publ. 2018, repère 10 ; M. Ubaud-Bergeron, « Champ d’application du code de la commande publique », Contrats-Marchés publ. 2019, dossier 5) .
Il faut aussi
relever qu’un certain nombre de règles jurisprudentielles ont été intégrées
dans le code, tant en matière de marchés publics que pour les contrats de
concession. Tout d’abord, en matière de marchés publics, la jurisprudence
relative à la notion d’offre anormalement basse a été intégrée à l’article L. 2152-5
du code. Par ailleurs, s’agissant des
contrats de concession, l’article L. 3121-2 codifie la possibilité d’attribuer
sans publicité ni mise en concurrence des concessions en cas d’urgence et pour
une durée limitée, tandis que les articles L. 3132-4 et L. 3132-5 reprennent la
jurisprudence relative au sort des biens de retour ! Enfin, quel que soit
le contrat de la commande publique concerné, le code rappelle à l’article L. 6
certains pouvoirs reconnus aux autorités contractantes lorsque leurs contrats
sont des contrats administratifs : le pouvoir de contrôle, ainsi que les
pouvoirs de modification et de résiliation unilatérale. Ce même article codifie
également la théorie de la force majeure en matière de contrats administratifs
et précise que « les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service
public respectent le principe de continuité du service public ».
Enfin, il faut d’ores et déjà préciser que l’adoption du code ne signifie pas que nous assisterons, après lui, à une forme de stabilité normative. Preuve en est : la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, Delphine Gény-Stephann, a présenté les grands axes de la stratégie du gouvernement en matière de commande publique le 1er octobre 2018. Or, ces grands axes appellent des réformes importantes qui vont, dans le courant de l’année 2019, venir modifier le code de la commande publique ( https://www.economie.gouv.fr/grands-axes-reforme-commande-publique ). Parmi les réformes annoncées, on trouve pêle-mêle : l’abaissement de la durée d’archivage des pièces justificatives des marchés publics ; la possibilité de recourir librement à un avocat lors d’une procédure juridictionnelle sans passer un marché public ; l’amélioration de la trésorerie des PME pour faciliter leur accès à la commande publique (augmentation du taux des avances pour les marchés de l’Etat, diminution du taux de la retenue de garantie, expérimentation de la procédure de gré à gré pour les achats innovants de moins de 100000 euros, recours à l’affacturage inversé) ; obligation d’insérer des clauses de révision des prix dans les marchés de matières premières agricoles et alimentaires ; suppression des ordres de services à zéro euros dans les marchés publics de travaux. Certaines de ces réformes étaient annoncées pour le mois de décembre mais il n’est pas certain qu’elles puissent toutes être intégrées au Code de la commande publique avant son entrée en vigueur… Les commentateurs n’ont donc pas fini de s’intéresser à ce droit qui reste, on le voit bien, extrêmement mouvant !
Contrats
de mobilier urbain : des concessions de services ?
La qualification
des contrats de mobilier urbain continue de susciter des interrogations qui
mériteraient davantage d’attention de la part du législateur. L’arrêt rendu par
le Conseil d’Etat le 25 mai 2018 bouleverse la jurisprudence antérieure et
renforce les incertitudes liées à la qualification de tels contrats (CE, 25 mai 2018, n° 416825, Société Philippe
Védiaud Publicité ; AJDA 2018, p. 1725,
note M. Haulbert ; JCP A 2018, act. 495 ; JCP A 2018, 2260, note
J.-B. Vila ; Contrats-Marchés publ. 2018, comm. 165, note G. Eckert).
Il y a cependant un élément que le Conseil d’Etat confirme dans cet
arrêt : la jurisprudence sur cette question est loin d’être fixée !!!
La question de la qualification des contrats de mobilier urbain se pose depuis
un certain temps. En 1980, déjà, le Conseil d’Etat rendait un avis dans lequel
il qualifiait ces contrats de « marchés publics […] assortis d’une
autorisation d’occupation du domaine public » (CE, sect., avis, 14 octobre 1980, n° 327449 ; EDCE 1981, n° 32, p. 196
; GACE, Dalloz, 3e éd., 2008, 142, comm. L. Richer). A l’époque,
il refusait que ces contrats soient qualifiés de délégations de service public
en l’absence de redevances perçues sur les usagers. C’est donc en quelque sorte
« par défaut » que la qualification de marché public était
retenue ! Elle a toutefois été confirmée en 2005, mais avec une
argumentation différente (CE, ass., 4
novembre 2005, n° 247298, Société Jean-Claude Decaux ; AJDA 2006, p. 120, étude
A. Ménéménis ; RFDA 2005. 1083, concl. D. Casas ; DA 2006, comm. 25, note J.-M.
Auby). Pour le Conseil d’Etat, les contrats de mobilier urbain devaient
être considérés comme des marchés publics car ils répondent à un besoin de la
personne publique et prévoient le versement d’un prix négatif :
l’autorisation d’exploiter à titre exclusif une partie du mobilier urbain à des
fins publicitaire et l’exonération de redevance pour occupation domaniale. A
cette époque, les contrats de mobilier urbain devaient donc respecter les
procédures de passation prévues pour les marchés publics, c’est-à-dire les
règles de passation les plus contraignantes parmi celles applicables aux
différents contrats publics. Or, en 2013, le Conseil d’Etat est en partie
revenu sur cette solution dans un arrêt plus que discutable (CE, 15 mai 2013, n° 364593, Ville de ; JCP A
2013, 2180, obs. J.-F. Giacuzzo ; Contrats-Marchés publ. 2013, comm. 199, obs.
G. Eckert ; DA 2013, comm. 63, obs. F. Brenet ; RJEP 2013, comm. 39, concl. B.
Dacosta ; RDP 2013, p. 1403, note C. Roux ; RDI 2013, p. 367, note S.
Braconnier ; LPA, 2 oct. 2013, p. 6) où il considère qu’un contrat de
mobilier urbain qui ne prévoit pas le renoncement de la personne publique au
versement de la redevance d’occupation et qui ne fait qu’imposer des
obligations réglementaires – et non des obligations contractuelles – est une
simple convention d’occupation du domaine public. Ainsi, un tel contrat relevait de la jurisprudence Jean Bouin (CE, sect., 3 décembre 2010, n° 338272-338527, Association Paris Jean
Bouin ; rec. p. 472, concl. N. Escault ; AJDA 2010, p. 2343 ; AJDA 2011,
p. 18, étude S. Nicinski et E. Glaser ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 25,
note G. Eckert ; DA 2011, comm. 17, note F. Brenet et F. Melleray) et
échappait aux règles de publicité et de mise en concurrence. Cette solution
était toutefois critiquable dans la mesure où le contrat en cause semblait
pouvoir être qualifié de concession de service au sens de la réglementation
européenne… Or, c’est justement la solution retenue par le Conseil d’Etat dans
son arrêt Société Védiaud Publicité. En
l’espèce, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes avait lancé une procédure de
passation d’un contrat de mobilier urbain, à l’issue de laquelle la société
Philippe Védiaud Publicité avait été désignée comme attributaire. Un concurrent
évincé, la société Girod Médias, a toutefois saisi le juge du référé
précontractuel pour demander l’annulation de la procédure de passation. Le
tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande, qualifiant le
contrat en cause de marché public conformément à la jurisprudence Jean-Claude
Decaux de 2005 en considérant « qu’il confiait à titre exclusif
l’exploitation des mobiliers à des fins publicitaires à son attributaire ».
Ce raisonnement est censuré par le Conseil d’Etat qui considère qu’en procédant
ainsi le juge des référés du tribunal administratif de Melun n’a pas
suffisamment vérifié si un risque était transféré à l’attributaire du contrat.
Or, le transfert d’un risque d’exploitation constitue désormais le critère
essentiel pour distinguer les marchés publics et les contrats de concession (CJCE, 13 octobre 2005, aff. C-458/03,
Parking Brixen ; JCP A 2005, 1021, p. 141, note D. Szymczak; Contrats-Marchés
publ. 2005, comm. 306, obs. G. Eckert ; CE, 7 novembre 2008, n° 291794,
Département de la Vendée; Contrats-Marchés publ. 2008, comm. 296 , obs. G.
Eckert ; AJDA 2008, p. 2454, note L. Richer ; BJCP 62/2009, p. 55 , concl. M.
Boulais ; CJUE, 10 septembre 2009, aff. C-206/08, Eurawasser ;
Contrats-Marchés publ. 2010, repère 1 , note F. Llorens et P. Soler-Couteaux ;
CJUE, 21 mai 2015, aff. C-269/14, Kansaneläkelaitos ; Contrats-Marchés publ.
2015, comm. 180, note M. Ubaud-Bergeron ; Europe 2015, comm. 264 , obs. A.
Bouveresse). Ce critère est désormais expressément repris par les textes,
comme le précise le Conseil d’Etat en rappelant la définition des contrats de
concession telle qu’elle est posée par l’article 5 de l’ordonnance du 29
janvier 2016 (définition reprise à
l’article L. 1121-1 du code de la commande publique). En l’espèce, le juge
administratif relève deux éléments qui lui permettent de conclure que le
titulaire du contrat allait être soumis à un réel risque d’exploitation. Tout
d’abord, il précise que le contrat de mobilier urbain passé « ne comporte
aucune stipulation prévoyant le versement d’un prix à son titulaire ». Or,
on le sait, le versement d’un prix est l’un des critères d’identification des
marchés publics – même si le versement d’un tel prix n’empêche pas systématiquement
l’existence d’un risque d’exploitation. Ensuite, et surtout, le Conseil d’Etat
précise que le titulaire du contrat « est exposé aux aléas de toute nature
qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d’espaces de mobilier
urbain par les annonceurs publicitaires sur le territoire de la commune, sans
qu’aucune stipulation du contrat ne prévoie la prise en charge, totale ou
partielle, par la commune des pertes qui pourraient en résulter ». Il en
déduit donc que l’attributaire du contrat « se voit transférer un risque
lié à l’exploitation des ouvrages à installer », ce qui justifie que ce
dernier soit qualifié de contrat de concession. La solution retenue par le
Conseil d’Etat permet donc de considérer qu’un tel contrat de mobilier urbain
doit respecter les procédures de passation prévues pour les contrats de
concession, lesquelles sont moins contraignantes que celles applicables aux
marchés publics tout en assurant le respect d’un minimum d’obligations de
publicité et de mise en concurrence. Elle confirme par ailleurs que la solution
rendue en 2013 n’est plus d’actualité dans le cadre de la nouvelle
réglementation et que les contrats publics passés dans le secteur concurrentiel
n’échappent que rarement à l’application des principes fondamentaux de la
commande publique. Pour autant, si « la dimension concessive de la grande
majorité des contrats de mobilier urbain est […] reconnue par le Conseil d’État »
(G. Eckert, note sous l’arrêt, préc.),
la solution retenue n’est pas totalement satisfaisante. Elle confirme en effet
le caractère incertain de la qualification des contrats de mobilier urbain et,
partant, des règles de publicité et de mise en concurrence qui doivent être
respectées lors de leur passation. L’appréciation du risque d’exploitation
mériterait en effet d’être davantage explicitée et certains commentateurs
critiquent d’ores et déjà l’analyse retenue par le juge. Il s’agit en effet
d’une analyse purement juridique, qui se contente de constater l’absence de
stipulations prévoyant la prise en charge des pertes par la commune, sans
effectuer une analyse économique du contrat en cause (M. Haulbert, « La qualification des contrats de mobilier urbain ou
le mythe de Sisyphe revisité », note sous l’arrêt, préc.). En toutes
hypothèses, et même si la notion de concession de service permet de dépasser
les limites antérieurement posées par la notion de délégation de service
public, la qualification des contrats de mobilier urbain devrait continuer à
susciter un nombre important de décisions et de commentaires qui permettront –
peut-être – de sécuriser davantage les procédures de passation de ces contrats.
Application
des principes européens : le critère reste l’intérêt transfrontalier certain
La Cour de
justice (CJUE, 19 avr. 2018, aff.
C-65/17, Oftalma Hospital Srl ; Contrats-Marchés publ. 2018, comm. 153,
note M. Ubaud-Bergeron ; Europe 2018, comm. 229, note F. Peraldi-Leneuf)
est venue rappeler et préciser le champ d’application des règles fondamentales
et des principes généraux posés par le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE). Ce rappel est particulièrement important car il permet
d’éclairer le droit français à ce sujet, notamment s’agissant de la prise en
compte des principes fondamentaux de la commande publique. En l’espèce, le juge
devait se prononcer sur une question préjudicielle transmise par la Cour de
cassation italienne à propos d’un contrat conclu entre la commission des établissements
hospitaliers vaudois – qui est un organisme de droit public au sens des
directives européennes –, la région Piémont, et la société Oftalma Hospital Srl.
L’exécution de ce contrat a fait naître un litige financier devant les
juridictions italiennes lesquelles, après avoir identifié le contrat passé
comme un marché public de services sanitaires relevant de l’annexe I,B de
l’ancienne directive 92/50, se sont interrogées sur le fait de savoir si la
passation de ce contrat n’était pas illégale en application du droit de l’Union
européenne. C’est en effet la solution retenue par la Cour d’appel de Turin qui
a considéré que le marché public de services sanitaires aurait dû être précédé
d’une publicité et d’une mise en concurrence. Cette solution interroge la Cour
de cassation car la directive de 1992 prévoyait que les marchés relevant de
l’annexe I,B – qui sont aujourd’hui des marchés publics passés selon une
procédure adaptée en raison de leur objet – n’étaient soumis qu’au respect de
certains articles de la directive. Or, parmi ces articles, aucun ne prévoit
l’obligation de procéder à publicité et à une mise en concurrence préalables. En
réalité, comme le révèle l’arrêt, la Cour d’appel de Turin a retenu cette
solution conformément à « la jurisprudence des juridictions
administratives italiennes selon laquelle les marchés de prestations de
services sanitaires, bien que ne relevant pas directement de la réglementation
applicable en matière de marchés publics de services, n’en demeurent pas moins
soumis à un appel préalable à la concurrence, même informel, en application des
règles générales de droit interne et des principes de droit de l’Union
découlant des articles 49, 56 et 106 TFUE » (cons. 26). C’est donc cette jurisprudence des juridictions administratives
italiennes qui justifie la question préjudicielle posée à la Cour de justice de
l’Union européenne. On retrouve ici la particularité du droit italien des
contrats publics dont le contentieux est réparti entre les juridictions
administratives – chargées de contrôler la passation – et les juridictions
judiciaires, lesquelles demeurent les véritables juges du contrat et donc de
son exécution. En réalité, la Cour de cassation se demandait si elle était
tenue de consacrer une solution identique à celle retenue par les juges
administratifs ou non. Or, pour trancher cette question, il lui fallait
déterminer si le respect de règles de publicité et de mise en concurrence est
imposé par le droit de l’Union ou par le seul droit national. La Cour de
justice devait donc préciser si un pouvoir adjudicateur qui attribue un marché
public portant sur des services sanitaires ou sociaux peut se contenter de
respecter les seuls articles dont l’application est expressément prévue par les
directives ou s’il est « également tenu de se conformer aux règles
fondamentales et aux principes généraux du traité FUE, en particulier aux
principes d’égalité de traitement et de non‑discrimination en raison de la
nationalité ainsi qu’à l’obligation de transparence qui en découle » (cons. 31). En réalité, c’est la question
du champ d’application des principes fondamentaux du droit européen des
contrats publics qui est posée : est-ce que le TFUE impose leur respect
pour tous les contrats passés par des pouvoirs adjudicateurs ou par des entités
adjudicatrices ou est-ce qu’ils ne s’appliquent qu’aux seuls contrats soumis
aux directives, c’est-à-dire à des réglementations sectorielles. La réponse de
la Cour est sans ambigüité et conforme à sa jurisprudence traditionnelle en la
matière : les principes qui découlent du TFUE ne s’appliquent pas
uniquement au travers des réglementations sectorielles et possèdent un champ
d’application beaucoup plus large. En principe, tous les contrats passés par
des pouvoirs adjudicateurs ou par des entités adjudicatrices doivent respecter
ces principes. Pour autant, ce principe rencontre certaines exceptions dont une
exception classique: le droit de l’Union européenne n’impose l’application de
ces principes que pour les contrats qui présentent un intérêt transfrontalier certain.
Or, comme la Cour le relève, en excluant l’application de la plupart des règles
relatives aux marchés publics aux marchés de services sanitaires et sociaux,
« le législateur de l’Union a présumé que » ces marchés « ne
présentent pas, a priori, eu égard à leur nature spécifique, un intérêt
transfrontalier suffisant susceptible de justifier que leur attribution se
fasse au terme d’une procédure d’appel d’offres censée permettre à des
entreprises d’autres États membres de prendre connaissance de l’avis de marché
et de soumissionner » (cons.
35 ; la Cour renvoie également à CJUE, 17 mars 2011, Strong Segurança,
C‑95/10). Il ne s’agit toutefois que d’une présomption qui peut être
renversée lorsque le marché présente un intérêt transfrontalier certain. Dans
une telle hypothèse, un appel d’offres ne s’impose pas mais le principe de
transparence « implique de garantir un degré de publicité adéquat
permettant, d’une part, une ouverture à la concurrence et, d’autre part, le
contrôle de l’impartialité de la procédure d’attribution » (cons. 36). La Cour de justice confirme
donc que les principes européens, notamment la transparence et la
non-dsicrimination, s’appliquent au-delà des règlementations sectorielles et y
compris aux exceptions prévues par de telles réglementations dès lors que le
contrat en cause présente un intérêt transfrontalier certain. Cette solution
éclaire le droit français de la commande publique car les principes en cause ne
sont rien d’autre que ceux qui ont justifié l’identification de principes
fondamentaux de la commande publique par le Conseil constitutionnel à la suite
de la jurisprudence Telaustria. Elle
permet de justifier la solution retenue dans le nouveau code de la commande
publique et qui consiste à appliquer ces principes fondamentaux à l’ensemble
des marchés publics et contrats de concession, y compris les « autres
marchés publics » relevant du livre V de la deuxième partie du code. Elle
rejoint également la solution retenue pour les conventions d’occupation du
domaine public qui justifie que les principes fondamentaux de la commande
publique s’appliquent à des contrats qui ne relèvent pas à proprement parler de
la « commande » publique : ces principes sont avant tout des
principes européens qui sont indifférent à la notion française de commande
publique. Pourtant, la Cour de justice n’ignore pas les droits nationaux et
l’affaire en cause l’illustre parfaitement. Elle ne précise pas si le contrat
en cause présente un intérêt transfrontalier certain qui imposerait le respect
d’obligations de transparence : elle renvoie cette appréciation à la Cour
de cassation italienne ce qui signifie que, dans la mise en œuvre des
principes, les juges nationaux ont toujours un rôle fondamental à jouer.
Accès
des PME aux marchés publics en outre-mer
Le décret du 31
janvier 2018 (D. n° 2018-57 pris pour
l’application du troisième alinéa de l’article 73 de la loi n° 2017-256 du 28
février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant
autres dispositions en matière sociale et économique : JORF du 2 février 2018,
texte n° 31 ; Contrats-Marchés publ. 2018, comm. 55, note G. Clamour) est
venu préciser le dispositif expérimental mis en place par la loi du 28 février
2017 pour favoriser l’accès des « petites et moyennes entreprises locales »
aux marchés publics passés par certaines collectivités d’outre-mer. Ce
dispositif doit s’appliquer jusqu’au 31 mars 2023 et favoriser la relance de
l’économie locale en permettant aux acheteurs de réserver à ces entreprises une
partie de leurs marchés publics (la part des marchés réservés peut atteindre au
maximum un tiers des marchés passés à condition que le montant total de ces
marchés ne dépasse pas 15% du montant annuel moyen des marchés du secteur
économique concerné conclus par l’acheteur). Ce dispositif prévoit également
que, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics dont la
valeur estimée est supérieure à 500 000 euros hors taxes, les
soumissionnaires doivent produire dans leurs offres un plan de sous-traitance
indiquant « le montant et les modalités de participation des petites et
moyennes entreprises locales ». Le décret du 31 janvier est cependant décevant
au regard des attentes qui pouvaient être placées dans la loi. Outre le fait
qu’il donne une définition des petites et moyennes entreprises locales dans son
article 3 – en combinant la définition classique des petites et moyennes
entreprises avec une définition du caractère local –, le décret précise surtout
quel doit être le contenu du plan de sous-traitance. Or, sur ce point, les
exigences sont loin des attentes escomptées : le décret ne fixe pas une
part minimale à sous-traiter et il permet aux soumissionnaires de ne pas
prévoir cette sous-traitance en le justifiant. Ainsi, « au slogan de
l’égalité réelle répondent ainsi des mécanismes peinant à embrasser l’étendue
des réalités politiques et économiques locales » (G. Clamour, préc.).
Pour
la Cour de justice, la procédure de délivrance d’un agrément n’est pas un
marché public…même si elle répond à la définition !
Il n’est pas
toujours facile de savoir si l’on se trouve ou non face à un marché public.
Au-delà de la question de la distinction entre les marchés publics et les
contrats de concession – qui repose sur l’existence ou non d’un risque
d’exploitation – la Cour de justice de l’Union européenne a dû se prononcer sur
la qualification à retenir pour des agréments délivrés par une agence
finlandaise (CJUE, 1er mars 2018, aff.
C-9/17, Maria Tirkkonen ; Contrats-Marchés publ. 2018, comm. 101, note M.
Ubaud-Bergeron ; Europe 2018, comm. 191, note S. Cazet). Dans
l’absolu, la question de la qualification ne devrait pas se poser : un
agrément ne devrait pas pouvoir être qualifié de marché public. Pourtant, les
conditions de délivrance de l’agrément posaient de sérieuses difficultés de
qualification.
En l’espèce,
l’Agence finlandaise pour les affaires rurales a lancé une procédure d’appel
d’offres par un avis de marché publié le 16 septembre 2014. Cette procédure a
pour objet la conclusion de contrats portant sur des services de conseil, dans
le cadre du système de conseil agricole Neuvo 2020, pour la période s’étendant
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. Ces contrats s’inscrivent dans le
cadre du programme de développement de la zone rurale de la Finlande
continentale pour la période 2014-2020, pour lequel l’Agence. Cette procédure
prévoit que tous les candidats participant à la procédure d’appel d’offres et
démontrant qu’ils sont qualifiés, régulièrement formés et expérimentés en
qualité de conseillers dans les domaines dans lesquels ils entendent fournir
des conseils seront sélectionnés comme conseillers et pourront prodiguer des
conseils aux agriculteurs avec, en contrepartie, le paiement d’une rétribution
par l’Agence pour les affaires rurales.
Telle qu’elle
est présentée cette procédure semble aboutir à la conclusion de contrats
qualifiables de marchés publics. En effet, les marchés publics sont définis par
les directives comme « des contrats à titre onéreux conclus par écrit
entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs
adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de
produits ou la prestation de services » (article 2 de la directive 2014/24). La procédure d’appel d’offres
aboutissant à la délivrance des agréments semblait donc répondre à cette
définition : la procédure est lancée par un pouvoir adjudicateur, elle
doit aboutir à la conclusion de contrats avec des opérateurs économiques. Ces
contrats ont pour objet des prestations de services et remplissent la condition
d’onérosité dans la mesure où il est prévu que les prestataires conseillers
seront rétribués par l’Agence pour les affaires rurales. La Cour de justice
retient toutefois une solution différente et refuse de qualifier la procédure
de procédure de passation de marchés publics.
Le raisonnement
retenu par la Cour repose sur le fait que la procédure d’appel d’offre n’a pas
pour objet de procéder à une sélection parmi les offres recevables en classant
ces dernières. La procédure doit en effet permettre à l’agence de retenir tous
les candidats qui répondent aux exigences posées et de leur délivrer l’agrément
nécessaire afin de disposer d’un vivier suffisant de conseillers auprès des
agriculteurs. Or, sur ce point, la Cour de justice de l’Union européenne
rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de préciser « que le choix d’une
offre, et donc d’un adjudicataire, constitue un élément intrinsèquement lié à
l’encadrement des marchés publics […] et, par conséquent, à la notion de «
marché public » ». Elle renvoie sur ce point à son arrêt Falk Pharma de
2016 (CJUE, 2 juin 2016, aff. C-410/14,
Falk Pharma : Europe 2016, comm. 285, obs. A. Bouveresse, point 38). En
effet, la Cour considère que « l’absence de désignation d’un opérateur
économique auquel l’exclusivité d’un marché serait accordée a pour conséquence
qu’il n’existe pas de nécessité » d’appliquer les directives relatives aux
marchés publics car il n’y a pas de risque que le pouvoir adjudicateur favorise
les opérateurs nationaux. Le juge en déduit donc que le système de conseil
agricole mis en place ne constitue pas un marché public…au sens des
directives ! Et c’est bien là toute la nuance.
En effet, cela a
été relevé, les contrats conclus répondent à la définition de la notion de
marché public. Ainsi que le relève Marion Ubaud-Bergeron « il y a une
différence significative entre un contrat qui ne relève pas des directives
parce qu’il n’est pas un marché public, et un marché public qui ne relève pas
des directives parce qu’il est conclu dans des circonstances particulières : un
marché public exclu ou dispensé des procédures de passation prévues par les
directives n’échappe pas à tout le droit des marchés publics ! » (M. Ubaud-Bergeron, « Précisions sur la
distinction entre l’agrément et le marché public : la qualification suit la
procédure ? », note sous l’arrêt, préc.). En l’espèce les contrats
passés sont donc des marchés publics mais qui ne sont pas soumis aux règles
spécifiques prévues par les directives en l’absence de risque d’atteintes au
principe de non-discrimination selon la nationalité (car la procédure ne vise
pas à effectuer un choix). On retrouve ici toute la limite de la réglementation
européenne qui peut se trouver écarter lorsqu’il n’existe pas de risques
d’atteintes à la concurrence sur le marché de l’Union. Il s’agit de la même
logique que celle mise en œuvre lorsque la Cour cherche à déterminer si un
marché public présente ou non un intérêt transfrontalier certain pour savoir si
les directives lui sont applicables. Et c’est ce qui lui permet ici de conclure
au fait que la procédure d’agrément n’est pas assimilable à la procédure de
passation d’un marché public au sens des directives.
Une question
reste toutefois en suspens : est-ce que le juge français pourra retenir
une solution identique et sur quel fondement ? En effet, la Cour de
justice justifie sa solution par le fait ques directives européennes n’ont pas
vocation à régir des situations dans lesquelles il n’y a pas de risques de
discriminations au détriment des opérateurs provenant d’autres Etats membres de
l’Union. Certes, mais du point de vue français, le droit de la commande
publique ne s’applique pas uniquement lorsque des discriminations sont
susceptibles de se produire vis-à-vis des opérateurs économiques étrangers.
Ainsi, si « la CJUE se heurte ici aux mêmes interrogations que le droit
français » avec « l’épineuse question des contrats exclus » (M. Ubaud-Bergeron, ibidem), ces
interrogations ne se posent pas de la même manière et la question reste ouverte
sur le fait de savoir si de telles procédures de délivrance d’agréments ne
peuvent pas être assimilées à la passation de marchés publics. En tout cas, le
droit de l’Union européenne ne s’opposerait pas à une telle solution !
Clauses
Molières : le retour ?
Ce n’est pas le
Conseil d’Etat mais la Cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 13 mars 2018, n° 17PA03641 ;
concl. J.-F. Baffray, JCP A 2018, 2132 ; Contrats-Marchés publ. 2018,
comm. 107, obs. H. Hoepffner) qui a dû se prononcer à propos de ce que l’on
qualifie injustement de « clauses Molière » ( sur cette question, v. notamment : Journal du Droit
Administratif (JDA), 2018 ; chronique contrats publics 03 ; Art. 228 ; http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=2282 ). En l’espèce, la Cour devait se prononcer à propos d’une
procédure d’appel d’offres lancée le 22 juin 2016 par le syndicat
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP).
Cette procédure devait permettre au syndicat de sélectionner l’actionnaire
opérateur économique de la société d’économie mixte à opération unique créée
par le syndicat pour l’exploitation de l’usine d’épuration de Seine-Amont. C’est
la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux qui a été sélectionnée pour
un montant de 397 253 586 euros HT sur une période de douze ans. Ce choix a été
validé par une délibération du syndicat en date du 6 juillet 2017. A la suite
de cette procédure, le président du syndicat a signé l’acte d’engagement du
marché d’exploitation de l’usine Seine-Amont le 7 septembre 2017. Le préfet de
la région de la région d’Ile-de-France a saisi le Tribunal administratif de
Paris d’un déféré tendant à l’annulation de ce contrat. Il s’agissait ici d’un recours au fond en
contestation de la validité du contrat, c’est-à-dire d’un recours
Tarn-et-Garonne que le préfet a assorti d’un référé-suspension afin que
l’exécution du contrat ne se poursuive pas en attendant l’examen de l’affaire
au fond. Mécontent de la solution retenue par le tribunal administratif dans
son ordonnance, le Préfet et la société Suez – concurrent évincé dont la
demande d’intervention avait été rejetée – ont interjeté appel auprès de la CAA
de Paris. La question posée à la Cour, outre celle de savoir s’il fallait
admettre l’intervention de la société Suez, portait sur le fait de savoir si le
contenu du règlement de la consultation justifiait ou non la suspension de
l’exécution du marché. Plus précisément, il s’agissait pour la Cour de se
prononcer à propos de l’article 8.5 du règlement de la consultation, intitulé :
« Langue et rédaction de propositions et d’exécution des prestations »,
selon lesquelles : « La langue de travail pour les opérations préalables à
l’attribution du marché et pour son exécution est le français
exclusivement » afin de déterminer si la contrariété potentielle avec les
libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne créait un doute sérieux sur la validité du contrat qui était
susceptible de justifier une suspension de son exécution dans le cadre de la
procédure de référé. Les conclusions du rapporteur public sont, sur ce point,
particulièrement éclairantes. Après s’être référé à la jurisprudence du Conseil
d’Etat (CE, 4 déc. 2017, n° 413366,
Ministre d’État, ministre de l’Intérieur c/ Région Pays de la Loire ;
Contrats-Marchés publ. 2018, repère 1, repère F. Llorens, et P. Soler-Couteaux),
Jean-François Baffray souligne que « la clause du marché litigieux est
extrêmement discriminatoire et contraignante, à la fois à l’égard des
opérateurs de l’UE non francophones, mais aussi pour les sociétés françaises
qui peuvent légalement recourir à des travailleurs non francophones » (préc.). Il considère également que le
vice n’est pas régularisable et qu’il n’existe pas de motifs d’intérêt général
justifiant la poursuite de l’exécution du contrat. Sur tous ces points, la Cour
administrative d’appel va suivre le rapporteur public et prononcer la
suspension de l’exécution du contrat. Surtout, si cet arrêt de Cour
administrative d’appel est intéressant, c’est parce que cette dernière semble
retenir une approche plus stricte des « clauses Molière » que le Conseil d’Etat. Espérons que, poussé
par les juges du fond, ce dernier fera évoluer sa jurisprudence sur ce point
afin de la rendre plus conforme aux exigences du droit de l’Union européenne !
Notion
de pouvoir adjudicateur : les comités d’entreprise et les CHSCT des
pouvoirs adjudicateurs ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs !
Il n’est pas
toujours facile de déterminer si certaines entités relèvent ou non de la notion
de pouvoir adjudicateur. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un
arrêt concernant les CHSCT (Cass. soc.,
28 mars 2018, n° 16-29.106, FS-P+B ; JCP Social 2018, 1169, note L.
Dauxerre) et un avis concernant les comités d’entreprise (Cass. soc., 4 avr. 2018, n° 18-70.002, avis
n° 15005, FS-P+B ; Contrats-Marchés publ. 2018, note M. Ubaud-Bergeron).
Les questions posées étaient proches dans les deux cas car il ne s’agissait pas
de n’importe quels CHSCT ou comités d’entreprises : les structures en
question relevaient de pouvoirs adjudicateurs et il fallait donc déterminer si
elles pouvaient être elles-mêmes qualifiées de pouvoir adjudicateur au sens de
l’article 10, 2° de l’Ordonnance du 23 juillet 2015, c’est-à-dire en tant
qu’organismes de droit public (article 2,
4° de la directive 2014/24/UE). Dans le premier cas – l’arrêt rendu le 28
mars 2018 – il était question du recours à un expert par le CHSCT d’un
établissement public de santé, le Centre hospitalier de Chartres. Mécontent de
la décision du CHSCT de recourir à un expert, le centre hospitalier avait saisi
le président du TGI d’un référé afin qu’il annule cette décision au motif que
le CHSCT aurait dû respecter les dispositions de l’ordonnance du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics, et notamment les principes fondamentaux de la
commande publique. Selon le requérant, le CHSCT d’un établissement public de
santé peut être qualifié de pouvoir adjudicateur. Il considère en effet qu’une
telle entité fait partie des « personnes morales de droit privé qui ont
été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant
un caractère autre qu’industriel et commercial, dont l’activité est financée
majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis à la réglementation des
marchés publics ». La Cour de cassation ne suit cependant pas le centre
hospitalier dans son raisonnement et vient réitérer une solution déjà consacrée
avant la réforme du droit de la commande publique (Cass. soc., 14 déc. 2011, n° 10-20.378; JCP Social 2012, 1102, note
J.-B. Cottin ; RJS 2012, n° 258). Ainsi elle ne rejette pas l’argument
selon lequel le CHSCT d’un acheteur public est bien une personne morale de
droit privée dont l’activité est financée majoritairement par un pouvoir
adjudicateur qui relève du droit de la commande publique, mais elle justifie le
rejet de la qualification d’organisme de droit public au regard de la mission
du CHSCT. La Cour de cassation relève en effet que la mission du CHSCT telle
qu’elle est définie par le code du travail est « de contribuer à la
prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité
des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à disposition par une
entreprise extérieure ». Or, une telle mission ne constitue pas – selon
elle – une mission d’intérêt général, ce qui implique de considérer que le
CHSCT n’est pas un organisme créé « pour satisfaire spécifiquement des besoins
d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ».
Dès lors, les CHSCT ne sont pas des organismes de droit public qualifiables de
pouvoirs adjudicateurs et leurs contrats ne peuvent donc pas être considérés
comme des marchés publics. Cette solution peut paraître désuète si l’on
considère que les CHSCT ont vocation à disparaître mais l’avis rendu le 4 avril
permet d’assurer « sa pérennité » (L. Dauxerre, « L’expertise décidée par le CHSCT d’un centre
hospitalier public n’est pas soumise à l’obligation d’appel d’offres »,
note sous l’arrêt du 28 mars, préc.). En effet, un même raisonnement se
retrouve dans l’avis rendu le 4 avril de cette année. Dans cette seconde
espèce, la Cour de cassation devait se prononcer sur une demande d’avis
transmise par le TGI de Nanterre à propos d’une instance opposant un comité
d’établissement – le comité d’établissement des Etablissements FCES de
Perpignan, de Salle d’Aude et de Gruissan – à la fondation Partage et Vie. La
question posée à la Cour de cassation était ainsi formulée : « Un
comité d’entreprise d’une personne morale, soumise à l’ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en qualité de pouvoir
adjudicateur, est-il considéré comme ayant été créé pour satisfaire
spécifiquement à des besoins d’intérêt général au sens de l’article 10 de
ladite ordonnance ? ». Pour y répondre, la Cour va reprendre le même
raisonnement que celui retenu pour refuser de qualifier les CHSCT de pouvoirs
adjudicateurs. En effet, elle ne s’intéresse pas à la question de savoir si les
comités d’entreprise sont des personnes dont « Soit l’activité est
financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; Soit la gestion est
soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; Soit l’organe
d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont
plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur » (article 10,
2° de l’Ordonnance du 23 juillet 2015). Elle se contente de rappeler qu’
« aux termes de l’article L. 2323-1, alinéa 1, du code du travail, alors
applicable, le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression
collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs
intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique
et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation
professionnelle et aux techniques de production » et que, par conséquent,
« eu égard à la mission du comité d’entreprise définie par cette
disposition, le comité d’entreprise ne relève pas des personnes morales de
droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général
au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d’une
personne morale visée audit article ». L’argumentation retenue apparaît ainsi
comme suffisamment claire : les missions des CHSCT et des comités
d’entreprise empêchent purement et simplement de les envisager comme des
pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils exercent leurs missions au sein
d’une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur… « Lapidaire »
(M. Ubaud-Bergeon, « Les comités
d’entreprises sont-ils des pouvoirs adjudicateurs ? », note sous l’avis du
4 avril 2018, préc.), le raisonnement de la Cour de cassation nous semble
surtout lacunaire. Comme le rappelle Marion Ubaud-Bergeron (ibidem), la Cour de justice de l’Union
européenne retient une définition large de la notion de « besoins
d’intérêt général » (v.
notamment : CJCE, 10 nov. 1998, aff. C-360/96, BFI Holding : Rec CJCE
1998, I, p. 6846, pt 29 ; BJCP 1999, p. 155 ; CJCE, 10 mai 2001, aff.
C-223/99, Agorà et Excelsior : Rec CJCE 2001, I, p. 3626, pt 26. – CJCE, 27
févr. 2003, aff. C-373/00, Adolf Truley, pt 34 : Contrats Marchés publ. 2003,
comm. 94, note G. Eckert ; CJCE, 22 mai 2003, aff. C-18/01, Arkkitehtuuritoimisto
Riitta Korhonen Oy et autres, point 32 : Contrats Marchés publ. 2003, comm.
168, note G. Eckert). Il est donc possible de considérer que, si la
question lui était posée, la Cour de justice de l’Union européenne ne rejetterait
pas si fermement toute possibilité de qualifier ces entités de pouvoirs
adjudicateurs. Surtout, au-delà de la question de savoir quel serait l’avis de
la Cour de justice sur ce point, les solutions retenues interrogent la notion de
« besoins d’intérêt général ». En effet, en refusant de qualifier les
entités en cause de pouvoirs adjudicateurs, la Cour de cassation affirme en
substance que la prévention et la protection de la santé physique et mentale et
de la sécurité des travailleurs ne constituent pas des besoins d’intérêt
général, pas plus que la prise en compte des intérêts collectifs des salariés. Or,
en procédant ainsi le juge judicaire met l’accent sur la notion
de « besoin » en retenant une interprétation restrictive et
erronée de la jurisprudence de la Cour de justice. Dans son avis, elle
considère en effet, citant la décision Adolf Truley comme justification (préc.), que « constituent des
besoins d’intérêt général des besoins que l’État choisit de satisfaire lui-même
ou à l’égard desquels il entend conserver une influence déterminante » (Cass. soc., 4 avr. 2018, n° 18-70.002 (avis
n° 15005, FS-P+B), préc.). Or, la question de l’influence déterminante est
réglée par la seconde partie de l’article 10, 2 de l’Ordonnance et consiste à
vérifier si l’organisme est « contrôlé » par un pouvoir adjudicateur
soit parce que son activité est financée majoritairement par un pouvoir
adjudicateur ; soit parce que sa gestion est soumise à un contrôle de la part
d’un pouvoir adjudicateur ; soit parce que l’organe d’administration, de
direction ou de surveillance de cet organisme est composé de membres dont plus
de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. Pour rappel, la Cour de
cassation n’envisage ces questions ni dans l’arrêt ni dans l’avis car elle
considère que les entités envisagées n’ont pas été créées pour satisfaire
spécifiquement des besoins d’intérêt général. En réalité, ce qui importe dans
la notion de « besoins d’intérêt général » ce n’est pas la notion de
besoins mais celle d’intérêt général. Or, sur ce point, il est plus que
surprenant de constater que les solutions retenues par la Cour de cassation
amènent à considérer que la prévention et la protection de la santé physique et
mentale et de la sécurité des travailleurs ainsi que la prise en compte des
intérêts collectifs des salariés ne constituent pas des activités d’intérêt
général. Il s’agit d’une interprétation particulière de la notion d’intérêt
général qui pourrait laisser à penser que le juge judiciaire envisage de manière
extrêmement restrictive (pour ne pas dire rétrograde) les motifs d’intervention
des personnes publiques. Fort heureusement il s’agit à n’en pas douter de
solutions d’opportunité visant uniquement à éviter que les structures
envisagées échappent aux règles contraignantes de la commande publique !
Impartialité :
une appréciation concrète s’impose !
Le Conseil
d’Etat est venu rappeler le contenu exact du principe d’impartialité, envisagé
comme un principe consubstantiel aux principes fondamentaux de la commande
publique (CE, 12 septembre 2018, n°
420454, Syndicat intercommunal des ordures ménagères de la vallée de
Chevreuse ; JCP A 2018, 2316, note F. Linditch ; AJDA 2018, p. 2246,
note S. Agresta et S. Hul ; Contrats-Marchés publ. 2018, comm. 241, note
M. Ubaud-Bergeron). En l’espèce, le syndicat intercommunal des ordures ménagères
de la vallée de Chevreuse avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour
attribuer un marché public ayant pour objet la collecte des déchets ménagers et
assimilés. A l’issue de la procédure, le syndicat a informé la société Otus, titulaire
d’un précédent marché ayant le même objet, du rejet de son offre pour le lot
n°1 et de l’attribution de ce lot à la société Sepur. La société Otus a alors
saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Versailles.
Ce dernier a annulé la procédure de passation en estimant que la procédure
faisait apparaître des manquements au principe d’impartialité. Pour bien
comprendre le raisonnement retenu, il faut préciser certains faits de l’espèce.
Le syndicat intercommunal avait en effet fait appel à une société pour l’accompagner
dans la rédaction et la passation du marché en cause en lui confiant une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en avril 2017. Or, le chef de projet
qui avait été affecté au projet du syndicat intercommunal a quitté cette
société en décembre 2017 pour rejoindre la société Sepur, qui a finalement été
retenue comme attributaire du lot n°1. Le juge des référés du tribunal
administratif de Versailles a considéré que ces faits faisaient naître un doute
sur l’impartialité de la procédure et justifiaient son annulation. Saisi d’un
pourvoi contre l’ordonnance rendue, le Conseil d’Etat retient une solution
beaucoup plus nuancée qui le conduit à annuler l’ordonnance du juge du référé
précontractuel et rejeter la demande d’annulation de la procédure. Pour cela,
le juge commence par rappeler toute l’importance accordée au principe
d’impartialité en indiquant « qu’au nombre des principes généraux du droit
qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative
figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un
manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ». Il
rappelle en cela sa jurisprudence récente qui semble faire de ce principe l’un
des principes cardinaux du droit de la commande publique (CE, 14 octobre 2015, n° 390968, Région Nord-Pas-de-Calais ; BJCP 2016,
p. 34, concl. G. Pellissier ; Contrats-Marchés publ. 2015, comm. 279, note G.
Eckert). Pour autant, l’application qu’il en fait ensuite démontre que ce
principe n’emporte pas des conséquences trop strictes pour les pouvoirs
adjudicateurs et les entités adjudicatrices. En effet, l’impartialité doit
s’apprécier de manière concrète en fonction des faits de chaque espèce. Ainsi,
le Conseil d’Etat sanctionne le raisonnement extrêmement strict retenu par le
juge des référés en l’espèce alors même que ce dernier avait également relevé
que le chef de projet débauché « n’avait
pas participé à la rédaction du dossier de consultation des entreprises, que sa
mission était cantonnée à la collecte des informations préalables à
l’élaboration de ce dossier, qu’il avait quitté (la) société à la mi-juin 2017
et n’avait rejoint la société Sepur qu’en décembre 2017 ». En réalité,
c’est une appréciation concrète qui s’impose aux juges en matière
d’impartialité (dans le même sens, à
propos de la concession du service de restauration de la Tour Eiffel : TA
Paris, ord., 22 août 2018, n° 183709/4, Sté Excelsis ; Contrats-Marchés
publ. 2018, comm. 252, note G. Eckert). En l’espèce, le Conseil d’Etat
rejette l’argument lié au manque d’impartialité en deux temps. Tout d’abord, il
précise que l’impartialité de l’acheteur ne pouvait être remise en cause qu’à
condition de prouver que la société à laquelle il avait fait appel avait
elle-même manqué d’impartialité dans l’établissement des documents de la
consultation, ce que le juge des référés n’a pas fait en l’espèce. Ensuite, et
surtout, il précise que l’impartialité de l’acheteur public s’apprécie en tant
que telle. Dès lors, le fait que l’employé débauché ait pu faire bénéficier son
nouvel employeur d’informations avantageuses n’indique pas un manque
d’impartialité de l’acheteur public. En somme, pour le Conseil d’Etat,
l’acheteur n’y est pour rien et la situation ne doit donc pas pouvoir lui être
reprochée ! Le respect objectif de la concurrence ne s’impose donc pas de
manière systématique et les acheteurs restent relativement protégés lorsqu’ils
mènent de bonne foi leurs procédures de passation.
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2019 ; chronique contrats publics 04 ; Art. 236.