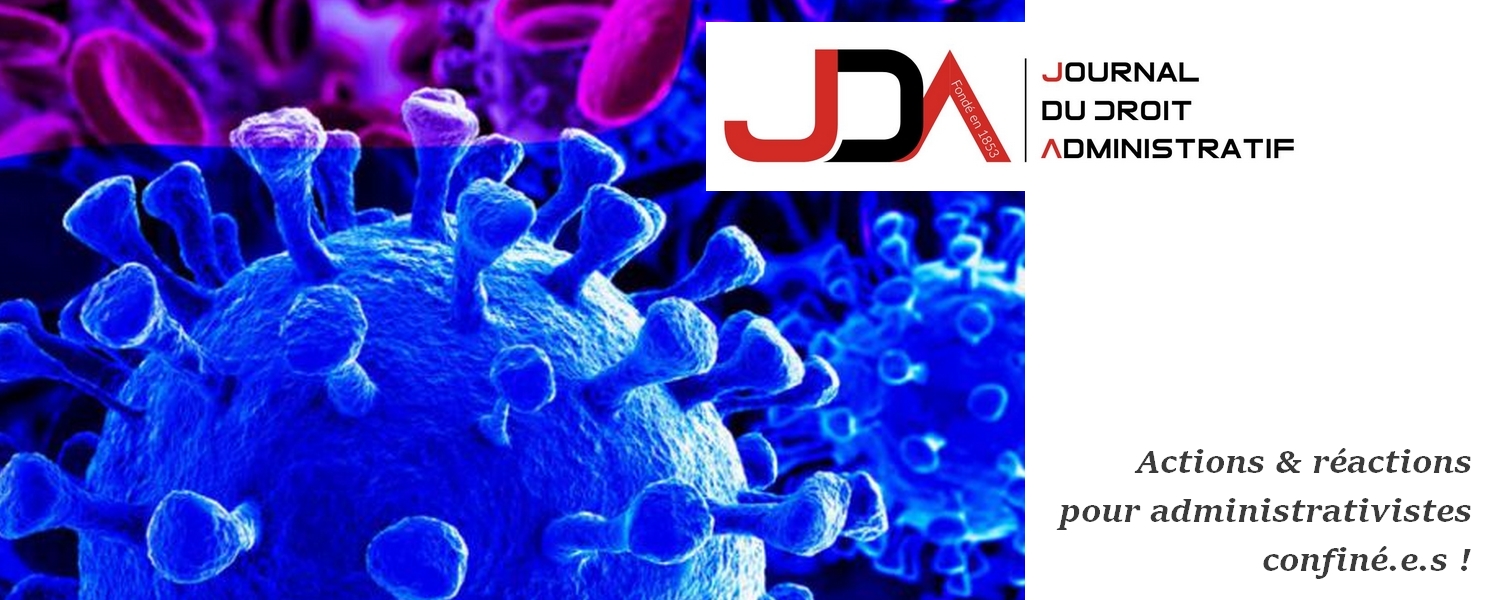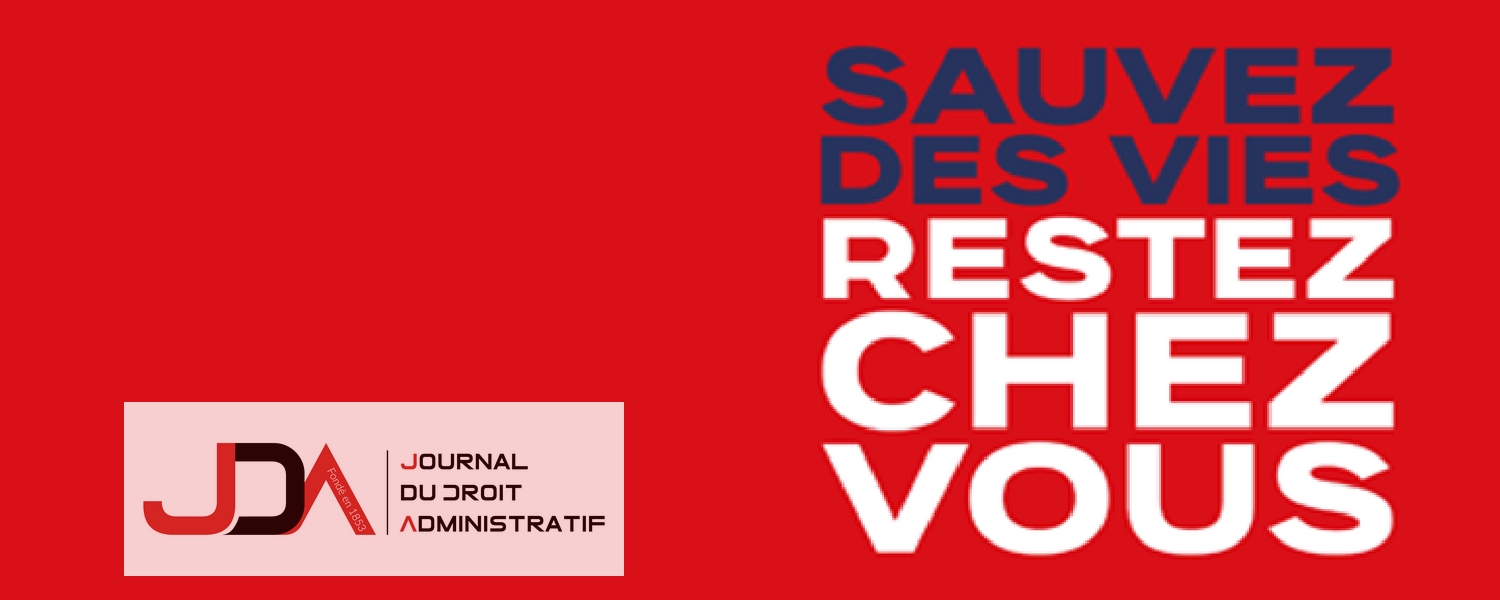Maître de conférences HDR de droit public,
Université Toulouse 1 Capitole, IEJUC
Art. 282. Contribution réalisée dans le cadre des « actions & réactions (du JDA et au COVID-19) pour administrativistes confiné.e.s » :
La commande publique
face au COVID-19 :
dans l’attente de mesures réellement efficaces
L’épidémie de COVID-19 – et les mesures adoptées pour y faire face – affecte l’économie dans son ensemble. Les contrats de la commande publique ne sont pas épargnés par ce phénomène et de nombreuses questions se posent face aux bouleversements actuels.
La théorie générale des contrats administratifs (pour les contrats de la commande publique qualifiables comme tels) et les règles particulières applicables à ces contrats – qu’elles soient prévues par le Code de la commande publique, par les cahiers des clauses administratives générales ou par les contrats eux-mêmes – permettent de faire face aux difficultés rencontrées lors de la passation ou de l’exécution des contrats de la commande publique. Il n’est pas possible d’envisager toutes les règles et tous les mécanismes susceptibles d’être mis en œuvre pour faire face aux aléas lors de la passation ou de l’exécution des contrats de la commande publique mais, au regard des évènements actuels et des dispositifs qui pourraient être mis en place, un rappel s’impose pour certains d’entre eux.
En temps normal – c’est-à-dire en période ordinaire par opposition à l’état d’urgence sanitaire dans lequel nous nous trouvons désormais placés et qui a conduit à l’adoption de règles spécifiques (v. infra) – l’inexécution ou la mauvaise exécution des contrats peut entraîner le prononcé de sanctions. Il peut s’agir de sanctions pécuniaires, de sanctions coercitives, ou de sanctions résolutoires.
A priori, le champ d’application des sanctions pécuniaires semble restreint car elles ne peuvent être prononcées que si elles ont été prévues par les clauses du contrat. Toutefois, en pratique, elles sont généralement prévues soit directement par les clauses du contrat, soit indirectement par renvoi aux cahiers des clauses administratives générales, lesquels organisent la mise en œuvre des sanctions pécuniaires (chaque CCAG précise ainsi selon quelles modalités l’acheteur peut être amené à prononcer des pénalités pour retard). Les sanctions pécuniaires permettent ainsi d’obtenir des dommages et intérêts qui permettent de réparer le préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat.
Les sanctions coercitives poursuivent quant à elles un objectif différent : elles permettent à l’acheteur d’obtenir l’exécution correcte des obligations contractuelles en cas de défaillance du titulaire du contrat. Il s’agit d’un « pouvoir de substitution totale ou partielle aux frais et risques du cocontractant (qui) conduit l’administration soit à reprendre l’activité en régie directe, c’est-à-dire l’assurer avec ses propres moyens, soit à se substituer à l’autorité du chef d’entreprise sur ses salariés et son outil de travail, soit à confier l’exécution à une entreprise tierce » H. Hoepffner, Droit des contrats administratifs, Dalloz, 2e éd. 2019, p. 499, n°554). Les différents Cahiers des clauses administratives générales prévoient et organisent l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire « soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire ». Pour autant, le Conseil d’Etat considère que la mise en régie ou la passation d’un marché de substitution constitue une règle générale applicable aux contrats administratifs, ce qui signifie qu’elle « peut être prononcée même en l’absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément » et que « les personnes publiques ne peuvent légalement y renoncer » (CE, ass., 9 novembre 2016, Société Fosmax, n°388806 ; précisé par CE, 14 févr. 2017, Société de manutention portuaire d’Aquitaine, n° 405157).
La dernière catégorie de sanctions qui peuvent être prononcées correspond aux sanctions résolutoires. Elles correspondent à la résiliation pour faute, laquelle se distingue de la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général. Le Code de la commande publique (CCP, art. L. 6, 5°) prévoit en effet que « l’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code », tout en indiquant que « lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ». Parmi les différentes hypothèses de résiliation, la résiliation-sanction – qui correspond aux sanctions résolutoires – est prévue par les articles L. 2195-3 et L. 3136-3 qui permettent aux acheteurs et aux autorités concédantes de résilier le contrat « en cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ». Ce pouvoir de résiliation pour faute existe en-dehors de toute disposition textuelle (CE, 30 septembre 1983, Société Comexp, n°26611. ; CE, 12 novembre 2015, n° 387660, Société le jardin d’acclimatation, n°387660) mais – en plus des dispositions du Code précitées – les Cahiers des clauses administratives générales prévoient la résiliation pour faute, notamment lorsque « le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ».
D’autres règles ou mécanismes que l’on qualifiera de généraux permettent d’assurer la bonne exécution des contrats de la commande publique, de sanctionner leur mauvaise exécution ou d’assurer la stabilité et la continuité des relations contractuelles en dépit des difficultés rencontrées lors de l’exécution du contrat.
Ainsi, en cas de mauvaise exécution des obligations contractuelles par l’un ou l’autre des cocontractants, leur responsabilité contractuelle peut toujours être engagée. Une inégalité demeure de ce point de vue entre les cocontractants : alors que l’administration contractante peut user de son privilège du préalable en exigeant directement de son cocontractant le versement de dommages-intérêts (sous le contrôle du juge mais sans avoir à saisir ce dernier) ; le titulaire du contrat ne peut engager la responsabilité contractuelle de l’administration qu’en passant par le juge (en ce sens, et pour davantage d’explications, v. H. Hoepffner, Droit des contrats administratifs, Dalloz, 2e éd. 2019, p. 484 et s., spéc. n°535). Par ailleurs, la théorie de l’imprévision peut jouer lorsque des évènements imprévisibles et extérieurs aux parties entraînent un bouleversement de l’économie du contrat : le titulaire du contrat est alors tenu de poursuivre son exécution mais pourra bénéficier d’une indemnité d’imprévision (CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Lebon 125). La théorie cessera de s’appliquer une fois les évènements passés si l’équilibre contractuel est retrouvé. A défaut d’un retour possible à la normale – c’est-à-dire si le bouleversement est définitif – l’administration pourra résilier le contrat pour force majeure. Dans le même sens, mais pour les seuls marchés publics de travaux, la théorie des sujétions techniques imprévues permet de faire face aux « difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution du marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties » (CE, 30 juillet 2003, Commune de Lens, n°223445, Lebon T. p. 862). Si les conditions sont réunies, les charges supplémentaires supportées par le titulaire du contrat afin de poursuivre son exécution devront être indemnisées. De plus, la théorie du fait du Prince peut trouver à s’appliquer lorsque l’autorité contractante adopte des mesures « en vertu de pouvoirs autres que ceux qu’elle détient du contrat » (F.-P. Bénoît, Le droit administratif français, Dalloz 1968, n°1136). Si ces mesures n’étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat, qu’elles affectent l’objet ou l’équilibre du contrat et qu’elles entraînent un préjudice anormal et spécial pour le cocontractant, ce dernier aura le droit d’être indemnisé. Enfin, et sous certaines conditions, la force majeure peut être invoquée pour faire face aux difficultés rencontrées lors de l’exécution du contrat. Il faut, dans ce cas, distinguer la force majeure comme cause exonératoire de la responsabilité contractuelle de la force majeure administrative, laquelle ne trouve à s’appliquer que dans le cadre de la théorie de l’imprévision lorsque le retour à l’équilibre du contrat est impossible (sur ces questions, v. not. H. Hoepffner, Droit des contrats administratifs, préc., p. 651 et s., n°731 à 737). Depuis l’adoption des mesures de confinement liées à la pandémie, c’est la force majeure « ordinaire » qui est généralement mise en avant, comme en témoigne la fiche publiée par la Direction des affaires juridiques de Bercy le 18 mars dernier (https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/fiche-passation-marches-situation-crise-sanitaire.pdf ). Elle suppose que l’évènement à l’origine des difficultés soit imprévisible, extérieur aux parties et qu’il soit irrésistible (conditions posées par le commissaire du gouvernement Tardieu dans ses conclusions sur CE, 29 janvier 1909, Compagnie des messageries maritimes, D. 1910, 3, 89). La reconnaissance de la force majeure permet aux parties d’être libérées de leurs obligations contractuelles : cela peut concerner le contrat dans son ensemble ou seulement une partie de celui-ci. Les conséquences de la force majeure dépendent de chaque situation : elle peut conduire à la résiliation du contrat ou neutraliser la mise en œuvre des sanctions contractuelles précédemment évoquées. Si la mise en œuvre de la force majeure ne nécessite pas de reposer sur un texte, les Cahiers des clauses administratives générales précisent les conséquences de la force majeure et les contrats eux-mêmes peuvent contenir des clauses sur ce point.
Enfin, et sans prétendre à l’exhaustivité, il faut relever que plusieurs dispositions du Code de la commande publique permettent d’adapter la passation et l’exécution des contrats pour faire face à des situations exceptionnelles. Ainsi, s’agissant de la passation des contrats, le Code permet la conclusion de marchés sans publicité ni mise en concurrence dans différentes hypothèses liées à l’objet du contrat, à son montant ou à la qualité de l’acheteur. Parmi elles, il et ici utile de rappeler que les acheteurs peuvent passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables « lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures » qui ne pouvaient pas être prévues par les acheteurs ne permettent pas « de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées » (CCP, art. R. 2122-1). Il est également possible de passer de tels marchés « lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé » pour des raisons techniques (CCP, art. R. 2122-3, 2°). Par ailleurs, s’agissant de l’exécution des contrats, le Code de la commande publique envisage différentes hypothèses de modifications autorisées (CCP, art. L. 2194-1, L. 3135-1, R. 2194-1 à R. 2194-10 et R. 3135-1 à R. 3135-10). Or, parmi les modifications autorisées, il est permis de modifier le contrat « lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir » (CCP, art. R. 2194-5 et R. 3135-5). Enfin, comme précédemment évoqué, le Code prévoit et organise les différentes hypothèses dans lesquelles il est possible de résilier le contrat. Parmi elles, on retrouve la résiliation en cas de force majeure (CCP, art. L. 2195-2 et L. 3136-2), la résiliation pour faute grave (CCP, art. L. 2195-3, 1° et L. 3136-3, 1°), la résiliation pour motif d’intérêt général (réservée aux contrats administratifs : CCP, art. L.6, L. 2195-3, 2° et L. 3136-3, 2°), ou encore la résiliation prononcée « lorsque l’exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions » du Code (CCP, art. L. 2195-6 et L. 3136-6).
L’ensemble des règles présentées visent ainsi à protéger les acheteurs et les autorités concédantes dans leurs relations contractuelles, mais aussi leurs cocontractants, c’est-à-dire les candidats à l’attribution des contrats ainsi que les titulaires des marchés publics et des contrats de concession. Elles reposent sur des considérations liées au but de service public ou d’intérêt général poursuivi par les personnes publiques contractantes, sur les principes fondamentaux de la commande publique parmi lesquels on retrouve notamment l’objectif de bonne utilisation des deniers publics (CCP, art. L. 3), mais aussi sur des considérations qui s’inscrivent davantage dans une logique contractuelle et qui doivent permettre le maintien de l’équilibre du contrat.
Actuellement, les fermetures d’établissements, le manque de personnel lié au confinement, les difficultés d’approvisionnement (notamment lorsque les fournitures proviennent de l’étranger) et les conséquences pratiques des mesures adoptées par le gouvernement pour endiguer la propagation du COVID-19 mettent en péril la bonne exécution des contrats passés. Dans le même sens, la crise sanitaire actuelle suppose la passation de contrats de la commande publique spécifiques, en particulier pour répondre aux besoins des services de santé. Ainsi, l’achat de masques de protection ou de gels hydroalcooliques suppose la passation de marchés publics de fournitures, que ces achats soient effectués par l’Etat, les établissements publics hospitaliers ou encore par les collectivités territoriales.
L’exécutif n’ignore pas les problématiques spécifiques rencontrées pour la passation et – surtout – pour l’exécution des contrats de la commande publique en cette période de crise sanitaire. Il cherche à répondre aux difficultés rencontrées en utilisant deux moyens. Tout d’abord, il fait appel à la réglementation existante – au droit de la commande publique « ordinaire » – pour pallier les difficultés rencontrées. Dans ce cadre, c’est le droit souple qui est mobilisé : c’est le cas de la fiche précédemment évoquée et publiée le 18 mars par la DAJ, mais également d’autres fiches fournies par le ministère de l’économie (v. not. la fiche sur les mesures de soutien apportées aux entreprises publiée le 25 mars 2020 : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf ). Ensuite, l’exécutif a obtenu de pouvoir intervenir par ordonnance pour adapter le droit de la commande publique (art. 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF du 24 mars 2020). C’est désormais chose faite avec l’adoption de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de COVID-19 (JORF n°0074 du 26 mars 2020).
Afin de répondre aux questions et craintes exprimées tant par les acheteurs et les autorités concédantes que par les opérateurs économiques titulaires de contrats ou candidats à leur attribution, il est nécessaire de questionner l’efficacité des deux catégories de dispositifs mobilisés par le Gouvernement pour faire face aux conséquences de l’épidémie. C’est donc tant le droit de la commande publique « ordinaire » que le droit de la commande publique « dérogatoire » qui mérite d’être questionné.
Le droit de la commande publique « ordinaire » face au COVID-19 : un droit teinté d’incertitudes
Il ne s’agit pas ici d’expliquer que le droit de la commande publique « ordinaire », entendu comme le droit de la commande publique applicable avant l’adoption de l’Ordonnance du 25 mars 2020, ne permet pas de répondre aux problématiques résultant des mesures adoptées pour lutter contre la propagation du COVID-19. Au contraire, et ainsi que cela a été (brièvement ou trop longuement) rappelé en introduction, le droit de la commande publique comprend de nombreux dispositifs qui permettent d’adapter la passation et l’exécution des contrats aux difficultés extérieures à celui-ci. L’enjeu est alors de savoir comment les dispositifs présentés peuvent être mis en œuvre et si cette mise en œuvre est teintée ou non de sécurité juridique pour les acheteurs, les autorités concédantes et les opérateurs économiques candidats ou cocontractants. Pour tenter de répondre à ces interrogations, et sans prétendre ici non plus à l’exhaustivité, il convient de revenir sur les règles présentées et d’envisager leur mise en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.
Avant d’aborder la question centrale liée à l’adoption des sanctions et à la possible mise en avant de la force majeure comme cause exonératoire de la responsabilité, il est possible de rappeler quelles sont – parmi les règles du droit des contrats publics évoquées – celles qui peuvent réellement ou potentiellement être mobilisées.
Au sein des composantes de la théorie générale des contrats administratifs, la théorie de l’imprévision pourrait potentiellement trouver à s’appliquer lorsque la crise actuelle entraîne un bouleversement de l’économie des contrats en cours. Il est en effet possible, pour certains contrats en cours, que la crise augmente le coût de réalisation des travaux, des fournitures livrées ou des services prestés. Qu’on songe également, dans le cadre des contrats de concession, aux pertes d’exploitation liées au confinement. Il faut toutefois appeler à une forme de prudence s’agissant de la mise en œuvre de la théorie de l’imprévision. Tout d’abord parce qu’il faut s’assurer que les conditions de sa mise en œuvre sont bien réunies, notamment le fait de savoir si l’ampleur des bouleversements subis par l’économie du contrat sont suffisamment importants. Ensuite, et peut-être surtout, parce que certains contrats contiennent « des clauses de révision (d’imprévision, d’actualisation ou de hardship) permettant soit d’adapter directement le contrat, soit de fixer les conditions et les procédures d’une révision différée » (H. Hoepffner, Droit des contrats administratifs, préc., p. 643, n°722). Or, la présence de telles clauses empêche la reconnaissance d’un bouleversement de l’économie du contrat initial… Sous ces réserves, la théorie de l’imprévision pourrait toutefois trouver à s’appliquer. En revanche, la théorie des sujétions techniques imprévues ne semble pas pouvoir jouer face à la crise sanitaire. Elles sont en effet définies comme des « difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution du marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties » (CE, 30 juill. 2003, Commune de Lens, préc.). Pour qu’elle puisse jouer, il faudrait démontrer que la crise sanitaire entraîne de telles difficultés techniques ou matérielles : ce n’est pas impossible mais cela reste assez improbable. Pour autant, la question pourrait se poser de savoir si constituent des sujétions techniques imprévues les mesures sanitaires que les titulaires de marchés de travaux publics doivent désormais respecter s’ils poursuivent l’exécution de leurs contrats dans cette période de crise (distance de sécurité, mesures de désinfection, nombre limité d’ouvriers sur les chantiers…). La porte reste donc entrouverte mais ce n’est pas nécessairement la plus facile à emprunter ! Celle ouverte par la théorie du fait du Prince ne devrait pas être plus facile à ouvrir. En effet, en retenant la définition la plus stricte de cette théorie il faut que les mesures soient adoptées par l’autorité contractante n’agissant pas en tant que partie au contrat : ainsi, seuls les contrats passés par l’Etat pourraient être concernés par la mise en œuvre de cette théorie. De plus, parmi les conditions posées pour la mise en œuvre de la théorie du fait du Prince et précédemment rappelées il faut que le cocontractant subisse un préjudice anormal et spécial pour pouvoir être indemnisé. Or, dans la période actuelle, les mesures adoptées ne concernent pas des opérateurs économiques particuliers mais le pays dans son ensemble ou des secteurs économiques dans leur globalité. Il n’est donc pas conseillé d’indiquer aux opérateurs économiques qu’ils pourraient sortir du tunnel en empruntant la porte du fait du Prince. Ainsi, les composantes de la théorie générale des contrats administratifs semblent difficilement mobilisables, exception faite de la force majeure sur laquelle nous reviendrons.
Les possibilités offertes par le Code de la commande publique semblent plus facilement mobilisables. Ainsi, les dispositions permettant la conclusion de marchés sans publicité ni mise en concurrence peuvent, pour certaines d’entre elles, permettre de répondre aux besoins créés par la crise sanitaire (v. supra en introduction). De la même manière, et à condition de remplir les conditions posées par le Code, les cocontractants doivent pouvoir modifier leurs contrats pour faire face à la crise : il est évident que cette dernière fait partie « des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir » (CCP, art. R. 2194-5 et R. 3135-5). Cela confirme d’ailleurs que les modifications autorisées par cet article ne recoupent que partiellement et imparfaitement les théories de l’imprévision, des sujétions techniques imprévues et du fait du Prince. Il est en effet plus facile de s’appuyer sur le Code et sur les conditions qu’il pose pour admettre la modification des contrats que sur les théories classiques dont les conditions de mise en œuvre restreignent la portée. La résiliation des contrats, notamment lorsque la modification du contrat ne peut pas être effectuée conformément aux dispositions du Code, est également une hypothèse envisageable pour les acheteurs et les autorités concédantes dans la période actuelle (v. supra). Enfin, il faut également préciser que certaines dispositions du Code permettent d’adapter les procédures de passation en cas d’urgence. Ainsi, dans le cadre des procédures formalisées, les délais de réception des candidatures et des offres peuvent être réduits en cas « d’urgence, dûment justifiée » (CCP, art. R. 2161-3 pour la procédure d’appel d’offres ouvert ; des dispositions comparables existent pour les autres procédures). Il est aussi possible, dans le cadre des procédures en cours, d’envisager un report des délais de remise des candidatures et des offres (en ce sens, v. A. Villalard, « Coronavirus et marchés publics [3/5] : quid des procédures de passation en cours ? », Le Moniteur fiche pratique du 20 mars 2020, https://www.lemoniteur.fr/article/coronavirus-et-marches-publics-3-4-quid-des-procedures-de-passation-en-cours.2081666 ). Toutefois, s’agissant des procédures en cours, le Code offre une solution plus sécurisante en permettant de les déclarer sans suite (CCP, art. R. 2185-1, R. 2185-2 et R. 3125-4).
Toutefois, parmi les questions posées par les acteurs de la commande publique, et en particulier par les cocontractants titulaires de marchés publics ou de contrats de concession, la crainte de sanctions prononcées par les acheteurs et les autorités concédantes figure au premier plan. En effet, la mauvaise exécution ou l’inexécution des obligations contractuelles peut conduire au prononcé de sanctions, notamment en cas de non-respect des délais d’exécution prévus par le contrat. Cela a été souligné, les sanctions peuvent être pécuniaires, coercitives ou résolutoires. Il convient donc de déterminer si l’inexécution ou les retards dans l’exécution liés à l’épidémie de COVID-19 peuvent amener les autorités contractantes à prononcer de telles sanctions et si leurs cocontractants peuvent espérer y échapper. En principe l’inexécution ou le retard dans l’exécution justifie le prononcé de sanctions mais, tant les règles générales applicables aux contrats administratifs que les règles spécifiques prévues par les CCAG et par les contrats eux-mêmes peuvent permettre d’y échapper. C’est ce qu’explique la fiche de la DAJ qui met l’accent sur la possibilité d’invoquer la force majeure comme cause exonératoire de responsabilité. Il faut de ce point de vue distinguer les règles générales applicables en la matière et les règles plus spécifiques prévues par les CCAG qui précisent le régime juridique applicable pour les marchés publics qui s’y réfèrent.
De manière générale, la reconnaissance d’un cas de force majeure interdit à l’autorité contractante d’appliquer des pénalités de retard (CE, 29 janvier 1909, Compagnie des messageries maritimes, préc.) ou de prononcer des sanctions pour inexécution (CE, 29 janvier 1958, Bonadeau, Lebon 50). Cette limite apportée au pouvoir de sanction de la personne publique contractante est en partie confirmée et précisée par certains CCAG. Ainsi s’agissant des pénalités de retard, ces derniers prévoient la possibilité pour le titulaire du contrat de bénéficier d’une prolongation du délai d’exécution – et donc d’échapper aux pénalités de retard – lorsqu’il « est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure » (CCAG Fournitures courantes et services, art 13.3, 14.1 et 20.4 ; CCAG-PI, art. 13.3, 14.1 et 22.4 ; CCAG-TIC, art. 13.3, 14.1 et 20.4 ; CCAG Marchés industriels, art. 14.3, 15.1 et 27.4). Pour autant, des conditions sont posées et cette prolongation n’est donc pas automatique : elle suppose une demande de la part du titulaire du marché dans un délai de quinze jours à compter de l’apparition des causes rendant impossible le respect des délais et son acceptation par l’acheteur. Dès lors, la question est de savoir si la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 constitue ou non un cas de force majeure.
La fiche publiée par la DAJ précise que les conditions d’imprévisibilité et d’extériorité sont remplies : ce constat n’est pas réellement discutable mais des précisions méritent d’être apportées. S’agissant tout d’abord de la condition d’imprévisibilité, la date de conclusion du contrat pourrait conduire à nuancer l’affirmation selon laquelle cette condition serait automatiquement remplie. Il est vrai que les parties aux contrats de la commande publique ne pouvaient effectivement pas prévoir l’existence de la pandémie, son étendue, ou ses conséquences. Toutefois, la question de l’imprévisibilité pourra se poser pour les contrats conclus au tout début de la crise sanitaire, avant l’annonce des mesures gouvernementales imposant le confinement. Il est peu probable qu’une interprétation stricte soit retenue compte tenu des circonstances actuelles mais il convient de nuancer les affirmations du gouvernement sur ce point. Surtout, le caractère imprévisible ne pourra pas être retenu pour les contrats conclus après l’adoption des mesures gouvernementales visant à lutter contre la pandémie : les contrats actuellement conclus ne pourront pas bénéficier de la force majeure. Factuellement, ces contrats seront peu nombreux et devraient être passés selon des procédures dérogatoires en prenant en compte la pandémie (il est possible de relever la publication de plusieurs appels d’offres au BOAMP visant à acquérir des masques ou du gel hydroalcoolique mais ils correspondent à des procédures engagées avant le début du confinement). La condition d’extériorité est également assez peu discutable : la propagation du virus n’est pas liée aux parties aux contrats de la commande publique. Avec une certaine mauvaise foi, il serait possible de questionner cette condition pour les contrats passés par l’Etat : si l’impossibilité d’exécuter les prestations objet du contrat résulte non de la propagation du virus mais des mesures imposées par l’Etat (confinement, interdiction des réunions, distances de sécurité…), est-ce que cela ne remet pas en cause la condition d’extériorité ? Une telle interprétation nous semble toutefois très peu probable.
Dès lors, la reconnaissance de la force majeure s’agissant de la crise sanitaire actuelle dépend avant tout de la condition d’irrésistibilité. Celle-ci implique de démontrer que le contractant se trouve dans l’impossibilité de continuer à exécuter le contrat : si l’impossibilité d’exécuter le contrat est temporaire, cela permettra de neutraliser les sanctions contractuelles sous réserve des dispositions du CCAG applicable au contrat ou du contrat lui-même ; si elle est définitive, cela conduira à sa résiliation. En effet, lorsque le titulaire du marché se trouve dans l’impossibilité absolue de poursuivre l’exécution du contrat en raison du cas de force majeure, le contrat est résilié de plein droit (CE, 7 août 1926, Bouxin, Lebon 891). Cette résiliation pour force majeure est également prévue par les CCAG, lesquels précisent que « lorsque le titulaire est mis dans l’impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché » (CCAG Fournitures courantes et services, art. 31.1 ; CCAG-PI, art. 31.1 ; CCAG-TIC, art. 41.1 ; CCAG Marchés industriels, art. 36.1). La résiliation pour force majeure est également – cela a été évoqué – envisagée par le Code de la commande publique (CCP, art. L. 2195-2 et L. 3136-2). Or, dans la mesure où l’appréciation de la force majeure doit s’effectuer au cas par cas, il n’est pas possible de considérer que la condition d’irrésistibilité sera systématiquement considérée comme remplie. La fiche de la DAJ (préc.) confirme cette incertitude. Elle précise à propos de cette condition qu’il « convient de vérifier si la situation résultant de la crise sanitaire actuelle, notamment le confinement, ne permet effectivement plus au prestataire de remplir ses obligations contractuelles », tout en indiquant que « comme le demande le Gouvernement, il est recommandé aux acheteurs publics, eu égard au caractère exceptionnel de la crise, de ne pas hésiter à reconnaître que les difficultés rencontrées par leur cocontractants sont imputables à un cas de force majeure ». Le ministre de l’économie a également appelé les acheteurs publics dans leur ensemble à reconnaître l’existence d’un cas de force majeure et la fiche du 25 mars reprenant les mesures de soutien et les contacts à destination des entreprises va plus loin : elle affirme dans son point 9 que l’Etat et les collectivités locales reconnaissent le « Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics » (préc.). La question demeure donc posée de savoir si tous les acheteurs publics considèreront que les conditions de la force majeure sont réunies pour l’ensemble de leurs marchés publics. Elle se pose avec davantage d’acuité encore lorsque l’on sait que, parallèlement à la publication des fiches évoquées, le gouvernement appelle notamment les entreprises du BTP à poursuivre leurs activités : est-ce à dire que les marchés publics de travaux ne sont pas concernés par la force majeure ? Sur ce point, comme sur d’autres, les mesures gouvernementales manquent évidemment de clarté. Par ailleurs, même si les conditions nécessaires pour identifier un cas de force majeure sont considérées comme remplies, il convient pour les opérateurs économiques de rester vigilants : si leurs contrats contiennent des clauses spécifiques qui organisent la mise en œuvre de la force majeure ou s’ils renvoient à un CCAG qui organise sa mise en œuvre, il convient de respecter les conditions posées (notamment les délais et conditions imposés par certains CCAG et précédemment évoqués pour pouvoir bénéficier d’une prolongation du délai d’exécution et éviter le prononcé de pénalités de retard).
Les incertitudes liées à la mise en œuvre de la force majeure expliquent une partie des dispositions contenues dans l’Ordonnance du 25 mars 2020, c’est-à-dire dans le droit « dérogatoire » de la commande publique. Ce texte cherche ainsi à encadrer et à limiter le recours aux sanctions, qu’elles soient pécuniaires, coercitives ou résolutoires, tout en cherchant à adapter le droit de la commande publique, avec plus ou moins de succès.
Le droit de la commande publique « dérogatoire » face au COVID-19 : une réaction épidermique ?
La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à adopter « toute mesure […] relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution » (art. 11 de la loi n°2020-290, préc.). Or, parmi les domaines dans lesquels des ordonnances peuvent être adoptées « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi » (art. 11, 1°), le droit de la commande publique est envisagé. Il est en effet prévu que le Gouvernement peut adopter par ordonnance toute mesure « adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet » (art. 11, 1°, f) de la loi). C’est sur ce fondement que l’Ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 a été adoptée (préc.).
En tant que telles, les dispositions de la loi n’appellent pas de commentaires particuliers dans la mesure où elles renvoient à l’adoption d’ordonnances. Il est toutefois possible de relever deux points d’attention. Le premier concerne le champ d’application des mesures qui peuvent être adoptées. En effet, la loi vise à la fois le « droit de la commande publique » et les « contrats publics », ce que confirme l’Ordonnance à la fois dans son intitulé et dans son article 1er. Or, la notion de « contrat public » n’est ni reconnue, ni définie en droit français. Envisagée comme une notion regroupant l’ensemble des contrats passés par les personnes de la sphère publique ou du secteur public, elle permet de dépasser la notion de commande publique (sur ces questions, v. not. M. Amilhat, La notion de contrat administratif. L’influence du droit de l’Union européenne, Bruylant 2014 ; M. Amilhat, « Le Code, les principes fondamentaux et la notion de commande publique. Une copie à revoir ? », AJDA 2019, p. 793). La loi du 23 mars et l’Ordonnance du 25 mars ne définissent pas la notion de contrat public utilisée mais, en y ayant recours, elles confirment le caractère étriqué et insatisfaisant de la notion de commande publique consacrée par le Code il y a tout juste un an… Le second point d’attention porte sur une différence entre le droit privé et le droit public des contrats dans le cadre de la loi d’habilitation. En effet, s’agissant du droit privé, le gouvernement a été habilité à intervenir pour modifier « dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs » (art. 11, 1°, c) de la loi). Or, s’agissant des contrats publics, l’habilitation ne prévoit pas un tel « respect des droits réciproques ». Est-ce à dire qu’il n’existe pas des droits réciproques dans les contrats publics ? Ou que le gouvernement peut adopter des mesures concernant les contrats publics qui désavantageraient davantage l’un des cocontractants ? Il reste néanmoins possible que cette différence n’ait aucune conséquence mais elle maintient le sentiment selon lequel il existerait une différence de nature entre contrats privés et « contrats publics ».
En réalité, ce sont donc les dispositions de l’Ordonnance du 25 mars qui méritent une attention particulière. Ce texte est relativement court et ne comporte que 8 articles, les deux derniers étant consacrés à son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (art. 7), et à sa mise en œuvre sous la responsabilité du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances (art. 8). Il n’en suscite pas moins un certain nombre d’interrogations (sur cette question, v. la présentation d’Hicham Rassafi-Guibal, « Crise sanitaire et contrat administratif » dans le cadre du colloque virtuel Droit et coronavirus: https://www.youtube.com/watch?v=MliJMF73z74 ).
Le premier article de l’Ordonnance détermine son champ d’application matériel et temporel. Du point de vue matériel, le texte s’applique « aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas ». La première catégorie de contrats ne pose pas de difficultés : il s’agit de ceux qualifiables de marchés publics ou de contrats de concession qui relèvent du Code de la commande publique. Pour rappel, il s’agit des « contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques » (CCP, art. L. 2). Sont en revanche exclus du champ d’application du Code, « les contrats de travail » ainsi que « les contrats ou conventions ayant pour objet […] des transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs ou entre autorités concédantes en vue de l’exercice de missions d’intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles », les contrats ou conventions de subvention, ainsi que les contrats ou conventions d’occupation domaniale (CCP, art. L. 1100-1). Les contrats soumis au Code de la commande publique paraissent ainsi assez facilement identifiables, ce qui n’est pas le cas pour la seconde catégorie de contrats visée. En effet, et ainsi que cela a été souligné (v. supra), la notion de contrat public n’est définie ni par l’Ordonnance du 25 mars, ni par la loi d’habilitation, ni par aucun autre texte en droit français. La formulation retenue permet toutefois de considérer que la notion de contrat public englobe celle de « contrats soumis au code de la commande publique » et la dépasse. Il est difficile de déterminer avec précision quels sont les contrats concernés : il devrait selon nous s’agir de l’ensemble des contrats passés par des personnes de la sphère publique mais il est possible que la définition soit plus restreinte, en particulier s’il est fait appel à un critère matériel de définition. A minima, il semble possible de considérer que les contrats exclus du champ d’application du Code par l’article L. 1100-1 doivent être considérés comme des contrats publics non soumis au Code mais soumis aux dispositions de l’Ordonnance du 25 mars (en particulier les conventions de subvention et d’occupation domaniale). Du point de vue temporel, les dispositions de l’Ordonnance doivent s’appliquer aux contrats « en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d’une durée de deux mois ». Le champ d’application temporel retenu est donc suffisamment large pour englober à la fois les contrats conclus avant la proclamation de l’état d’urgence sanitaire – sous réserve que leur exécution ne soit pas terminée – et ceux conclus durant cette période, et même au-delà. En effet, le délai de deux mois envisagé après cette période offre une marge d’adaptation supplémentaire aux acheteurs, aux autorités concédantes et aux opérateurs économiques candidats à l’attribution ou titulaires de contrats publics. Il y a d’ailleurs fort à parier qu’au-delà de cette période de deux mois, des dispositions adaptant le droit de la commande publique pourraient être adoptées pour favoriser une relance économique d’après crise. Ainsi, tant du point de vue matériel que temporel, le champ d’application de l’Ordonnance est relativement bien circonscrit. Toutefois, une limite essentielle est apportée et constitue une source majeure d’incertitudes pour les acteurs de la commande publique (et des autres contrats publics !) : le texte précise que les dispositions « ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l’exécution de ces contrats, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ». Cette précision semble donc impliquer que, pour mettre en œuvre les autres dispositions de l’Ordonnance, les autorités contractantes et les opérateurs économiques devront justifier que leur mise en œuvre est nécessaire dans le cadre de la crise sanitaire. Ainsi rédigée, cette disposition semble indiquer que c’est en principe le droit « ordinaire » de la commande publique qui doit continuer à s’appliquer et que ce n’est donc que par exception que le droit « dérogatoire » posé par l’Ordonnance pourra être mis en œuvre. La question pourra notamment se poser si les dispositifs prévus par le Code de la commande publique et l’Ordonnance apparaissent comme contradictoires, notamment le fait de savoir qui décidera que ce sont les dispositions de l’Ordonnance qui doivent être mises en œuvre davantage que celles du droit « ordinaire ». Surtout, cette disposition interroge à la lecture de certains des autres articles de l’Ordonnance utilisant des formules injonctives qui semblent indiquer que leur application serait automatique.
C’est notamment le cas de l’article 2 de l’Ordonnance. Celui-ci précise, pour les seuls contrats soumis au Code de la commande publique et non pour l’ensemble des contrats publics, que « sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard, les délais de réception des candidatures et des offres dans les procédures en cours sont prolongés d’une durée suffisante, fixée par l’autorité contractante, pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner ». Cette disposition doit permettre de sécuriser les procédures de passation en cours en prévoyant un allongement des délais de réception des candidatures et des offres. En effet, si le droit ordinaire de la commande publique semble autoriser un tel allongement, ce n’est que sous conditions (A. Villalard, « Coronavirus et marchés publics [3/5] : quid des procédures de passation en cours ? », préc.). Pour autant, les questions sont nombreuses : est-ce que l’allongement est automatique et concerne l’ensemble des contrats de la commande publique en cours ? ou seulement ceux pour lesquels l’allongement des délais s’avère nécessaire pour faire face à la crise sanitaire conformément à l’article 1er de l’Ordonnance ? Si tel est le cas, est-ce l’autorité contractante seule qui décide discrétionnairement de cet allongement ? Enfin, cet article évoque « une durée suffisante » sans davantage de précision, ce qui laisse planer une incertitude et des risques de contestation si l’allongement venait à favoriser ou défavoriser tel ou tel opérateur économique, soit parce qu’il serait insuffisant, soit parce qu’il serait trop long… De ce point de vue, la sécurité juridique n’est donc pas forcément au rendez-vous…
L’article 3 de l’Ordonnance concerne les conditions de la mise en concurrence dans le cadre des procédures de passation des contrats de la commande publique (ici encore, seuls ces derniers sont visés). Pas d’injonction ici, ce qui semble être en adéquation avec la limite posée par l’article 1er. Il est en effet précisé que l’autorité contractante « peut » aménager les modalités de la concurrence prévues par les documents de la consultation des entreprises en application du Code de la commande publique s’il ne lui est pas possible de les respecter. Ne sont donc concernées que les modalités de mise en concurrence prévues par les documents de la consultation et en application du Code. Dans ce cas, l’autorité contractante dispose d’une simple possibilité : cela signifie qu’elle est libre de ne pas adapter les modalités de la concurrence si elle ne le souhaite pas et, en principe, qu’elle devra justifier son choix si elle décide de recourir à une telle adaptation conformément aux conditions fixées par l’article 1er de l’Ordonnance. Enfin, et dans tous les cas, l’aménagement opéré devra être effectué « dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ». Ce rappel de l’un des principes fondamentaux de la commande publique vient tempérer le caractère dérogatoire de cette disposition et laisse place à une certaine incertitude. En pratique, il conviendra pour les autorités contractantes qui décident d’aménager les modalités de la concurrence de s’assurer que tous les candidats – réels ou potentiels – disposent bien des mêmes informations et des mêmes chances de se voir attribuer les contrats.
L’Ordonnance envisage ensuite, dans son article 4, la question de la durée des contrats. Sont concernés les contrats qui sont arrivés ou arriveront à terme durant la période fixée par l’article 1er, c’est-à-dire entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée de deux mois. Cette disposition concerne tous les contrats visés par l’Ordonnance, qu’ils soient des contrats relevant du Code de la commande publique ou d’autres contrats publics. Elle prévoit que ces contrats « peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre ». Il ne s’agit donc ici que d’une simple possibilité, qui doit être entendu dans le cadre des limites fixées par l’article 1er : il faudra donc démontrer que la prolongation est nécessaire au regard de la crise sanitaire pour qu’elle puisse être prévue. Par ailleurs, cette prolongation devra être prévue par avenant, ce qui suppose l’accord de l’autorité contractante et de son cocontractant. De plus, cette prolongation n’est possible que si l’organisation d’une nouvelle procédure de mise en concurrence est impossible : cela signifie donc, en creux, que le principe reste celui de la passation de nouveaux contrats lorsque cela est possible. D’ailleurs, l’article 4 précise que « dans tous les cas », la durée de la prolongation ne peut pas dépasser la période fixée par l’article 1er de l’Ordonnance « augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration ». Ainsi, même si le dispositif prévu par l’article 4 est mis en œuvre par un avenant prolongeant la durée du contrat, cette prolongation doit rester temporaire et doit avoir pour objectif l’organisation d’une nouvelle procédure de passation si les besoins assurés par le contrat demeurent après la période de crise. Enfin, ce même article comporte des dispositions spécifiques concernant les accords-cadres et les contrats de concession. Pour les premiers, il est prévu que la « prolongation peut s’étendre au-delà de la durée mentionnée aux articles L. 2125-1 et L. 2325-1 du code de la commande publique ». Ces articles limitent la durée des accords-cadres : elle ne peut pas dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices dans le cadre des marchés publics « classiques », et sept ans pour les marchés publics de défense et de sécurité. L’Ordonnance permet donc d’aller au-delà de ces durées mais cette précision était probablement inutile car les articles du Code cités prévoient la possibilité d’une augmentation de la durée qui peut « notamment » être justifiée par l’objet des contrats ou par l’amortissement des investissements réalisés. Il est donc probable que le dépassement des durées prévues pouvait d’ores et déjà être justifié dans le cadre du droit de la commande publique « ordinaire ». Par ailleurs, s’agissant des contrats de concession, l’article 4 organise le dépassement de la durée prévue par l’article L. 3114-8 du Code. Cet article concerne les contrats de concession passés dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets et prévoit que leur durée ne peut pas dépasser vingt ans, « sauf examen par l’autorité compétente de l’Etat ». L’Ordonnance du 25 mars permet de se passer de cet examen pour prolonger de tels contrats au-delà de la durée maximale. Il faudra néanmoins dans ce cas, comme dans les autres hypothèses de prolongation, démontrer que l’allongement de la durée du contrat est justifié au regard de la crise sanitaire et des mesures adoptées pour y répondre.
L’Ordonnance contient également des dispositions relatives aux avances. L’article 5 précise que « les acheteurs peuvent, par avenant, modifier les conditions de versement de l’avance », que « son taux peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande » et qu’« ils ne sont pas tenus d’exiger la constitution d’une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché ». Alors même qu’il manque de clarté sur ce point, il est possible de considérer que cet article ne concerne que les marchés publics. En effet, il se réfère à la notion d’acheteur utilisée par le Code pour désigner les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices lorsque ces derniers passent de tels contrats. Par ailleurs, il faut relever ici aussi que la modification des conditions de versement de l’avance constitue une simple possibilité pour les acheteurs. Si elle est mise en œuvre, il faudra donc respecter les conditions posées par l’article 1er de l’Ordonnance, notamment celle relative à la justification au regard de la crise sanitaire. Quoi qu’il en soit, l’Ordonnance permet de verser des avances qui vont bien au-delà de celles normalement prévues par le Code de la commande publique (v. not. CCP, art. R. 2191-6 à R. 2191-10). La mise en œuvre de cette possibité pourrait permettre aux opérateurs économiques titulaires de marchés publics et touchés par la crise sanitaire de faire face plus facilement à cette dernière. Toutefois, l’initiative de sa mise en œuvre reste réservée aux acheteurs et devra passer par la conclusion d’un avenant. Il conviendra donc de vérifier si, en pratique, ces derniers joueront le jeu.
Enfin, l’article 6 de l’Ordonnance concerne les difficultés rencontrées pour l’exécution des contrats en cours ou conclus entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée de deux mois. Cet article est probablement celui qui était le plus attendu par les opérateurs économiques titulaires de contrats publics mais, malheureusement, il reste porteur de nombreuses incertitudes.
Tout d’abord, cet article précise de manière générale qu’ « en cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat ». Cette précision interroge si sa lecture est combinée avec celle de l’article 1er de l’Ordonnance. Faut-il considérer que les dispositions de l’article 6 s’appliquent à tous les contrats publics qui entrent dans le champ d’application temporel de l’Ordonnance ou seulement à ceux pour lesquels il est possible de démontrer que les mesures s’imposent pour faire face à la crise sanitaire ? Par ailleurs, la formulation retenue ne semble pas laisser de marge de manœuvre aux cocontractants lorsqu’elle indique que les dispositions « s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire ». Elle semble donc présenter un caractère impératif, sauf s’il existe des stipulations plus favorables au titulaire du contrat. L’emploi du terme « stipulations » semble uniquement renvoyer au contrat lui-même et exclure les dispositions plus favorables qui pourraient résulter des textes ou de la mise en œuvre de la théorie générale des contrats administratifs (ils ne « stipulent » pas). Ensuite, et dans ce cadre, l’article 6 de l’Ordonnance envisage plusieurs situations auxquelles il tente d’apporter des réponses.
Le premier alinéa concerne les difficultés qui peuvent naître s’agissant du respect des délais d’exécution des contrats. Il est ainsi prévu que cette durée doit être prolongée par l’autorité contractante (la formulation ne laisse pas place au doute) lorsque le titulaire du contrat en fait la demande avant l’expiration du délai contractuel. La condition posée est de démontrer que « le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive ». En principe, et conformément à l’article 1er de l’Ordonnance, ces difficultés pour respecter les délais d’exécution doivent être liées à la crise sanitaire. Dans ce cas, la prolongation du délai d’exécution doit être « d’une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l’article 1er ». Il est toutefois conseillé aux autorités contractantes de ne pas prévoir, en l’absence de durée maximale fixée par l’Ordonnance, une prolongation trop étendue dans le temps sous peine que cette dernière soit considérée comme contraire aux principes fondamentaux de la commande publique.
Le deuxième alinéa de l’article 6 vient quant à lui encadrer et neutraliser en grande partie les prérogatives dont disposent les autorités contractantes dans le cadre de l’exécution des contrats publics. Il est en effet prévu que lorsque le titulaire est dans « l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive », il ne peut pas faire l’objet de sanctions, « ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ». Les sanctions évoquées ne sont pas définies et doivent donc être entendues comme recouvrant toutes les catégories de sanctions qui ont pu être évoquées. Cette exonération du titulaire du contrat fait écho au droit « ordinaire » de la commande publique lorsqu’un cas de force majeur est démontré mais l’Ordonnance ne renvoie pas à la notion de force majeure. Il s’agit sûrement d’un choix délibéré pour que les conditions posées en jurisprudence s’agissant de la force majeure ne s’appliquent pas. Les dispositions de cet article devraient donc s’appliquer plus facilement que le droit « ordinaire » face à la crise sanitaire. De plus, parce que leur application semble obligatoire, ces dispositions semblent vider de sens la mise en œuvre de la force majeure (demandée jusque-là par l’exécutif) pour faire face à la crise du COVID-19. Par ailleurs, ce même alinéa envisage la conclusion de marchés de substitution par les acheteurs lorsque le titulaire ne peut pas exécuter le contrat. Cette disposition ne renvoie qu’aux « marchés de substitution » et aux « acheteurs » : elle ne concerne donc que les marchés publics et ne s’applique ni aux contrats de concession, ni aux autres contrats publics. Elle redéfinit l’exercice des sanctions coercitives dans le cadre de la crise sanitaire et en lien avec le premier alinéa de l’article 6. En effet, ce dernier interdit la mise en œuvre de toutes les sanctions, y compris les sanctions coercitives. Or, l’alinéa 2 permet la conclusion de marchés de substitution avec des tiers « pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur ». Il s’agit ici d’éviter que l’interdiction de prononcer des sanctions fixée par le premier alinéa empêche la satisfaction de besoins essentiels et urgents. Pour autant, il est précisé que « l’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire ». Il s’agit d’une dérogation au principe selon lequel la conclusion des marchés de substitution s’effectue aux frais et risques du titulaire, mais cette précision est conforme à l’esprit de l’Ordonnance. Il est toutefois surprenant que ce second alinéa ne concerne que les marchés publics et n’envisage pas l’ensemble des contrats publics (ou au moins ceux de la commande publique), d’autant que la mise en régie ou la conclusion de marchés de substitution constitue une règle générale applicable aux contrats administratifs…
Le troisième alinéa de l’article 6 concerne les bons de commande annulés et les marchés résiliés lorsque ces décisions sont « la conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ». Dans ce cas, le titulaire doit être indemnisé pour les dépenses qu’il a engagées si ces dernières « sont directement imputables à l’exécution d’un bon de commande annulé ou d’un marché résilié ». Ce dispositif fait peser sur les seules autorités contractantes les conséquences des mesures adoptées pour lutter contre l’épidémie et doit donc protéger les opérateurs économiques. Il déroge au droit « ordinaire » de la commande publique qui aurait dû permettre la résiliation pour cas de force majeure, laquelle ne permet normalement pas une indemnisation du cocontractant. Pour autant, cet alinéa manque lui aussi de clarté car il ne concerne que les « bons de commandes annulés » et les « marchés résiliés » : il ne semble donc s’appliquer que dans le cadre des marchés publics, qu’il s’agisse ou non de marchés à bons de commande. Les autres contrats publics, et notamment les contrats de concession, ne sont pas concernés. La question est alors de savoir si, pour ces autres contrats, la résiliation pour force majeure reste possible dans le cadre du droit « ordinaire ». Il semble que oui. L’interdiction des sanctions posée par l’article 6, al. 2 interdit en effet la résiliation-sanction mais non la résiliation pour force majeure qui, pour rappel, est consacrée tant par la jurisprudence que par le Code de la commande publique.
L’Ordonnance envisage ensuite de manière spécifique la question de la suspension des marchés publics à prix forfaitaire qui sont en cours d’exécution. L’alinéa 4 de l’article 6 précise en effet que « lorsque l’acheteur est conduit à suspendre » un tel marché, il doit effectuer le règlement du marché « sans délai » et « selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat ». Par ailleurs, il est prévu qu’un avenant doit être conclu après la suspension pour déterminer « les modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l’identique ou sa résiliation ainsi que les sommes dues au titulaire ou, le cas échéant, les sommes dues par ce dernier à l’acheteur ». Il s’agit ici de s’assurer que la suspension du contrat n’aura pas des conséquences trop défavorables tant pour l’acheteur que pour son cocontractant.
Dans le même sens, l’alinéa 5 envisage la suspension des contrats de concession. Il est ainsi prévu que « lorsque le concédant est conduit à suspendre l’exécution d’une concession, tout versement d’une somme au concédant est suspendu et, si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée ». Pour autant, cette disposition ne précise pas quelle doit être l’origine de la décision de suspension : il semble nécessaire que cette décision s’impose au regard de la crise sanitaire mais l’article manque de clarté sur ce point. Surtout, sur le fond, cette disposition semble davantage protéger les autorités concédantes que leurs concessionnaires, ce qui ne devrait pas manquer de susciter des inquiétudes.
Enfin, et toujours à propos des contrats de concession, le dernier alinéa de l’article 6 envisage la possibilité d’une modification unilatérale du contrat par l’autorité concédante. Il est ainsi précisé que « lorsque, sans que la concession soit suspendue, le concédant est conduit à modifier significativement les modalités d’exécution prévues au contrat, le concessionnaire a droit à une indemnité destinée à compenser le surcoût qui résulte de l’exécution, même partielle, du service ou des travaux ». Toutefois, il faut que « la poursuite de l’exécution de la concession impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire ». Cette disposition semble donc réduire en l’encadrant le droit au maintien de l’équilibre financier du contrat qui est classiquement reconnu dans le cadre de la théorie générale des contrats administratifs et qui trouve écho à l’article L. 6 du Code de la commande publique…
La conciliation du droit « ordinaire » de la commande publique et du droit « dérogatoire » fixé par l’Ordonnance suscite ainsi de nombreuses interrogations, tout comme leurs possibilités de mise en œuvre en réponse à la crise sanitaire. Le Gouvernement a donc le mérite de chercher à apporter des réponses aux acteurs de la commande publique mais il est possible de se demander si les dispositifs antérieurs ne suffisaient pas ou si, à tout le moins, la rédaction de l’Ordonnance du 25 mars n’aurait pas mérité davantage de réflexion…
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Amilhat Mathias, « La commande publique face au COVID-19 »
in Journal du Droit Administratif (JDA), 2020 ;
Actions & réactions au Covid-19 ; Art. 282.