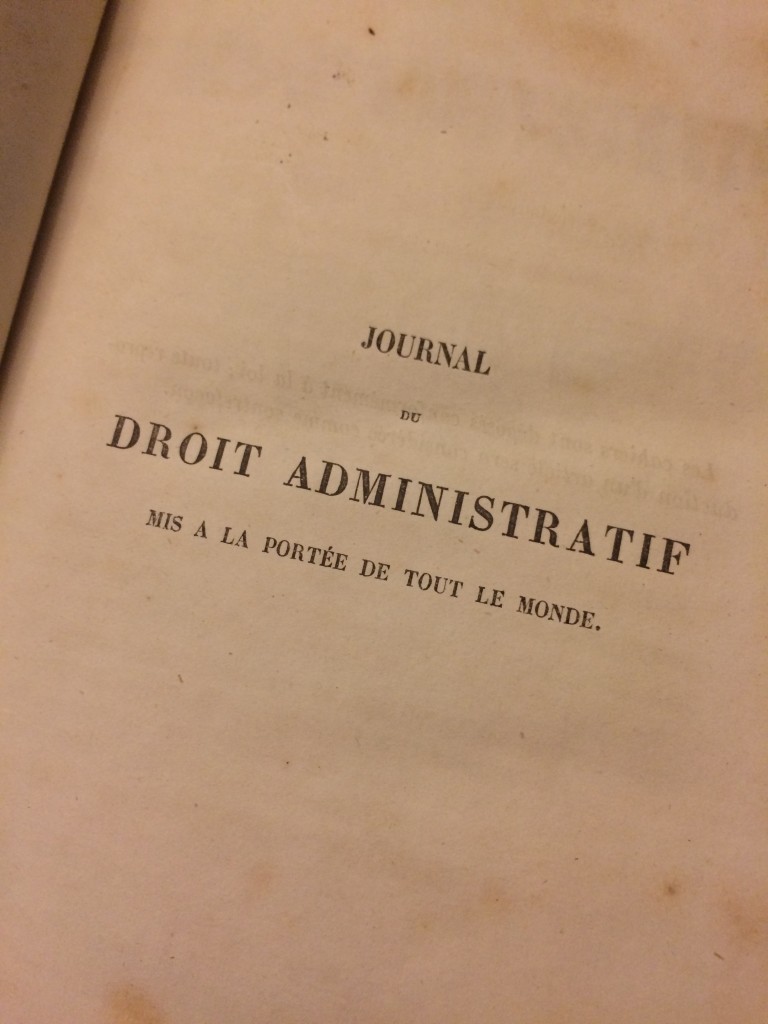Art. 369.
Cet article fait partie intégrante du dossier n°08 du JDA :
L’animal & le droit administratif
… mis à la portée de tout le monde

Professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole
Directeur du Journal du Droit Administratif
Président du Collectif L’Unité du Droit
A Chaconne de Bach, « greffière[1] »
« Rappelle-toi minette. C’était jour de fête » chantait – sur une de ses propres compositions – Patrick Juvet (1950-2021) en 1974. Qu’en est-il du droit administratif ? Matérialise-t-il aussi aux Chattes et aux minettes une fête, un traitement d’exception ? C’est la question que nous nous sommes posée. Pour y répondre, il faut évacuer – au plus vite – deux jeux de mots (aussi faciles que triviaux) et borner, par suite, notre étude. Si on l’a intitulée, le sourire non dissimulé aux lèvres, « la Chatte & le strat’ » (pour droit administratif) c’est évidemment au « regard phonique » de l’assonance qu’elle provoque à l’instar de ce poème court au cœur du Cercle des poètes disparus[2] : « la Chatte ; a quatre ; papattes » (en anglais : « The Cat ; is ; on the mat »).
Cela dit, l’auteur n’ignore pas que ladite assonance renvoie (dans l’esprit de certaines et de certains) à un sens non animalier du terme mais à un sens familier et anatomique sexué. Pour le dire (et l’évacuer) simplement mais frontalement : il n’en sera pas question(s). De la même manière, si l’on a – un temps – espéré se sortir du présent thème par un autre jeu de mots, on l’a finalement également retoqué. En effet, nous avons constaté que, depuis sa création en janvier 2014, dans la suite directe des affaires dites Cahuzac, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (Hatvp) donnait lieu – en droit public – à un fort contentieux qu’il serait intéressant d’analyser au regard des seuls droit et contentieux administratifs[3]. Or, nombreux sont les contemporains à qualifier phoniquement l’autorité administrative indépendante de « Chatte-Vp » lorsqu’ils énoncent son acronyme : la Hat-vp. Toutefois, à la suite d’une levée amicale de boucliers, on s’y est refusé. De la même manière, on aurait pu consacrer plusieurs lignes à des célèbres publicistes amateurs de Chats ou même à des administrativistes aux patronymes les évoquant (on songe évidemment ici à Georges et à Louis Pichat ainsi qu’à René Chapus) mais une levée identique d’avis contraires nous en a dissuadé. On a même un temps cherché (mais en vain) une esquisse du Baron Georges Cuvier (publiciste et anatomiste) ayant dessiné, au Conseil d’État, un félin sur l’une de ses archives.
La Chatte & le Strat ? Ni Hatvp, ni sexualité, ni chance[4], ni féminité[5], il sera bien question, dans la présente contribution, de l’animal félin « Chat » mais aussi et surtout du félidé femelle (la Chatte) domestiqué : le Felis silvestris catus ; lui-même sous espèce du Felis silvestris, le Chat « sauvage » dit des bois. Pour l’appréhender (tout en sachant que même domestiqué, il est parfois très difficile d’approcher un Chat qui ne le souhaite pas), on se propose de regarder comment le contentieux administratif traite de l’animal et du mot « chatte » (en se concentrant sur le félidé femelle). On croit alors pouvoir distinguer quatre hypothèses contentieuses qui nous ont été livrées, suivant les conseils et l’aide précieuse de Mme Chaconne de Bach[6], à la suite de la lecture et du parcours des pages papier du Lebon[7] et des pages électroniques contemporaines du service public de la diffusion du Droit : Légifrance. On trouve ainsi des contentieux de la Chatte animale tant non domestiquée qu’élevée (I) mais aussi, en reprenant son appellation plutôt que son incarnation, des contentieux toponymiques et même fictionnels (II) de la Chatte.
En tout état de cause, il apparaît clairement que le recueil prétorien de la jurisprudence administrative et le Recueil Lebon, en particulier, ne manquent manifestement pas… de Chatte(s). Ce qui n’est pas le cas du recueil doctrinal dit du Gaja[8].
Cela dit, et l‘on reviendra sur cette question en conclusion, il est important de rappeler – de façon qualificative et juridique – que la Chatte[9] est un être[10] non humain ce qui par conséquent, même si sa reconnaissance d’être sensible lorsqu’elle est domestiquée la protège davantage que son homologue « sauvage », la fait appartenir à la catégorie des « choses » en Droit et même des choses susceptibles d’appropriation par un droit réel. Il s’agit donc, fût-ce un être « vivant doué de sensibilité » au regard de l’article 515-14 du Code civil[11], d’un bien mobilier (et parfois même très mobile) qui n’est pas acteur et personne juridique du droit français (y compris administratif). C’est donc à tort que de trop nombreux défenseurs des droits des animaux[12] déclarent qu’il ne s’agit plus d’un bien meuble car la sensibilité reconnue n’entraîne en rien la création d’une nouvelle personnalité juridique. La fin du nouvel article 515-14 du Code civil en est d’ailleurs explicite : « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Ils ne sont donc pas a priori des « acteurs » ou sujets du Droit administratif à la différence, peut-être, de Stubbs, ce chat américain élu (pour l’amusement, certes, mais véritablement élu) maire de la commune de Talkeetna, en Alaska en 1997 laissant par suite sa place d’édile à son propriétaire. En revanche, et comme tous les biens, la Chatte est « objet » du droit – notamment – administratif français.
I. Du contentieux de la Chatte félidée
Quatre codes & neuf vies du Chat. Selon un mythe aussi incarné qu’une griffe de Chat dans un vêtement ou un canapé, le Chat aurait « neuf vies[13] ». Quant au Droit français, quatre Codes le mentionnent explicitement :
- Le Code rural (et de la pêche maritime) par 33 occurrences qui traitent tant des Chats dits de compagnie (art. L. 214-6 et s. du Code) domestiqués et identifiés (avec propriétaires humains) et de leurs ventes (par ex. art. L. 212-10 et s.) que des Chats dits en état de divagation (art. L. 211-22 et s. et R. 211-12) et susceptibles, par exemple, de propager la rage (art. L. 223-11 du même Code) avec possibilité conséquente de les abattre si leur capture est « impossible ou dangereuse » ; les autres occurrences codifiées le sont dans trois Codes distincts :
- le Code de la santé publique en son art. R. 5211-23-1 à propos des dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d’origine animale ;
- le Code de l’environnement par l’art. L. 331-10 s’agissant des Chats errants des parcs nationaux ;
- & le Code de procédure pénale (art. R. 48-1) à propos des Chats identifiés « pucés ».
Ainsi, le Droit français mentionne-t-il explicitement le Chat à propos – essentiellement – de son opposition entre celui qui est la propriété d’un être humain[14] et qu’il faut protéger (B) ce qui semble être moins le cas du Chat solitaire, errant ou divagant (A).
A. Du contentieux de la Chatte non domestiquée :
les peurs ancestrales activées
Divinisé pendant l’Antiquité (égyptienne mais pas seulement) puis diabolisé au moyen-âge, notamment, tous les ouvrages qui ont désiré décrire les Chats pour les appréhender le retiennent (et le déplorent) en ouverture de leurs propos : le Chat (domestiqué ou non) fascine mais fait souvent peur par son évocation des mystères[15] (et notamment de la mort auquel, plus il est noir[16], plus on l’associe) et son aptitude à la vie cachée et nocturne que ses yeux de nyctalope rendent possible.
Le Chat a ainsi longtemps été associé au Diable et à la sorcellerie et l’on compte même des édits comme celui d’Innocent VIII en 1484 qui ordonna aux croyants de brûler, même vifs, les Chats (domestiqués ou non) lors des feux de la Saint-Jean parce qu’ils incarneraient les forces maléfiques. Cette diabolisation féline par l’Eglise catholique se concrétisa en son sommet lorsque le Pape Grégoire IX assimila le Chat aux malheurs du monde (et notamment à ses pandémies de peste) ce qui ressort explicitement de la lettre qu’il adressa notamment à l’archevêque de Mayence en 1233[17].
Il faudra alors attendre le XVIe siècle et le Pape Sixte V pour que les Chats soient autorisés à être adoptés (puisque dédiabolisés) par des catholiques. Entre-temps, la peinture s’en fait l’écho lorsqu’elle représente, sous les pinceaux de Jérôme Bosch (circa 1500) une Tentation de saint Antoine au cœur de laquelle[18] est dissimulé, près d’une femme nue, un Chat (évidemment) noir jouant avec une proie allégorique du christianisme, un poisson. De même, lorsque le Diable apparaît à saint Dominique de Caleruja dans le Miroir historical (1400-1410) détenu à La Haye, il est directement représenté sous les traits d’un Chat noir.

« Le Diable face à St Dominique » / Miroir Historical (circa 1410) ;
La Haye ; Koninklijke Bibliotheek, 72 A 24. Fol 313 v.
Ce n’est alors évidemment pas un hasard si, William Baldwin, en 1553, rédigea son pamphlet anticatholique sous le nom de Beware the Cat. Il faut dire que les réactions parfois inattendues (pour ne pas dire étonnantes) du Chat, même lorsqu’on le croit en confiance, ont réellement de quoi nous interroger. Ne parle-t-on pas leur égard du célèbre « quart d’heure de folie » félin ? Il existe d’ailleurs en ce sens plusieurs décisions décrivant le Chat comme causeur direct ou non de méfaits comme s’il portait malchance à ceux et celles le croisant. Il en est ainsi, même en Droit administratif, d’un automobiliste ayant eu un accident alors que surgissait un Chat devant lui[19].
De la Pomponnette & des autres Chats errants. Le contentieux administratif en est témoin lorsqu’il évoque, encore de façon contemporaine, la crainte, la méfiance et la peur sinon la haine parfois viscérales, de certains citoyens vis-à-vis des Chats non domestiqués et que le Droit qualifie « d’errants » ou de « divagants ». L’art. L. 211-23 en son 2nd alinéa du Code rural précise ainsi :
« est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui ».
Il existe donc trois hypothèses juridiques de divagation ou d’errance féline[20] :
- soit le Chat est identifié (collier, tatouage ou puce) comme appartenant à quelqu’un mais il se trouve à plus d’un kilomètre du domicile de ce dernier ;
- soit le Chat et surtout son propriétaire sont inconnus et le félidé se situe dans un périmètre urbanisé ;
- soit le Chat n’est pas identifié et il fait l’objet d’une saisie « sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui ».
Ne sont donc pas qualifiés d’errants que les Chats sans maîtres. Si, comme dans La femme du boulanger (film de Marcel Pagnol (1938) adapté du Jean le Bleu de Jean Giono), on entend parfois le maître d’une Chatte déclarer comme Raimu dans le film précité :
« Ah ! te voilà, toi ? Regarde, la voilà la Pomponnette… Garce, salope, ordure, c´est maintenant que tu reviens ? Et le pauvre Pompon, dis, qui s´est fait un mauvais sang d´encre pendant ces trois jours ! Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins… », ….il faut par suite immédiatement distinguer si Pomponnette (que l’on imagine identifiée) se situe à plus d’un kilomètre de son maître pour savoir si on peut la qualifier d’errante.
Des maires & des Chats errants. C’est à propos de ces errances que survient le Droit administratif[21] qui énonce (aux art. L. 211-19-1 & L. 211-22 et s. du Code rural) un principe général de non-divagation des animaux que régule, par son pouvoir général de police administrative (art. L. 2212-1 Cgct), le maire de toute commune. Depuis le 1er janvier 2015, par ailleurs, et selon l’art. L. 211-27 du Code rural, tout maire (qui a l’obligation selon l’art. L. 211-24 du même Code de disposer d’une fourrière[22] ou d’un accès proche à un tel établissement) :
« peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée à l’alinéa précédent ».
Ces dispositions qui n’instaurent pas une obligation de stérilisation (cherchant à lutter contre la rage mais aussi contre une explosion incontrôlée des populations félines) des Chats vivant en colonie mais une potentialité telle par décision municipale coordonnée avec les associations locales de protection animale[23] sont à considérer selon l’état sanitaire du territoire. En effet, si la rage fait… rage, l’urgence et l’atteinte à la salubrité publique (et donc à l’ordre public) peuvent entraîner des pouvoirs exceptionnels administratifs allant jusqu’à la capture voire à la mise à mort de Chats pourtant non considérés comme sans maître. Cette question se retrouve déjà exposée dans un ancien contentieux[24] opposant la dame Le Clézio et MM. James Chillon et Géo Cordier, à l’administrateur colonial du cercle de Kindia (en Guinée dite d’Afrique occidentale française) parce que ce dernier avait prescrit, par un arrêté du 10 avril 1930, que l’on abattît les chiens et Chats errants de son ressort territorial ; l’arrêté étant estimé légal du fait d’un péril imminent de rage à la contagion extrême. La décision est la même dans cet arrêt d’assemblée[25] du 07 octobre 1977 : le droit administratif, peut, en cas de menace à la salubrité publique, ordonner par ces titulaires du pouvoir de police administrative, l’abattage des Chats considérés errants (même s’ils sont, on le redit, la propriété de maîtres identifiables). En outre, les mesures administratives sur les animaux errants concernent davantage les chiens et la potentialité de les faire divaguer en étant muselés ou retenus (en laisse) comme dans ces nombreux arrêts[26] relatifs à des contestations d’arrêtés cherchant à éviter les morsures. Par ailleurs, notre collègue, M. Loïc Peyen[27] ayant consacré au présent dossier une très belle contribution sur l’errance et la cohérence entre animaux et droit administratif, on y renverra aussitôt le lecteur.
De l’obligation d’identification domestique. Aussi, pour éviter toute capture et potentielle destruction d’un Chat estimé errant bien qu’appartenant à un ou à des maîtres, s’est imposée de facto puis de jure l’obligation d’en permettre l’identification patrimoniale au moyen de simples colliers mobiles puis de tatouages et de puces électroniques pérennes. Désormais, non seulement l’identification d’un Chat domestique est obligatoire[28] aux termes de l’art. L. 212-10 du Code rural mais, depuis le 1er janvier 2021, le décret n° 2020-1625 du 18 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au bien-être des animaux d’élevage et de compagnie en sanctionne même le non-respect pour tout Chat né depuis 2012.
De la Chatte errante… mais libre ou en colonie ! Depuis la Loi n°99-5 du 06 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, il existe même un statut parmi les Chats errants : ceux dits « libres » c’est-à-dire ceux qui, bien que n’ayant pas de maître(s), ont été stérilisés et identifiés par les services municipaux puis relâchés sur leurs lieux de divagation(s). Ces Chats que l’on laisse « libres », c’est-à-dire que l’on ne contraint pas à rester enfermés ne sont néanmoins pas, au regard du Droit, des animaux « sans maîtres » car même s’ils n’appartiennent pas à un particulier privé, leur identification les rattache soit à une association de protection animale soit à une mairie. Nos collectivités municipales sont ainsi les propriétaires ou les gardiennes (on y reviendra) de nombreux Chats dits libres alors qu’autrefois on préférait les abattre sans grande considération animale. Désormais, les Chats trouvés errants sont a priori plus en sécurité puisqu’on cherche d’abord à les identifier (mais aussi à les stériliser) et donc à les reconnaître puis à les relâcher.
Il en va de même de ceux estimés vivant en colonies ou en groupes sur des lieux communaux et similaires à toute collectivité tels des cimetières ou des terrains vagues. Seul le maire peut en ordonner la capture aux fins de les rendre « libres » et ce, hors de l’application préc. de l’art. L. 211-27 du Code rural. Par ailleurs, au regard des dispositions préc. du Code rural, le maire est bien le « gardien » des Chats (même non identifiés) vivant en groupes. En outre, redisons-le, « libres » ou non, les Chats ainsi considérés demeurent, en France, des « objets » et non (comme le prétendent d’aucuns) des « citoyens » à part entière du fait de cette « liberté » reconnue. C’est là tout le paradoxe de la qualification de Chats « libres » alors que, juridiquement, ils sont toujours des objets et non des sujets du Droit. Bref, ils ne sont « libres » que par distinction d’autres catégories.
Kwiskas. Se pose ensuite la question de la nourriture desdits Chats errants, « libres » ou non. Comme nous l’a rappelé la publicité parodique des Nuls[29] à travers ce célèbre communiqué du Ccc, le Comité Contre les Chats :
« Votre chaton est plein de vie, et ça, Kwiskas l’a compris. C’est pour ça que Kwiskas-Chaton est plein des bonnes choses qui sont bonnes pour votre chaton qui est plein de vie. Ça a l’air dégueulasse comme ça à première vue, mais c’est plein de bonnes choses qu’on peut pas comprendre, nous, humains. Mais si on leur demandait, aux chats, les chats, ils achèteraient Kwiskas. Ils se lèveraient sur leurs p’tites pattes, ils se bougeraient le cul et ils iraient acheter du Kwiskas. Au lieu de ça, les chats dépensent leur pognon au baby-foot et y passent leur temps à fumer des pétards et à grimper au plafond ». Pour conclure : « les chats, c’est vraiment des branleurs » !
Sans vérifier ici la véracité de ladite publicité, on évoquera la question de la nourriture des Chats errants dans les lieux publics (cimetières ou rues notamment). Un maire peut-il ainsi interdire à une « mère à Chats » ou à un « Papa des Chats » de venir donner croquettes et pâtés à des animaux susceptibles d’être qualifiés de Chats en divagation ? La question n’est – juridiquement comme éthiquement – pas si simple. Nourrir régulièrement un Chat errant entretient sa dépendance humaine mais nourrir un Chat qualifié de « libre » (identifié et stérilisé) devient indirectement obligatoire puisque, selon l’art. R. 214-17 du Code rural, « il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : 1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ; 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ». Puisque le fait de priver de nourriture un animal identifié (et ainsi considéré comme domestiqué) est prohibé, peut-on en conclure qu’existerait une obligation positive aux mairies ayant rendu des Chats « libres » de les nourrir ? On peut tout à fait l’affirmer.
Les premiers maîtres et surtout gardiens des Chats en France sont donc, eu égard à leur nombre, les maires de nos communes. Le lien avec la Chatte et le strat’ est ici patent.
Les maires ont alors à leur disposition juridique plusieurs possibilités d’actions lorsque les Chats estimés errants prolifèrent et ils ne peuvent désormais les mettre en œuvre qu’en collaboration étroite avec une association de protection animale. Ils peuvent ainsi décider de les identifier et de les stériliser (les rendant « libres »), voire de les mettre en fourrière et – de façon ultime au regard des conditions sanitaires – en décider l’abattage.
B. Du contentieux de la Chatte domestiquée :
les appréhensions continues révélées ?
Du Pouvoir mystérieux à la Chatte ministérielle. La plupart des animaux de compagnie des femmes et des hommes de « pouvoir(s) » sont traditionnellement des chiens, incarnation de la force et de la fidélité animale. Il en est ainsi des célèbres canidés (souvent des labradors) de la Présidence française de la République :
- Bravo, le berger allemand du Président Poincaré ;
- Rasemotte, le corgi du Général de Gaulle ;
- Jupiter, le labrador du Président Pompidou ;
- Nil & Baltique, les labradors du Président Mitterrand ;
- Maskou, le labrador du Président Chirac qui garda également de célèbres bichons maltais : Sumo & Sumette ;
- Clara (et ce n’est pas une blague !), le premier chien labrador du Président Sarkozy avant que ne rejoignent ladite Clara, Dumbledore (un terrier), Big (un chihuahua) ainsi qu’un bâtard dénommé Toumi ;
- Philae, le labrador du Président Hollande ;
- & Nemo, le labrador du Président Macron dont on connaît également la poule (sic) Agathe.
Des chiens (comme ceux des Présidents américains Obama ou encore Biden) et quelques rarissimes Chats[30] à l’instar :
- de Socks le Chat des Clinton ou d’India, la Chatte de George W. Bush ;
- mais encore, en France, de Gris-gris le Chat chartreux de Charles de Gaulle dont on raconte qu’il le suivait partout.
Il faut dire que même domestiqué, le Chat, pour certains, fait encore peur et renvoie à l’idée d’un animal que l’on ne comprend pas, qui touche aux mystères[31] (souvent religieux) et dont on se méfie conséquemment comme si les nombreux Chats du Cardinal Richelieu (on lui en connaissait au moins une quinzaine dans son entourage proche[32]) inspiraient des formes de machiavélisme transmis à leurs propriétaires.

« La distraction de Richelieu » / Charles-Edouard Delort (circa 1885) ;
Detroit Institute of Arts
Au sommet de la religion (sans même évoquer le désormais célèbre Chat du rabbin[33] de Joann Sfar), l’histoire a connu Micetto, le chat du Pape Léon XII que recueillit à sa mort, et à sa demande, l’Ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, le vicomte François-René de Chateaubriand. Dans ses célèbres Mémoires d’outre-tombe, l’écrivain diplomate se remémore[34] :
« Léon XII, prince d’une grande taille et d’un air à la fois serein et triste, est vêtu d’une simple soutane blanche ; il n’a aucun faste et se tient dans un cabinet pauvre, presque sans meubles. Il ne mange presque pas ; il vit, avec son chat, d’un peu de polenta ».
D’aucuns, comme Karl Lagerfeld et sa célèbre Chatte Choupette[35], s’en sont vraisemblablement servi afin de se forger un personnage mystérieux et comme complotant avec leur animal de compagnie à l’instar de Madchat, le félidé du Docteur Gang, toujours avec son maître et potentiellement triomphant si l’inspecteur Gadget[36] ne déjouait pas leurs plans ou encore du Chat d’Ernst Stavro Blofeld dans la saga des films de James Bond. On a même d’ailleurs connu des chats dits espions comme Acoustic Kitty à la Cia ou dans des Armées. De nombreux ministères (à la différence de l’Elysée) ont aussi leurs Chats (parfois célèbres) à l’instar de :
- Olive, le Chat du Ministère des Finances, décédé à Bercy en mai 2021 ;
- Duchesse au Ministère des Outremers ;
- ou de Boris au Ministère de l’Intérieur.
Cela dit, le Chat le plus célèbre des Ministères est certainement le Chief Mouser to the Cabinet Office, c’est-à-dire le Chat souricier du 10, Downing street, auprès du Premier ministre britannique. Il s’agit en l’occurrence de Larry depuis le 15 février 2011, assisté pour ce faire de 2012 à 2014 de Freya à l’initiative de David Cameron.
Du ronronnement calmant. Pourtant, quelques administrations (surtout à l’étranger mais aussi en France à titre expérimental et après avoir bravé bien des normes sanitaires pour ce faire) ont décidé d’utiliser le pouvoir calmant des Chats et notamment leur célèbre ronronnement auprès de publics contraints ou immobilisés à l’instar des usagers d’établissements publics (ou privés) de santé, de soin, ou encore d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). L’usage provient alors directement des neko Cafés, ces « bars à Chats » imaginés au Japon (peut-être en hommage au célèbre Chat blanc peint par Hiroaki Takahashi (dit Shotei) en 1924 eu égard au calme et à la sérénité qu’il inspire à simplement le regarder et à l’imaginer ronronner)… et qui tendent à se globaliser.
Il s’agit là, à nos yeux encore, d’une belle rencontre entre Chatte & droits administratif et de la santé.
Des Chats de particuliers privés aux contentieux pourtant administratifs. On pourrait croire, par suite, qu’à l’exception des quelques Chats mentionnés supra et proches de la Puissance publique, le Droit administratif serait a priori étranger à la question des contentieux relatifs à des Chats et à des Chattes appartenant à des particuliers privés. Tel n’est pourtant pas le cas.
Le Droit administratif s’intéresse aussi à ses Chats domestiqués. Mentionnons en ce sens, le contentieux des élevages félidés qui peuvent être assimilés, sous conditions, à des installations classées pour la protection de l’environnement (Icpe) au regard du Code de l’Environnement et doivent conséquemment respecter de nombreuses réglementations protectrices tant des animaux (Code rural) que de la Nature environnante ainsi que de la santé publique[37]. On peut également songer aux questions relatives au « classement » des races de Chats[38] dont un contentieux existe également. En effet, selon le Code rural (art. D. 214-8 et .s),
« il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races. Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race. L’association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu’elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée. L’agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l’association, de la définition de ses objectifs, de l’importance des effectifs concernés et de l’organisation générale de l’élevage canin et félin. L’association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique. Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d’agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture après avis du conseil supérieur de l’élevage. Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l’autorité chargée de l’agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités ».
Ainsi, comme on le fait en matière sportive, par exemple pour le football[39] ou encore le basket-ball[40] professionnels, la Puissance publique délègue à une personne privée unique, ainsi chargée d’une mission de service public, le soin d’accomplir une mission reconnue d’intérêt général, en l’occurrence la constitution de livres généalogiques destinés à protéger les patrimoines génétiques animaliers. Evidemment, l’habilitation unilatérale ainsi délivrée à une seule personne morale de droit privée crée des envieux et donne lieu à une contestation souvent juridictionnelle que tranche le Conseil d’État en premier et dernier ressort. Pour un exemple récent à propos, précisément, de la matérialisation du « livre généalogique unique » des Chats, c’est la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines qui a été agréée en 2006, ce que la Fédération féline française (une autre des FFF) a contesté (en vain) devant le Palais royal[41].
« J’ai peur pour ma Chatte » : des Chats sous la responsabilité de Maîtres peu soucieux. Si les stricts conflits de voisinages relèvent a priori du seul juge judiciaire, certains d’entre eux peuvent devenir des contentieux administratifs lorsqu’ils font intervenir le maire au titre de l’habitat insalubre. Tel est par exemple le cas de ce conflit de voisinage récemment relaté par l’Orne combattante[42] et aux termes duquel une citoyenne de la Ferrière-aux-Etangs (Mme Christiane S.) s’est émue, auprès de la Puissance publique municipale, de ce que l’un de ses voisins négligeait tant son jardin qu’il en venait à devenir une « jungle » où rats et vipères pulluleraient tant que la citoyenne en serait traumatisée pour son propre bien-être mais aussi celui de son animal de compagnie : « J’ai peur pour ma chatte » confia-t-elle ainsi au journaliste – peut-être un brin – malicieux.
Plusieurs autres contentieux administratifs sont également les témoins de ce risque de transformer, du fait d’une absence d’entretien normal, une propriété privée en habitat insalubre par l’accumulation, par exemple, de Chats ni entretenus ni nourris et évoquant un état quasi sauvage. C’est ce qu’évoque notamment cet arrêt de la CAA de Paris[43] au sein duquel le Ministère de la Santé faisait état du « caractère insalubre du logement de Mme F…, atteinte du » syndrome de Diogène « , qui [accumulait] les détritus dans son logement et dans les parties communes et [entretenait] des chats en très grand nombre ». Cela avait impliqué selon le Ministère des mesures d’assainissement sur le fondement de l’art. L. 1311-4 du Code de la Santé publique, l’immeuble litigieux étant devenu à ses yeux soumis à « un risque d’incendie et les voisins à la pestilence ». Parfois, même, il peut arriver que la Puissance publique se sente tenue d’ordonner in extremis l’abattage de Chats domestiqués chez un particulier ou en refuge lorsque la salubrité et la santé publiques, singulièrement, sont en jeu. Il en fut ainsi, par exemple, dans l’Isère, où la préfecture ordonna un retrait d’animaux puis leur euthanasie au détriment de l’association Droit de vivre[44].
II. Du contentieux de la Chatte par l’idée
Cela dit, le Droit administratif ne s’occupe pas que des Chattes animalières errantes et domestiquées, il traite également de lieux et de parties (sic) dans lesquels le terme apparaît (A) et même de questions plus fictionnelles c’est-à-dire davantage de l’idée du Chat que de son incarnation réelle (B).
A. Du contentieux de « la Chatte » urbanisée :
les toponymes évoqués
« Alors la zone ? Ca dit quoi ? » : de la zone au pont : On ne sait si le chanteur marseillais, Julien Mari dit Jul, est le maître d’un Chat mais par sa chanson « Alors la zone » (in Demain ça ira ; 2021), il nous permet d’évoquer cette litanie des toponymes français qui contiennent le mot Chat ou – plus spécialement – Chatte. Il existe ainsi dans la Creuse, sur la commune de Bonnat, un « Pont de la Chatte » que l’on nomme alternativement « Pont de la Chatte » ou « Pont à la Chatte » dans un arrêt de la CAA de Bordeaux[45] relatif à une contestation de permis de construire en matière d’installation agricole. On peut aussi mentionner, parmi les zones urbanisées et qualifiées du nom de félidés, une « zone de la Chatte » (sic) sise à Noirmoutier-en-l’Ile qui a notamment posé des problèmes d’extension[46]. On trouve même, au Lamentin, un « Trou au Chat » qu’un contentieux ultramarin[47] a consacré à propos de responsabilité administrative. D’autres nombreux exemples existent dans la géographie et la toponymie française et ce, de façon positive comme historique à l’instar de la mention de ce bois vendéen aujourd’hui dénommé « de Céné » et autrefois qualifiée « de la Chatte ».
On relève par ailleurs, dans le contentieux administratif, de nombreuses parties dénommées Chat, Le Chat ou encore Chatte (avec ou sans accent aigu sur le e) ainsi qu’on en a déjà cité quelques mentions en introduction au sein du Lebon. Il existe de la même manière de très nombreuses personnes morales impliquées dans des contentieux publics et répondant aux dénominations félines à l’instar de cette entreprise dite du « Chat noir[48] » objet d’un contentieux fiscal[49].
De la commune de Chatte (Isère). Surtout, il nous faut mentionner, parmi les collectivités territoriales françaises, la ville de Chatte qui se trouve en Isère, entre Valence et Grenoble, aux confins du Parc naturel du Vercors.

« L’Ecole des garçons de Chatte » / Editeur Cumin (circa 1920) ;
Coll. personnelle de l’auteur
En droit administratif, la commune ne se distingue pas particulièrement de ses circonscriptions limitrophes et l’on ne croit pas savoir qu’à la Faculté de Droit de Grenoble un ancien professeur de Droit administratif à l’instar d’un Jules Mallein[50] s’y soit installé ce qui lui aurait donné un attrait supplémentaire et un rapport à la matière[51].
La commune de Chatte est ainsi mentionnée au Lebon et sur Légifrance, comme toutes ses consœurs territoriales et ce, sans fréquence particulièrement importante ou faible à relever. Dès 1864, ainsi, on mentionne un arrêt du Conseil d’État opposant un habitant de Chatte (un Chattois) à la ville à propos d’une « voiture à quatre roues » non déclarée et qui aurait conséquemment échappé à l’imposition communale[52]. On trouve de même (et on en apprécie l’aléa) une jurisprudence de 1888[53] dénommée Sieur Mathieu c. Commune de Chatte également à propos d’un contentieux fiscal revenant sur la qualification dudit Mathieu comme « facteur de denrées et marchandises » assujetti et imposé au rôle de Chatte au regard de patentes commerciales. Plus proches de nous, temporellement, on pourra signaler quatre arrêts de la CAA de Lyon et deux décisions du juge de cassation mettant Chatte en avant :
- CAA de Lyon, 06 mars 2001, Alain X. (req. 97LY02926) ; à propos de l’indemnisation demandée par un pharmacien ;
- CAA de Lyon, 03 octobre 2017, Epoux G. & alii (req. 16LY00376) ; concernant un permis de construire contesté ;
- CAA de Lyon, 07 juin 2018, Société Sindaro (req. 15LY03166) ; s’agissant de la survenance potentielle d’un aléa dans l’exécution d’un contrat de commande publique ;
- CAA de Lyon, 12 février 2021, Société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche (req. 18LY03565) ; à propos d’un lourd contentieux (et de son indemnisation) lors de la construction d’un centre aquatique de sports et de loisirs implanté sur Chatte.
Un deuxième contentieux est relatif à Chatte en matière d’implantation de la même officine pharmaceutique et a été jusqu’en cassation (cf. CE, 07 décembre 1994, Ministère de la Santé ; req. 150895) et il faut mentionner, pour clore cette liste, cet arrêt, également du Conseil d’État, de 2008 en matière fiscale[54].
Cela mentionné et évacué, Chatte n’a pas plus de rapport(s) avec le droit administratif que Montcuq dans le Lot ou Anus dans l’Yonne, non loin de Gland.
B. Du contentieux du « Chat » non animalier :
de l’informatique à la langue félidés
Demain les « chats » ? Dans sa série triptyque et romancée sur les Chats[55] (qui débute par l’ouvrage Demain les chats), Bernard Werber, faisant parler son héroïne Bastet, permet à son lecteur d’imaginer et d’appréhender des Chats aux personnalités et aux sensibilités si anthropomorphiques que le lecteur finit par les assimiler à des personnages humanoïdes aux capacités similaires même si leurs morphologies ne leur permet pas tout. Il en est ainsi du rôle de Pythagore, le « chat de la voisine » qui initie l’héroïne à l’informatique, à l’accès via Internet à la connaissance universelle et conséquemment à ces autres « chats » qui ne sont pas des « Chats » animaliers mais des forums en ligne (des « chats ») où l’on peut converser et échanger (en anglais : discuter mais désormais aussi en français, « chatter » ou « tchatter » si l’on en reprend la dernière définition qu’en offre en 2021 le Dictionnaire Le Robert).
Le contentieux administratif, singulièrement pendant les confinements pandémiques dus à la Covid-19 s’est lui aussi mis à ses « chats » non félidés mais informatiques et ce, non seulement largo sensu parce que le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 (portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif) engage de plus en plus au Télérecours et aux téléservices informatiques mais aussi parce que plusieurs décisions[56] ont fait état de visioconférences et de visiocours (sic) ainsi que de « chats » tenus à distance dans des Universités et établissements d’enseignement supérieur[57].
Le Chat, surtout petit, fait vendre. Que les Chatons fassent vendre est une évidence commerciale que ne renierait pas le groupe Henkel, aujourd’hui dépositaire de la marque originellement de savon (et désormais essentiellement de lessive et accessoirement de savon) Le Chat sur la base d’un savon « dit » de Marseille[58] propulsé par la savonnerie provençale Fournier-Ferrier. En effet, si le Chat – surtout noir et adulte – inquiète voire effraie, la Chaton représenté souriant (et sans griffes acérées) rassure et attendrit à l’instar d’une peluche d’enfance.
C’est le ressort avec lequel joue également, dans la tradition nippone, le Maneki-neko (littéralement le chat invitant), un porte-bonheur assis et souriant, levant la patte (gauche ou droite) en signe (respectivement) de bienvenue aux visiteurs et/ou à leur argent. La force de ce Chaton irrésistible se retrouve aussi par exemple, dans les arts, à travers cette célèbre étude de Léonard de Vinci proposant une Madonna del gatto (circa 1480) imaginant un Chaton né parallèlement à l’enfantement christique. Plus récemment, on imagine bien que si Marine Le Pen[59] a décidé de faire tant de photographies avec son élevage de Chats, c’est aussi pour actionner cette « carte » de l’attendrissement que provoquent les Chatons.
C’est aussi ce que nous a rapporté, après enquête, M. Morgan Sweeney, nous rappelant qu’en octobre 2013 (les 12 et 13) lors du salon du livre du Mans, il avait pu faire l’expérience suivante dans le cadre d’un stand éditorial : dès qu’il mettait en avant, avec ses acolytes, des photographies de Chatons sur une tablette numérique installée près des ouvrages à vendre, un public se créait et venait s’intéresser spontanément audit stand comme si les Chatons attiraient les foules par leur bienveillance. Le Chaton fait manifestement vendre ce qui explique, qu’en contentieux administratif également, on trouve mention de marque qui y font appel à l’instar – toujours depuis l’enfance – dès « langues de chat » qu’un arrêt de la CAA de Paris[60] vint évoquer à propos de tarifs douaniers et d’importations contrôlées.
D’une fiction, l’autre ? On s’est déjà positionné, à plusieurs reprises et à titre personnel, sur le fait qu’à nos yeux tout être vivant (et même tout être humain non vivant à l’instar des cadavres) mériterait – afin d’être protégés – d’être repensés au travers d’une nouvelle classification juridique des personnes et des choses qui ferait rentrer, certes de manière fictive mais comme tout instrument juridique l’est, les êtres vivants non humains (Mer méditerranée, Chats ou encore Arbres et tous les êtres vivants de la faune et de la flore) au sein d’une catégorie de « personnes » actrices et non uniquement « objets » du Droit. Certes, pour les animaux dont la Chatte comme pour les êtres arborés, cette personnification juridique implique nécessairement la désignation d’un représentant humain mais ceci est tout aussi raisonnable ou déraisonnable que l’hypothèse qu’existe une personnalité juridique sociétale ou associative qu’incarne un représentant humain alors que, de facto, ni l’association ni la société, n’existent matériellement et physiquement. La proposition a notamment été portée en France par notre collègue Jean-Pierre Marguenaud à propos des animaux[61] mais la doctrine, majoritaire, y est toujours réfractaire et considère souvent que les promoteurs de la personnification juridique ne seraient que des utopistes aux valeurs plus métaphysiques sinon politiques que juridiques[62]. Toutefois, comme il ne s’agit pas, fondamentalement, de droit administratif, on ne développera pas ici notre sentiment[63] (que l’on peut cela dit rapprocher de notre démonstration à propos de la personnification désirée d’un autre être vivant : l’Arbre[64]).
Une patte de / dans notre patrimoine culturel ? Et si – comme on le proposait en 2017 au sein des Mélanges dédiés en hommage à Annie Héritier[65] – on faisait une assimilation des Chats à ce patrimoine culturel qui était si cher à la récipiendaire de l’hommage précité ?
Des Chats en peintures, en statues, en photographies, en littérature et même en musique(s) ; bref, dans l’Art, il y en a des millions. Qu’on songe ainsi aux représentations millénaires de la Déesse égyptienne antique Bastet, divinité de la « joie du foyer », que l’on peut par exemple admirer dans plusieurs statuettes – notamment en bronze – exposées dans les musées du Louvre ou encore – évidemment – du Caire. Qu’on pense également au Chat nommé Babou de Salvador Dali que l’on retrouve dans plusieurs célèbres photographies déjantées de l’artiste ou encore au tableau des Noces de Cana de Veronese qui fait également apparaître un petit félin joueur. Outre le Garfield contemporain de Jim Davis, citons aussi le cas amusant de cette peintre russe, Svetlana Petrova, qui a intégré dans des copies de toiles célébrissimes (comme la Joconde notamment) son gros Chat Zarathustra au milieu des célébrités ! Le Chat est donc déjà bien, sous cet aspect, dans notre patrimoine culturel. Il l’est également dans de nombreuses îles ou endroits inséparables de leurs populations félines : Aoshima, « l’île aux Chats » japonaise ; la plupart des cimetières où ils évoluent en Méditerranée ; tous ceux que l’on voit errer à Athènes, au Caire ou encore à Rabat comme s’ils étaient là avant nous et que nous étions là pour eux sinon pour les déranger. Ces lieux sont inséparables des Chats. Outre leurs représentations en arts, les Chats ne font-ils conséquemment pas partie du patrimoine culturel en ce sens ; eux qui animent tant d’endroits culturellement chargés et reconnus comme tels ?
Récemment, de façon itinérante et sur les domaines publics des plus grandes métropoles françaises, des statues en bronze du célèbre Chat de Philippe Geluck[66] ont même été temporairement implantées à Paris puis à Bordeaux et désormais à Caen, à l’heure où nous écrivons (septembre 2021).
Le Chat est décidément bien implanté dans le droit administratif (ici domanial et des biens).
De la Nation & du patrimoine culturel. Annie Héritier a démontré avec succès que l’art était une composante essentielle de la Nation, fût-elle une fiction ; que la Nation sans Art n’avait ni sens ni peut-être même intérêt au même titre que l’Histoire ou encore la Langue. Comment ne pas la suivre ?
Cela dit, dès que l’on admet l’existence même d’un « patrimoine » (culturel ou non) se pose a priori au moins la question – en Droit – de son propriétaire. Admettrait-on l’hypothèse d’une Nation propriétaire sachant de surcroît que, de facto, les Chats n’appartiennent à personne et quiconque croit en posséder un ou plusieurs se trompe ! Soit ce sont eux qui nous possèdent (très probable puisque nous les servons) soit nous – et la Nation – n’en serions que les gardiens protecteurs et ce, à l’instar des maires précités gardiens des chats « libres » et en colonies sur leurs territoires.
Autre hypothèse, que les études récentes sur les biens communs[67] ravivent, celle – précisément – d’une impossible propriété par le biais d’une notion comme celle de « patrimoine commun » que l’on peut retrouver, pour l’Art par exemple, dans les mots sublimés par Annie, d’Antoine Quatremère de Quincy selon lequel l’Art appartenait[68] « à tous les peuples ; nul n’a le droit de se l’approprier ou d’en disposer arbitrairement. Celui qui voudrait s’attribuer sur (…) les moyens d’instruction une sorte de droit et de privilège exclusif serait bientôt puni de cette violation de la propriété commune, par la barbarie et l’ignorance ». Alors résumait notre amie avec une extrême justesse[69] :
« l’Etat » n’est ici « que le gardien ou le gérant des objets d’art désignés dans l’ordre du temps. Le propriétaire actuel n’est qu’un médiateur, entre les générations ne possédant que l’usufruit de la réalité symbolique ou morale d’un bien possédé par l’histoire, dont la France s’arroge l’exercice de la propriété ». La question d’une hypothèse de l’Art comme bien commun ne lui avait du reste pas échappé[70].
De la Nation comme gardienne & protectrice. C’est l’hypothèse que nous voudrions ici former à titre conclusif. La Nation n’est a priori pas propriétaire du patrimoine culturel – comme des Chats – ! Elle en est davantage – à nos yeux – la gardienne protectrice de la même manière que la Couronne d’Ancien Régime était gardienne (mais non propriétaire) du domaine royal ou à l’image de ce que Jean-Baptiste Victor Proudhon décrivait dans son Traité du domaine public en 1834 lorsqu’il envisageait – précisément – un tel domaine sans propriétaire mais uniquement sous la protection bienveillante de représentants publics de la Nation. Récemment, à propos des corps morts[71], nous avons également, opté pour la même proposition : considérer que les cadavres ensevelis dans nos cimetières ou dispersés en cendres dans la Nature ou les sites cinéraires étaient précisément non des choses mais des personnes placées sous la garde et la protection de la républicaine Nation. Et s’il en était de même pour les inappropriables félins ?
Duetto Buffo di Due Gatti. Ce ne serait pas à Gioacchino Rossini (même si chacun le lui attribue) que l’on devrait le célèbre duo des Chats (duetto buffo di due Gatti) qu’interprètent souvent des sopranos duettistes en fin de concert afin d’en réveiller l’assemblée mais à Robert Lucas de Pearsall, sous le pseudonyme de Berthold. Il nous a semblé opportun, également, de conclure par ses paroles en laissant soin au lecteur d’aller s’enivrer (en musique) de l’interprétation qu’en donnent Ann Murray & Felicity Lott dans un exceptionnel enregistrement, pour la BBC, au Royal Albert Hall le 14 septembre 1996[72]. Et si le lecteur ne comprend pas les liens entre le Droit (même administratif) et l’Opéra, on se permettra, avec révérence, de le renvoyer à quelque ouvrage encore récent[73].
« Miau
Miau
Miau
Miau
Miau
Miau
Miau
Miau miau
Miau miau
Miau-miau miau
Miau miau
Miau miau
Miau
Miau miau
Miau miau
Miau miau
Miau miau
Miau miau
Miau miau
Miau miau
Miau
Miau
Miau miau
Miau miau
Miau
Miau miau
Miau miau
Miau miau
Miau
Miau ».
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), Dir. Pech / Poirot-Mazères
/ Touzeil-Divina & Amilhat ;
L’animal & le droit administratif ; 2021 ; Art. 369.
[1] Le seul véritable greffier que l’on affectionne est M. Steven G. mais il s’avère qu’en argot, un « greffier » est aussi le nom donné aux Chats noirs dont le plastron est blanc à l’instar de la « cravate batiste » blanche des uniformes stolaires des avocats et des greffiers. Sur ledit costume, on se permettra de renvoyer à : Touzeil-Divina Mathieu, « Uniformes (civils) des fonctions publiques nationales : entre Ordre & Egalité » in Chansons & Costumes « à la mode » juridique & française ; Toulouse, L’Epitoge ; 2016 ; p. 161 et s.
[2] Dead Poets Society ; de Peter Weir (1989) avec notamment Robin Williams dans le rôle du professeur (et « capitaine ») John Keating.
[3] Par exemple s’agissant de la décision : CE, 04 novembre 2020, M. B. (req. 440963) avec nos obs. in Jcp A ; 13 novembre 2020 ; n° 46.
[4] On fait ici (bien évidemment) référence au terme de « Chatte » comme synonyme de chance ; expression notamment popularisée sinon affectionnée par Sophie Prosper après Benoît Paire qui l’a célébrée sur les cours de Roland Garros ainsi que par des publicités humoristiques mettant en avant sa célèbre punchline sportive exultée en juin 2019 lorsqu’il affronta Kei Nishikori en 8e de finale sur le court Suzanne Lenglen et qu’il perdit. Cf. ligne : https://www.eurosport.fr/tennis/la-chatte-qu-il-a-il-y-a-un-an-benoit-paire-s-illustrait-sur-le-lenglen_vid1317290/video.shtml.
[5] Pour d’aucuns et, par extension métonymique, la « Chatte » est aussi un synonyme de la femme comme on peut l’entendre dans la chanson de Fernandel « Félicie aussi » : « Afin d’séduire la petite Chatte, j’l’emmenai dîner chez Chartier ! Comme elle est fine et délicate. Elle prit un pied d’cochon grillé ».
[6] Sur le site Internet (www.chatsnoirs.com), elle est connue sous l’identification n°1740 et appartient, à ce titre, au très select Club des chats noirs : http://www.chatsnoirs.com/pages/chat-noir/club-chats-noirs-1701-a-1750.html#page4. Elle gère par ailleurs son propre compte sur réseau social :
https://www.facebook.com/chaconne.debach où l’on ne manquera pas la critique, acérée, de son livre pourtant préféré : Crimes & chat-timent.
[7] L’une des premières occurrences du terme est par exemple celle relative au nom d’une partie (le sieur Chatte) dans l’affaire opposant le susdit à la ville d’Auxerre dans un contentieux fiscal de patentes dont il contestait le montant à acquitter en sa qualité de marchand de cristaux (cf. CE, 18 septembre 1854, Chatte ; Rec. 839). Au début du siècle suivant, un autre contentieux du même nom est ouvert par la veuve Chatte : cf. CE, 28 mai 1909, Veuve Chatte c. Ministère de la Marine ; Rec. 539. L’année suivante (cf. CE, 28 décembre 1910, Veuve Jan née Chatte c. Direction des douanes ; Rec. 1030), le Recueil Lebon mentionne même une dénommée Jan née Chatte autrefois mariée à un préposé des douanes dont la pension de réversion était contestée.
[8] Comme en témoigne au présent dossier, la très belle contribution de M. Mathias Amilhat.
[9] Ce n’est pas une coquetterie éditoriale mais un désir conscient et volontaire de l’auteur de matérialiser, lorsqu’il le mentionne personnellement (et non au sein d’une citation), une majuscule aux termes « Chat » et « Chatte » de la présente étude et ce, précisément, pour appuyer l’importance qu’il leur attribue.
[10] A priori vivant dans le cadre fréquent des études mais son cadavre peut également donner lieu à contentieux et à étude juridique.
[11] Modification portée par la Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (en son art. 02).
[12] Comme le déclare par exemple la Fondation 30 millions d’amis sur son site :
[13] Le chiffre neuf était sacré chez les Egyptiens qui l’ont associé à celui des vies du Chat censé être résistant aux malheurs que des humains ne pourraient supporter. En témoigne le très bel ouvrage : Bobis Laurence, Les neuf vies du chat ; Paris, Gallimard ; 1991. Citons également, par extension, la qualification de ce fouet de torture, le « chat à neuf queues » qu’évoque un autre grand livre de Frédéric Othon Théodore Aristidès dit Fred à travers sa série des Philémon : Le chat à neuf queues ; Paris, Dargaud ; 1978.
[14] Et ce, même si la blague la plus courue chez tous les amateurs de Chats, consiste à affirmer que « nous » êtres humains habitons « chez » eux et non l’inverse tant ils semblent parfois se considérer comme nos Dieux !
[15] Certains les associent ainsi aux Templiers comme le rappelle, parmi bien d’autres associations : Doumergue Christian, Le Chat ; légendes, mythes & pouvoirs magiques ; Paris, L’Opportun ; 2018 ; p. 55 et s.
[16] Citons à cet égard l’hypothèse dite du mandragot ou matagot ce « Chat noir » (mais également dit « d’argent ») diabolique qu’un sorcier ou une sorcière obtiendrait du Diable lui-même en échange de son âme humaine. La célèbre nouvelle (1843), traduite par Charles Baudelaire, d’Edgar Allan Poe (The Black Cat ; le Chat noir) en est la parfaite illustration. Par ailleurs, rappellera-t-on, « les Chats noirs restent en refuge » du fait de cette mauvaise réputation tenace, « 24 % plus longtemps que les autres » (Arnaud Mathilde, Chat noir ; Paris, Les grandes personnes ; 2020 ; p. 01). Le dernier ouvrage cité est un exceptionnel opus en pop-up artistique.
[17] Lettre dont des extraits sont reproduits in Les neuf vies du chat ; op. cit. ; p. 131.
[18] Il s’agit d’un triptyque exposé au Musée national des Arts antiques de Lisbonne ; le chat figurant sur le panneau de droite.
[19] L’affaire est effectivement portée devant le juge administratif du fait, en l’espèce, de la présence de travaux publics : CAA de Nancy, 04 août 2005, Eric X. ; req. 01NC00307.
[20] Ce qui distingue, une nouvelle fois, le chat du chien ; ce dernier (au titre de l’art. L. 211-23 du Code rural également) est estimé divaguant au regard d’un critérium d’action de chasse ainsi que d’un périmètre, bien plus réduit, de seulement cent mètres de distance à son maître.
[21] A propos de leur adaptation ultramarine sur l’île de la Réunion : CE, 10 novembre 2004, Association Droit de cité ; req. 253670.
[22] Sur cette obligation : cf. CE, 13 juillet 2012, req. 358512.
[23] Plusieurs d’entre elles militent en ce sens pour des campagnes de stérilisation qui permettent d’éviter celles, plus catégoriques, d’abattage.
[24] CE, Sect., 10 mars 1933, Dame Le Clezio & Sieurs Chillon & Cordier ; Rec. 300.
[25] CE, Ass., 07 octobre 1977, Roland X. ; req. 05064.
[26] A propos d’un arrêté du maire de Béziers : CAA de Marseille, ord., 30 novembre 2016 ; req. 16MA03774.
[27] Cf. en ligne : « Errance animale et co-errance du droit » par Loïc Peyen.
[28] Cf. en ce sens : CE, 03 mai 2004, fondation assistance aux animaux ; req. 249832.
[29] Https://www.youtube.com/watch?v=XkOYGrZQqmU.
[30] A leur égard : Lucaci Dorica, 100 Chats qui ont fait l’histoire ; Paris, L’Opportun ; 2015.
[31] Cette idée se retrouve encore de façon contemporaine in Divina-Touzeil Flora & Joquel Patrick, Regards félins ; Mouans-Sartoux, Editions de la Pointe Sarène ; 2021 (en cours).
[32] Partant, c’est à Richelieu, convainquant Louis XIII, que l’on doit la « réhabilitation » des Chats en France alors que le monde médiéval en avait fait des diableries incarnées.
[33] La série dessinée compte à ce jour dix albums à la suite de : Sfar Joann, Le chat du rabbin ; Tome 1. La Bar-Mitsva ; Paris, Dargaud ; 2002.
[34] Chateaubriand François-René (de), Mémoire d’outre-tombe (…), Paris, Penaud ; 1849 ; livre 29, chap. 04.
[35] Dont le compte Twitter (en langue anglaise) est : @ChoupettesDiary sous l’appellation Choupette Lagerfeled.
[36] Dans la série éponyme d’animation créée en 1983 par MM. Bruno Bianchi, Andy Heyward et Jean Chalopin.
[37] En ce sens : CAA de Lyon, 11 juillet 2019, Mme B & alii. ; req. 18LY00500.
[38] Pour l’un des plus accessibles et illustrés : Le Grand livre des chats ; Paris, Deboree ; 2019.
[39] Cf. Maisonneuve & Touzeil-Divina Mathieu(x) (dir), Droit(s) du football ; Le Mans, L’Epitoge ; 2014.
[40] Cf. Löhrer Dimitri & Touzeil-Divina Mathieu (dir), Droit(s) du basket-ball ; Toulouse, L’Epitoge ; 2022 (en cours).
[41] Cf. CE, 06 juin 2018, Fédération féline française (req. 403977).
[42] Edition du 16 septembre 2021 ; article de M. Maxime Cartier qui nous a été indiqué (et on l’en remercie) par Mmes Flora D. et La Callas de Durcet (Orne).
[43] Cf. CAA de Paris, 27 octobre 2020, Mme F. (req. 19PA01303).
[44] Pour l’issue du contentieux et la mention d’un recours abusif : Cf. CAA de Lyon, Association Droit de vivre ; req. 13LY00620.
[45] CAA de Bordeaux, 02 juillet 2020, Mme H. & alii ; req. 18BX04317.
[46] CAA de Nantes, 28 février 2020, Mme H. & alii ; req. 19NT00205.
[47] CAA de Bordeaux, 16 mai 2013, Sci Lou ; req. 12BX02550.
[48] A l’instar du célèbre cabaret parisien qu’immortalisa Théophile Steinien dans ses lithographies dites de la « Tournée du Chat noir de Rodolphe Salis » (1896).
[49] CAA de Versailles, 17 septembre 2019, M. E. D. ; req. 18VE01237.
[50] On signale à son égard ses exceptionnelles Considérations sur l’enseignement du Droit administratif (Paris, 1857) notamment dues à plusieurs échanges antérieurs avec le doyen Foucart et à propos desquels on est revenu in Touzeil-Divina Mathieu, Eléments d’histoire de l’enseignement du droit public : la contribution du doyen Foucart ; Poitiers, Lgdj ; 2007.
[51] Cela dit, selon nos sources, c’est l’homonyme d’un autre grand professeur de Droit public qui est le Maire actuel de Chatte : André Roux et ce, depuis mars 2001.
[52] CE, 08 décembre 1864, Sieur Pellerin c. Commune de Chatte ; Rec. 964.
[53] CE, 20 janvier 1888, Sieur Mathieu c. Commune de Chatte ; Rec. 51.
[54] CE, 14 avril 2008, Société T2S ; req. 298777.
[55] Respectivement : Werber Bernard, Demain les chats ; Paris, Albin Michel ; 2016 ; Sa majesté des chats ; Paris, Albin Michel ; 2019 et La planète des chats ; Paris, Albin Michel ; 2020.
[56] Dont : CAA de Paris, 22 mai 2018, Sté Foretec ; req. 15PA03365 et autres.
[57] Voyez ainsi à propos du Cnam et d’un étudiant étranger à qui l’on a demandé de quitter le territoire français : CAA de Nancy, 02 février 2021, Mme A. ; req. 19NC02586.
[58] On se permettra, à l’égard, de l’huile d’olive et de sa part dans le savon « dit » de Marseille, de renvoyer à : « Droit, « Bio » & huile(s) d’olive : le cas du savon de Marseille » in Droit(s) du Bio ; Toulouse, l’Epitoge ; 2018 ; p. 135 et s.
[59] Cf. en ligne sur le site du journal Gala (si, si !) : « Marine Le Pen et les chats : sa passion interpelle » au 04 janvier 2021 : https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/marine-le-pen-et-les-chats-sa-passion-interpelle_461156.
[60] Cf. CAA de Paris, 05 avril 2018, Syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie ; req. 16PA02174.
[61] Marguenaud Jean-Pierre, « La personnalité juridique des animaux », Dalloz, 1998, p. 205.
[62] Betaille Julien, « La doctrine environnementaliste face à l’exigence de neutralité axiologique : de l’illusion à la réflexivité », Revue juridique de l’environnement, hors-série, n° 2016/HS16, p. 45.
[63] Par ailleurs, la contribution au présent dossier de Mme Sonia Desmoulin-Canselier en traite explicitement.
[64] Cf. Touzeil-Divina Mathieu, « L’Arbre, l’Homme & le(s) droit(s) » in L’Arbre, l’Homme & le(s) droit(s) ; ouvrage réalisé pour célébrer le 65e anniversaire de la parution de L’Homme qui plantait des arbres de Jean Giono (…) & en hommage au poète & ami des Arbres, Jean-Claude Touzeil ; Toulouse & Manosque ; 2019 ; p. 13 et s. Un large extrait s’en retrouve également en ligne : http://www.chezfoucart.com/2020/11/25/droits-de-larbre/.
[65] Touzeil-Divina Mathieu, « C comme Chat(s) de la Nation » in Les mots d’Annie Héritier. Droit(s) au Cœur & à la Culture ; Toulouse & Nice ; 2017 ; p. 45 et s. Les propos ci-après en sont directement issus.
[66] Dont l’œuvre dessinée et félidée a débuté par des strips dudit Philippe Geluck au journal Le Soir en 1983.
[67] On pense originellement à The tragedy of the Commons (de Garrett Hardin ; 1968) mais aussi et surtout aux réflexions issues du Dictionnaire des biens communs (Paris, Puf ; 2017) dirigé notamment par Marie Cornu.
[68] Quatremere de Quincy Antoine, Lettres à Miranda (…) ; Paris, 1796 ; Lettre I ; p. 90 ; cité par Heritier Annie ; Genèse de la notion juridique de patrimoine culturel (1750-1816) ; Paris, l’Harmattan ; 2003 ; p. 122 et s.
[69] Heritier Annie ; op. cit. ; p. 123.
[70] Cf. Heritier Annie, « Le Street Art, bien commun artistique ? » in Juris art, 1er avr. 2014, n° 12, p. 39 et s.
[71] Ce que nous avons développé en dernier état des lieux in Touzeil-Divina Mathieu, Dix mythes du droit public ; Paris, Lextenso ; 2017 ; chap. 10 ; p. 367 et s.
[72] Heureusement en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=fJAo3D5GliA.
[73] Touzeil-Divina Mathieu, Stirn Bernard & Rousset Christophe (dir.), Entre opéra & Droit ; Paris, LexisNexis ; 2020.