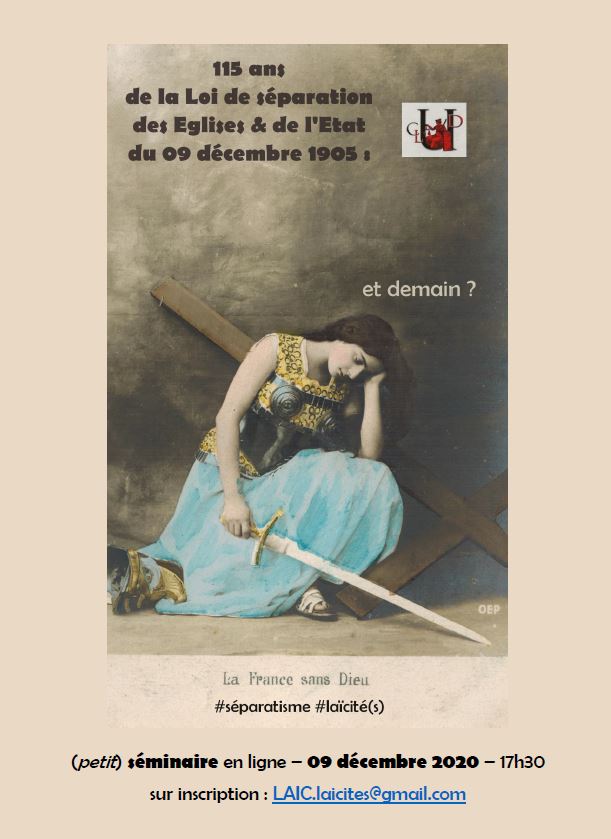par M. Henri BOUILLON
Maître de conférences à l’université de Bourgogne Franche-Comté – membre du CRJFC (EA 3225)
Le droit de
l’urbanisme est un laboratoire idéal pour analyser la régularisation des actes
administratifs. La régularisation est désormais une technique incontournable en
droit administratif, et elle est en conséquence de plus en plus étudiée par la
doctrine. La constitution de ce dossier par le JDA en atteste. Mais en dépit de cette attention doctrinale
croissante, la régularisation reste difficile à circonscrire tant elle est
polymorphe. La diversité des domaines où elle s’inscrit, et dont les articles
ici rassemblés montrent l’hétérogénéité, révèle aussi la plasticité de cette
technique, dont les multiples facettes ne se laissent pas percevoir aisément.
Il convient de cerner la notion de régularisation par opposition à celle, qui lui est sœur, de réfection. Au sens strict, la régularisation est la régularisation d’un acte juridique : c’est le mécanisme qui consiste à purger un acte administratif, unilatéral ou contractuel, d’un vice qui l’entache, afin de lui épargner une censure qui le ferait disparaître de l’ordre juridique. Cette régularisation permet de faire perdurer l’acte juridique (protection de la sécurité juridique), tout en le purgeant de ses irrégularités (protection de la légalité) : la légalité de l’acte est rétablie sans que l’ordre juridique s’en trouve modifié. Avec cette première technique, coexiste la régularisation d’une situation de fait. En ce second cas, l’acte juridique entaché d’irrégularité est banni de l’ordre juridique mais, pour que la situation de fait qu’il régissait ne soit pas privée de base juridique, l’administration adopte un nouvel acte pour couvrir juridiquement cette situation : il s’agit là d’une réfection de l’acte, qui « procède (…) à la confirmation d’une situation factuelle par octroi d’une nouvelle base juridique » (E. Langelier et A. Virot-Landais, « Mérites et limites du recours à la régularisation des actes viciés », JCP A 2015, n° 30-34). La différence fondamentale entre ces deux hypothèses est que, dans la régularisation stricto sensu, l’acte juridique perdure, alors que la réfection consiste en l’adoption d’un nouvel acte pour assurer le maintien d’une situation de fait. Tiré du droit de la fonction publique, l’exemple de l’arrêt Cavallo (CE, Sect., 31 décembre 2008, n° 283256, Rec.) fait saisir cette distinction. L’arrêt impose à l’administration de proposer à l’agent public contractuel, dont le contrat est irrégulier, « une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement » ; il s’agit là d’une régularisation de l’acte. Mais « si le contrat ne peut être régularisé », l’administration doit, dans la limite des droits résultant du contrat initial, proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut, tout autre emploi, « afin de régulariser sa situation » ; il s’agit alors d’une réfection, destinée à remplacer le contrat initial pour pérenniser la situation de l’agent. Il ne sera présentement question que de la régularisation des actes.
Même ainsi
délimité – et réduit –, le sujet reste vaste. Car le droit de l’urbanisme
connaît diverses hypothèses de régularisation d’un acte administratif : la
régularisation peut y intervenir à l’initiative de l’administration ou à
l’initiative du juge administratif, soit a
priori, c’est-à-dire durant l’instance et avant le jugement définitif de
l’affaire (articles L. 600-5-1 et L. 600-9 du code de l’urbanisme),
soit a posteriori, c’est-à-dire après
annulation conditionnelle de l’acte par le juge administratif (article L. 600-5
du même code). C’est pour ce motif que l’étude du droit de l’urbanisme est
riche d’enseignements et que, compte tenu du recul que l’on commence à avoir
sur ces techniques, il permet d’apprécier les tenants et aboutissants de la
régularisation.
Il n’est pas
douteux que l’objectif de ces hypothèses de régularisation est, en toute
occurrence, de préserver la sécurité juridique, qui avait pu être précarisée
par des recours contentieux nombreux et parfois abusifs. La régularisation d’un
acte permet en effet de le maintenir en vigueur, en le purgeant des illégalités
détectées. Elle évite la censure totale ou partielle de l’acte, avec l’effet
rétroactif qui s’attache à l’annulation juridictionnelle, et favorise ainsi la
stabilité du droit. Or pour des opérations d’urbanisme, qui engagent le plus
souvent des travaux et des frais importants, la permanence des règles encadrant
ces opérations est de la toute première importance. Le rapport Pelletier,
intitulé Propositions pour une meilleure
sécurité juridique des autorisations d’urbanisme, de février 2005, y
insistait (il est à l’origine de certains des mécanismes que nous allons
évoquer).
Mais, comme tout
ce qui est humain est imparfait, cet avantage de la régularisation est
contrebalancé par un inconvénient qu’on ne doit pas négliger : l’oubli de
la révérence due au principe de légalité, principe traditionnel du droit
administratif, cœur de l’État de droit et qui impose à l’administration le
plein respect des règles de droit. Certes, de prime abord, l’atteinte à ce
vénérable principe paraît bénigne : la légalité est respectée puisque les
vices entachant l’acte administratif sont régularisés. Mais la purification de
l’acte n’équivaut pas à son immaculée conception. Régulariser un vice de
procédure, par exemple, n’est jamais totalement équivalent au respect préalable
de cette procédure. Une règle de forme n’a en effet de sens que si elle précède
l’adoption de l’acte et concourt à la qualité de celui-ci. Si une autorité
administrative qui doit émettre un avis n’est consultée, pour régularisation,
qu’après la mise en œuvre de l’acte, l’avis n’aura en rien amélioré la
formation de l’acte adopté : la finalité de l’avis, quelle qu’elle soit
(autorisation, recommandation, prise en compte d’intérêts différents, etc.), est méconnue. Ainsi, par exemple,
de la régularisation de l’avis omis de l’Architecte des bâtiments de France
(CAA Paris, 11 juillet 1997, Serane,
Kahn-Shriber et Hamel, n° 95PA03910). La vanité de cette
régularisation est comparable, si l’on nous permet ce futile rapprochement, à
celle que fait l’automobiliste qui n’actionne son clignotant qu’après avoir
changé de voie sur l’autoroute, car la finalité de cette obligation est
d’avertir les autres automobilistes de ses intentions. La légalité est
formellement respectée, mais on ne peut néanmoins s’empêcher de penser qu’il y a
là un artifice peu satisfaisant, qui méconnaît l’utilité et la finalité de la
règle violée.
En présentant
les mécanismes de régularisation en droit de l’urbanisme, il ne paraît donc pas
inutile de s’interroger incidemment sur l’équilibre établi entre la légalité et
la sécurité juridique. Or il est très net que, ces dernières années, la
sécurité juridique est avantageusement promue au détriment de la légalité. Le
législateur a joint ses efforts à ceux du juge pour favoriser la sécurité
juridique des différents actes d’urbanisme et sécuriser ainsi les opérations
qu’ils permettent ou encadrent.
Pour expliquer
le plus simplement possible les subtilités de la régularisation en droit de
l’urbanisme, cette présentation s’appuiera sur la distinction entre régularisation
a priori et régularisation a posteriori. Seront d’abord évoqués les
différents mécanismes de régularisation a
priori, c’est-à-dire intervenant avant la décision du juge administratif
(I). Pourra ensuite être étudié l’article L. 600-5, qui institue un
mécanisme de régularisation a posteriori,
effectuée après la censure de l’autorisation d’urbanisme par le juge
administratif (II).
I) La
régularisation a priori
La régularisation a priori intervient avant la décision du juge administratif, le plus souvent en cours d’instance. Contrairement à la régularisation a posteriori donc, cette régularisation n’intervient pas à la suite d’une annulation juridictionnelle. « Elle est toutefois intimement liée à un risque d’annulation puisqu’en l’absence de régularisation dans le délai imparti par le juge, l’annulation interviendra immanquablement » (S. Roussel et C. Nicolas, « Documents d’urbanisme : régulariser à tout prix », AJDA 2018, p. 272). Plus concrètement, « la régularisation a pour effet de purger le vice affectant l’acte : la conséquence pour le litige est radicale, il perd son objet » (R. Noguellou, « Régularisation et droit de l’urbanisme. Note sous CE, Sect., 22 décembre 2017, Commune de Sempy », RFDA 2018, p. 370).
Deux articles du
code de l’urbanisme consacrent la faculté pour le juge d’offrir à
l’administration la possibilité de régulariser son acte durant
l’instance : l’article L. 600-5-1 pour les autorisations d’urbanisme
(A) et l’article L. 600-9 pour les documents d’urbanisme (B). Le juge a
aussi admis que l’administration puisse, durant l’instance, procéder
spontanément à cette régularisation (C).
Le grand
avantage de ces techniques est que la régularisation est aux mains de
l’administration. C’est elle qui procède à la régularisation – quoique ce
ne soit pas toujours spontanément –, ce qui évite tout soupçon de juge-administrateur, même si la
régularisation s’opère toujours sous le contrôle du juge qui appréciera si
celle-ci suffit à couvrir les irrégularités. Toutefois la question de
l’articulation entre légalité et sécurité juridique perdure, puisque la
régularisation colmate les fissures faites à la légalité afin de maintenir
l’acte en vigueur, sans que cette réparation soit équivalente à un plein
respect de la légalité de l’acte dès son édiction.
A) La
régularisation a priori des
autorisations d’urbanisme
L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 a introduit dans le code de l’urbanisme un article L. 600-5-1. Il institue un mécanisme particulier de régularisation a priori des autorisations d’urbanisme, c’est-à-dire des permis de construire, permis de démolir et permis d’aménager. Selon cet article, « le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ». L’article dispose ainsi que le juge peut, par un jugement avant-dire-droit, surseoir à statuer et demander la régularisation du permis à l’administration. Si, dans le délai imparti par le juge, l’administration délivre un permis modificatif pour supprimer l’illégalité relevée, la régularisation ainsi opérée permet au juge de déclarer l’acte légal et de mettre fin à l’instance, qui a perdu son objet. La sécurité juridique est ainsi pleinement garantie, puisque l’acte, même irrégulier, se trouve pérennisé suite à sa comparution devant le juge.
Dans quelles conditions peut jouer l’article L. 600-5-1 ? L’arrêt SCI Rivera Beauvert (CE, 30 décembre 2015, n° 375276, inédit) a précisé ces conditions dans un considérant de principe clair : le juge administratif doit « apprécier si le vice qu’il a relevé peut être régularisé par un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si, d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés – sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l’absence d’achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d’instruction en ce sens – et si, d’autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale » (point 4).
De façon générale donc, l’article L. 600-5-1 ne peut être mis en œuvre que si l’autorisation d’urbanisme peut être régularisée par un permis modificatif. Le permis modificatif est un acte de régularisation : il s’incorpore au permis initial, dont les irrégularités sont effacées, qu’il s’agisse de la méconnaissance d’une règle de fond (CE, 9 décembre 1994, Sarl Séri, n° 116447, T.) ou d’un vice de forme ou de procédure (CE, 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers, n° 238315, T.). Le permis modificatif modifie – comme son nom l’indique – le permis initial sans s’autonomiser de lui. Et à compter du jugement avant-dire-droit prononcé sur le fondement de l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif pourront être invoqués (CE avis, 18 juin 2014, Société Batimalo, n° 376760, Rec. point 4). Cette restriction est logique dans la mesure où les autres dispositions du permis initial (celles qui n’ont pas à être régularisées) ont été reconnues légales par ce jugement avant-dire droit, l’article L. 600-5-1 précisant que le juge ne peut permettre la régularisation qu’« après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés » ; ces dispositions ne pourront plus être remises en cause dans la suite de l’instance, alors même que la nouvelle articulation dont elles feront l’objet avec les dispositions régularisées par le permis modificatif pourrait faire douter de leur légalité future. Par un arrêt Association NARTECS (CE, 6 avril 2018, Association Nature, aménagement réfléchi, territoire, environnement, culture sauvegardés, n° 402714, T. point 8), le Conseil d’État a précisé les conditions de la contestation du permis modificatif : les parties peuvent le contester, non seulement pour ses vices propres, mais encore pour « le motif que le permis initial n’était pas régularisable », notamment s’il était entaché d’un vice d’une telle gravité qu’il ne pouvait être régularisé.
Toute la
question est alors de savoir dans quelles hypothèses un permis de construire
modificatif peut être émis. La jurisprudence SCI Rivera Beauvert subordonne cette édiction à deux
conditions :
Premièrement, cette jurisprudence imposait que « les travaux autorisés par le permis initial ne [soient] pas achevés ». Cette condition était logique dans la mesure où l’achèvement des travaux implique en principe que l’autorisation d’urbanisme n’ait plus lieu d’être, puisqu’elle n’a plus d’objet. Cette condition a toutefois été abandonnée par la jurisprudence. Un arrêt Bonhomme (CE, 22 février 2017, n° 392998, Rec. point 3) indique que l’article L. 600-5-1 ne subordonne pas « par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n’aient pas été achevés ». L’objectif est clair : les travaux ayant été réalisés, la régularisation du permis les ayant autorisés permet de mettre les constructions à l’abri de toute remise en cause ultérieure. La sécurité juridique des travaux se trouve ainsi garantie par la régularisation de l’acte les ayant autorisés. Toutefois, l’autorisation d’urbanisme disparaissant en principe avec l’achèvement des travaux qu’elle permet, on se trouve ici à la frontière entre réfection (régularisation de la situation, des constructions ici) et régularisation de l’acte administratif : la régularisation d’un acte devenu sans objet, qui vise à assurer une base juridique légale à des constructions, ne se confond-elle pas avec une réfection spécifique, consistant à faire revivre un acte éteint (et non pas seulement à régulariser un acte en vigueur) pour éviter la remise en cause des constructions ?
La deuxième condition, logique au regard de la technique de régularisation par l’entremise d’un permis modificatif, est que la régularisation ne porte pas atteinte à la conception générale de l’ouvrage. L’idée est qu’un permis modificatif qui bouleverserait la conception générale des travaux autorisés serait en réalité un nouveau permis, puisqu’il concernerait en quelque sorte des travaux de facture différente (CE, Sect., 26 juillet 1982, Le Roy, n° 23604, Rec.). Le Conseil d’État retient toutefois une conception très souple de ce qu’est la conception générale de la construction, en jugeant par exemple que l’implantation, les dimensions ou l’apparence de la construction ne sont pas à intégrer dans sa conception générale et peuvent ainsi faire l’objet d’un permis modificatif (CE, 30 décembre 2015, SCI Rivera Beauvert, n° 375276, inédit).
Ce mécanisme
présente une parenté étroite avec celui institué à l’article L. 600-9 du code
de l’urbanisme, qui ne porte néanmoins pas sur les mêmes actes.
B. La
régularisation a priori des documents
d’urbanisme
Issu de l’article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme s’inspire du dispositif fixé à l’article L. 600-5-1, à cette différence importante qu’il ne vise pas les mêmes actes : tandis que l’article L. 600-5-1 concerne les autorisations d’urbanisme, l’article L. 600-9 permet la régularisation des schémas de cohérence territoriale (SCOT), des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des cartes communales. Hormis cette notable distinction, l’article L. 600-9 permet, à l’instar de l’article L. 600-5-1, à cette régularisation d’intervenir devant le juge, dans le cadre d’une instance unique. « Régulariser plutôt qu’annuler, donner plus rapidement, dans le cadre de l’instance initiale, une solution définitive au litige : tels sont les objectifs de ce texte » (J. Burguburu, « Régularisation et droit de l’urbanisme. Conclusions sur CE, Sect., 22 décembre 2017, Commune de Sempy », RFDA 2018, n° 2, p. 357).
Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9, constater, par une décision avant-dire-droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice relevé (CE, 12 octobre 2016, Kerwer, n° 387308, Rec.). Le juge est, dans ce dispositif, le « maître du jeu » (S. Roussel et C. Nicolas, « Documents d’urbanisme : régulariser à tout prix », AJDA 2018, p. 272) : il n’a pas besoin d’être saisi d’une demande des parties pour faire application de l’article L. 600-9. Il a, en outre, « le dernier mot, d’une part et en amont, sur la qualification du caractère régularisable de l’illégalité viciant l’acte litigieux, d’autre part et en aval, sur la régularisation à laquelle il est procédé » (ibid.). Par ailleurs, le Conseil d’État a autorisé le juge d’appel à faire application de l’article L. 600-9 alors que le premier juge n’avait pas estimé nécessaire ou possible de le faire (CE, Sect., 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n° 395963, Rec. point 4). Cela « témoigne de la volonté du Conseil d’État de prolonger autant que possible le temps de la régularisation devant les juges du fond, en dérogeant au besoin aux règles générales du contentieux administratif » (R. Bonnefont, « Possibilité de régulariser en appel une autorisation d’urbanisme annulée en première instance », AJCT 2018, p. 351). La sécurité juridique se trouve ici promue avec une vigueur toute particulière. Elle l’est d’autant plus que cette possibilité de régularisation évite que d’anciennes dispositions, parfois obsolètes, soient remises en vigueur suite à une annulation contentieuse : l’article L. 600-12 du même code précise en effet que « l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». La régularisation du document d’urbanisme évite ainsi de faire revivre l’ancien document.
Néanmoins, le
problème de la conciliation entre légalité et sécurité juridique est ici plus
pressant encore que dans le cadre de l’article L. 600-5-1, puisque les
actes concernés ne sont pas individuels mais ont une portée générale. Modifier
un SCOT, un PLU ou une carte communale, applicables par définition à
différentes situations, n’est pas nécessairement sans impact sur la sécurité
juridique, pourtant visée au premier chef par ce mécanisme, puisque la
modification peut se répercuter sur d’autres autorisations d’urbanisme
délivrées conformément au document modifié. Quant à la légalité, elle fait
l’objet de la même révérence artificielle : elle n’est prise en
considération que parce qu’elle a été initialement méconnue. D’ailleurs, le
mécanisme de l’article L. 600-9 soulève une difficulté importante :
il paralyse le principe selon lequel l’administration est tenue de ne pas
appliquer un règlement illégal, puisque l’administration a bel et bien fait
application d’un acte de portée générale qui était irrégulier au moment où il a
servi de base légale à la délivrance d’une autorisation individuelle, celui-ci
faisant simplement l’objet d’une correction a
posteriori en vue de gommer – rétroactivement – l’illégalité commise.
En revanche,
comme pour compenser la majoration de ces difficultés, l’article L. 600-9
limite les régularisations possibles, contrairement à l’article L. 600-5-1
précédemment évoqué. L’article distingue en effet les cas selon qu’est
identifié un vice de forme ou de procédure ou un autre type de vice. En cas
d’illégalité pour vice de forme ou de procédure (article L. 600-9, 2°),
l’illégalité n’est régularisable que si elle a eu lieu « après le débat sur les orientations du
projet d’aménagement et de développement durables ». Pour les vices
qui ne sont ni de forme ni de procédure (article L. 600-9, 1°), les SCOT
et les PLU ne peuvent être régularisés que par une modification respectant la
procédure imposée par le code de l’urbanisme à cette fin ; dans ce second
cas, il ne s’agit que d’une limite procédurale aux possibilités de
régularisation.
La distinction entre ces deux catégories de vices a aussi une incidence sur la date à laquelle l’administration doit se placer pour connaître les règles applicables à la régularisation. L’arrêt Commune de Sempy (CE, Sect., 22 décembre 2017, n° 395963, Rec. point 6) indique que, pour les vices de forme ou de procédure, l’administration doit appliquer les dispositions en vigueur à la date à laquelle elle a pris sa décision ; en cas de vice de fond au contraire, l’administration doit faire application des règles en vigueur au moment de la régularisation. « Il existe en effet une différence significative entre les deux : la régularisation d’un vice de forme se traduit par la réparation de l’acte ; la régularisation d’une illégalité de fond prend la forme d’une réédition de celui-ci. Dans le premier cas, s’appliquent les règles existantes à la date d’édiction de l’acte. Dans le second devraient s’appliquer les règles existantes au jour où la réfection intervient » (O. Le Bot, « Chronique de contentieux administratif. Décisions d’octobre à décembre 2017 », JCP A 2018, n° 18-19).
Le Conseil d’État a enfin précisé que la légalité de l’acte de régularisation doit être contestée dans le cadre de la même instance et que les parties ne sont « pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte » (CE, 29 juin 2018, Commune de Sempy, n° 395963, Rec. point 4). Il ajoute que les parties peuvent, pour contester l’acte de régularisation, « invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation » (point 4). Cette formulation rejoint la solution dégagée, à propos de l’article L. 600-5-1, par l’arrêt Association NARTECS, avec ces différences néanmoins que la jurisprudence Commune de Sempy exclut explicitement les moyens nouveaux et ne dit rien du caractère régularisable ou non du vice détecté dans le document initial.
C) La
régularisation a priori à l’initiative
de l’administration
Hors ces
hypothèses textuelles, le juge a aussi admis que l’administration puisse
régulariser spontanément l’acte administratif vicié durant l’instance.
En premier lieu, de manière générale et somme toute classique, l’administration peut spontanément régulariser l’acte qui fait l’objet du recours, durant l’instance et avant même que le juge se prononce. De même qu’un litige relatif au refus de l’administration de délivrer un agrément s’éteint si l’administration délivre finalement l’agrément au requérant, la régularisation de l’acte, à la supposer complète, met un terme à l’instance. La régularisation coupe en quelque sorte l’herbe sous le pied du requérant, puisque la régularisation anticipée par l’administration prive le recours de son objet. Un permis modificatif peut ainsi régulariser en cours d’instance le permis initial entaché d’un vice de procédure ou de fond (CE, 9 décembre 1994, SARL Seri, n° 116447, T. ; CE, 7 mars 2018, Commune de Wissembourg, n° 404079, Rec. point 8), à condition toutefois que ce permis modificatif soit sans influence sur la conception générale du projet initial et ne constitue pas en réalité un nouveau permis de construire. « Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises » (CE, 30 mars 2015, Société Eole-Res, n° 369431, T. point 3). En application de la jurisprudence SCI La Fontaine de Villiers (CE, 2 février 2004, n° 238315, T.), les illégalités régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Et si la régularisation intervient après l’ordonnance de clôture de l’instruction, l’acte de régularisation permet de rouvrir l’instruction (CE, 28 avril 2017, Commune de Bayonne, n° 395867, T. point 3).
Deuxièmement, la régularisation spontanée faite par l’administration peut, pour les autorisations d’urbanisme, intervenir dans le cadre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : le Conseil d’État a admis que l’administration peut régulariser le permis spontanément, sans y avoir été préalablement invitée par le juge (CE, 22 février 2018, SAS Udicité, n° 389518, T.). Si l’administration transmet au juge des éléments visant à la régularisation du vice, le juge n’est pas « tenu de surseoir à statuer » : il peut directement prendre acte de la régularisation effectuée, « dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettent une régularisation » ; en revanche, si les éléments transmis sont insuffisants pour regarder le vice comme régularisé, le juge peut « surseoir à statuer en vue d’obtenir l’ensemble des éléments permettant la régularisation » (point 16). Laisser ainsi l’administration prendre l’initiative est a priori peu conforme au texte, qui réserve l’initiative au juge ; on voit par là que le juge favorise autant que possible la régularisation des autorisations d’urbanisme, en reconnaissant cette faculté à l’administration. Et ce d’autant plus que, dans l’arrêt SAS Udicité, l’initiative de l’administration intervenait en appel, alors que le juge de première instance avait annulé le permis initial, ce qui paraît en contradiction avec la position du Conseil d’État selon laquelle un permis modificatif ne saurait faire revivre un permis annulé (CE, 29 décembre 1997, SCI Résidence Isabella, n° 104903, inédit).
Enfin, la régularisation spontanément effectuée par l’administration peut intervenir dans le cadre de l’article L. 600-9. Là aussi, l’administration peut proposer au juge des éléments de régularisation des vices de forme ou de procédure qui affectent un SCOT, un PLU ou une carte communale. Et, là encore, le juge est dispensé de prononcer un jugement avant-dire-droit et il pourra recueillir les observations des parties avant le jugement définitif ou le prononcé du non-lieu à statuer. C’est ce qu’a permis l’arrêt Commune de Sempy (CE, Sect., 22 décembre 2017, n° 395963, Rec. point 5). Il semble que cette possibilité ne soit pas en correspondance avec la lettre de l’article L. 600-9. Mais, selon le professeur Le Bot, « la mise à l’écart de la première phase (à savoir la discussion sur le principe même du recours à cet article) est parfaitement justifiée : en effet, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer pour permettre une régularisation qui, selon les écritures de l’administration, a d’ores et déjà été réalisée » (O. Le Bot, « Chronique de contentieux administratif. Décisions d’octobre à décembre 2017 », JCP A 2018, n° 18-19). Dans ce cas, le juge peut apprécier librement la pertinence de la régularisation opérée et, éventuellement, considérer que les éléments fournis ne suffisent pas à opérer la régularisation nécessaire ; il peut alors revenir au principe initial, c’est-à-dire « surseoir à statuer en vue d’obtenir l’ensemble des éléments permettant la régularisation» (point 5). Sur ce point, les jurisprudences interprétant les articles L. 600-5-1 et L. 600-9 se recoupent.
La possibilité
offerte à l’administration de régulariser spontanément l’autorisation
d’urbanisme ou le document d’urbanisme illégal favorise indéniablement les
possibilités de régularisation. Mais celle-ci est également accrue par la
possibilité – étroite – d’opérer une régularisation a posteriori.
II) La
régularisation a posteriori
La
régularisation a posteriori ou
« post-juridictionnelle » (R.
Thiele, « Annulations partielles et annulations conditionnelles », AJDA 2015, p. 1364) intervient
après une censure juridictionnelle, totale ou partielle, d’un acte
administratif entaché d’une ou plusieurs irrégularités. En régularisant l’acte
vicié, l’administration neutralise en quelque sorte la censure juridictionnelle
et l’anéantissement de son acte, en remédiant aux irrégularités qui ont
justifié la censure. Cette régularisation est donc très particulière puisque,
en principe, un acte censuré par le juge est banni totalement ou partiellement
de l’ordre juridique et ne peut plus faire l’objet d’une modification par
l’administration. La régularisation a
posteriori n’est donc possible que si elle a été expressément autorisée par
le juge. Aussi la régularisation a
posteriori ne peut-elle « exister
que parce que la décision du juge administratif, plutôt que d’annuler purement
et simplement l’acte en raison des irrégularités relevées, admet que
l’administration puisse procéder à sa régularisation : on dira alors que
l’annulation prononcée par le juge est conditionnelle, car elle ne prendra
effet que si l’administration n’opère pas les modifications prescrites par le
juge. L’annulation conditionnelle consiste, pour le juge, à prononcer
l’annulation, totale ou partielle, d’un acte ou la résiliation d’un contrat,
sous réserve de régularisation par l’administration » (H. Bouillon,
« La régularisation d’un acte administratif après annulation
conditionnelle : une technique en gestation », AJDA 2018, p. 142). La sécurité juridique est donc préservée
en dépit de l’intervention de la décision juridictionnelle, car l’acte va être
réparé.
En droit de l’urbanisme, cette technique a été introduite à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme par l’article 11 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (dite ENL). L’article L. 600-5 dispose : « Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ». Relatif aux autorisations d’urbanisme (comme l’article L. 600-5-1), ce mécanisme associe donc deux techniques : une annulation partielle (A) et une annulation conditionnelle (B). Il faudra également dire un mot des pouvoirs détenus ici par le juge (C).
A) Un
mécanisme induisant une annulation partielle
L’article L. 600-5 du code de l’urbanisme induit tout d’abord une censure partielle de l’acte : l’article permet en effet à la juridiction administrative (c’est une faculté) de limiter l’annulation d’une autorisation d’urbanisme à la partie du projet affectée par l’illégalité relevée, après avoir vérifié qu’aucun moyen ne justifiait une annulation totale (CE, 16 octobre 2017, SARL Promialp, n° 398902, T. point 2). Une annulation partielle peut être prononcée à l’endroit de tout acte administratif, y compris des actes relevant du droit de l’urbanisme. Mais l’annulation partielle permise par l’article L. 600-5 diffère des annulations partielles classiques de par les conditions particulières qui sont les siennes. Relatif à un permis de construire, l’arrêt Époux Fritot (CE, 1er mars 2013, n° 350306, Rec.) prend bien soin de distinguer les deux hypothèses d’annulation partielle et d’en mentionner les critères.
Selon la
jurisprudence Époux Fritot et en
conformité avec la lettre de l’article L. 600-5 (par opposition aux
annulations partielles classiques),
le juge peut « procéder à
l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une
illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est
susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité
compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit
divisible du reste de ce projet » (point 6). Pour que l’article
L. 600-5 soit mis en œuvre, l’illégalité décelée doit remplir une double
condition : elle doit affecter une partie identifiable du projet
d’autorisation et, d’autre part, elle doit pouvoir être couverte par
l’intervention d’un nouvel acte – de régularisation – adopté par
l’autorité compétente.
La première condition est que l’illégalité soit restreinte à une partie identifiable du projet d’autorisation, c’est-à-dire d’une partie divisible du reste du projet. Cette condition paraissait être une restriction à l’utilisation de cet article, puisqu’elle semblait induire que toute illégalité affectant l’ensemble de l’acte (indivisible) empêche l’application de cet article et ne puisse conduire qu’à l’annulation totale de l’acte sans possibilité de le régulariser. Pourtant, le juge a admis que l’article L. 600-5 concerne tant les vices de fond que les vices de forme et de procédure : l’incompétence elle-même ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions (CE, 27 novembre 2013, Association Bois-Guillaume Réflexion, n° 358765, T. point 5), alors même que ce vice est par définition attaché à l’intégralité de l’acte et n’est pas limité à une part de l’autorisation d’urbanisme, comme l’impose pourtant l’article L. 600-5 et la jurisprudence Fritot. Contrairement aux annulations partielles classiques, la divisibilité n’est donc plus une condition nécessaire. En réalité, « le Conseil d’État a remplacé la condition légale de la première phrase selon laquelle ‘‘seule une partie d’un projet de construction’’ doit être illégale par celle de ‘‘seule une irrégularité non substantielle même non localisée’’ peut donner prise à une résection partielle » (J.-M. Staub, « Le permis de construire confronté à la normativité du SCOT et à une annulation partielle. Note sous CAA Lyon, 8 novembre 2011, Société investissements internationaux et participations », LPA 2012, n° 114, p. 14).
La seconde
condition dévoile toutes les particularités de l’annulation partielle prévue
par l’article L. 600-5. En principe, une annulation partielle classique n’est envisageable que pour
les dispositions d’un acte administratif qui, divisibles du reste de l’acte,
peuvent en être retranchées sans porter atteinte à la viabilité de l’acte
subsistant (H. Bouillon, « Pour une subjectivisation de l’annulation
partielle des actes administratifs unilatéraux », AJDA 2017, p. 217). Or l’application de l’article L. 600-5
n’est possible – et c’est sa seconde condition – que si l’illégalité
entachant le permis est régularisable par un permis modificatif. Il en résulte
que le juge peut délaisser la question de la divisibilité des dispositions
viciées (comme l’indique l’interprétation jurisprudentielle de la première
condition), puisque la régularisation permettra de toute façon de combler les
lacunes créées dans l’acte par l’ablation de certaines de ses dispositions.
« Cette disposition peut trouver à
s’appliquer alors même que l’autorisation contestée serait indivisible »
(E. Vital-Durand, « Régularisation
du permis de construire en cours d’instance : le Conseil d’État étend
opportunément le recours au permis modificatif », JCP A 2017, n° 42).
Une telle
spécificité rejaillit nécessairement sur la question de la légalité et permet
de cerner une autre spécificité de l’annulation partielle permise par l’article
L. 600-5. En principe, l’annulation partielle classique n’est possible que si la partie de l’acte qui demeurera
applicable est légale : le juge doit donc s’inquiéter de la légalité de
l’acte, une fois que celui-ci aura été délesté des dispositions viciées.
Normalement, une annulation partielle ne peut donc être prononcée que si la
partie de l’acte qui subsiste est légale. Or, dans le cadre de l’article
L. 600-5, le juge n’a pas à se préoccuper de cette question de la légalité
future de l’acte partiellement laissé en vie, car l’acte ainsi survivant, qu’il
soit alors illégal ou non, devra être régularisé par son auteur. Ce sera donc à
l’autorité administrative de se soucier de sa légalité au stade de la
régularisation, et non au juge de l’intégrer à sa réflexion au stade de la
censure juridictionnelle.
L’effet majeur
de cette technique est donc que le juge n’hésite plus à prononcer des
annulations partielles, sachant que la partie de l’acte qui subsistera sera
viable grâce à la régularisation. La sécurité juridique est ainsi mieux
assurée. L’inconvénient est toutefois de sacrifier le strict respect de la
légalité, puisque son analyse se voit repoussée à une phase ultérieure de la
procédure et que son respect est laissé aux bons soins de l’administration qui
régularisera le permis. Toutefois, la légalité, si elle n’est pas immédiatement
garantie, est au moins préservée par le fait que « l’annulation de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme interdit
toute exécution du permis jusqu’à ce que celui-ci ait été régularisé. Il s’agit
donc d’une annulation sous réserve de non-régularisation » (R. Thiele,
« Annulations partielles et annulations conditionnelles », AJDA 2015, n° 24, p. 1362).
Cette spécificité assure que le reliquat de l’acte amputé, illégal ou non, ne
sera pas appliqué en l’état. Cette annulation sous réserve de non-régularisation est précisément ce que l’on
appelle une annulation conditionnelle. Telle est la seconde technique présente
au sein de l’article L. 600-5.
B) Un
mécanisme induisant une annulation conditionnelle
L’article
L. 600-5 retient encore l’attention par la seconde technique qu’il
enferme. Sa mise en œuvre est en effet conditionnée par le fait que
l’illégalité relevée soit régularisable, après l’instance, par la délivrance
d’un permis modificatif. L’annulation est alors dite conditionnelle, car elle
n’interviendra que si l’administration ne régularise pas l’illégalité ;
elle est conditionnée à l’absence de régularisation. Et tant que la
régularisation n’est pas faite, l’application de l’acte est suspendue.
Sont ici intimement liées les annulations partielles et conditionnelles : il y a « annulation partielle à caractère conditionnel » (J.-M. Staub, « L’annulation partielle du permis de construire », Dr. Adm. 2014, n° 2, comm. 16). En effet, le juge administration a lié les deux aspects de l’article, puisque la faculté de prononcer une annulation partielle d’un permis de construire est reconnue au juge si et seulement si l’illégalité qu’il contient peut être corrigée par l’obtention d’un permis modificatif (CE, 23 février 2011, SNC Hôtel de la Bretonnerie, n° 325179, T.). Nous avons indiqué que c’était là la seconde condition posée par la jurisprudence Fritot.
La délivrance de ce permis modificatif doit répondre à des conditions très proches de celles établies dans le cadre de l’article L. 600-5-1, puisque la jurisprudence SCI Rivera Beauvert précitée (CE, 30 décembre 2015, n° 375276, inédit) s’applique aux deux articles. En principe, un permis modificatif ne peut être délivré qu’à deux conditions, déjà citées :
D’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne doivent pas être achevés, car l’achèvement des travaux rend caduc le permis de construire initial (qui n’a plus d’objet), de telle sorte que sa régularisation est impossible. La partie intéressée n’a pas à démontrer que la construction n’est pas achevée et le juge n’est pas tenu de procéder à une mesure d’instruction en ce sens (CE, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n° 374338, Rec. ; CE, 30 décembre 2015, SCI Rivera Beauvert, n° 375276, inédit). Nous avons indiqué que cette condition a été supprimée pour l’article L. 600-5-1, dans le cadre de la régularisation a priori. Elle ne perdure que pour la régularisation a posteriori. Si la différence de traitement s’explique mal, la solution toujours applicable pour la régularisation a posteriori semble plus conforme à la logique juridique, dans la mesure où l’achèvement des opérations de travaux fait perdre son objet à l’autorisation d’urbanisme et que sa régularisation paraît anachronique (nous en avons dit les motifs). On peut se demander si cette différence va perdurer ou si le juge va supprimer aussi cette condition pour l’article L. 600-5.
D’autre part,
les modifications apportées au projet initial pour remédier à l’illégalité ne
doivent pas, en raison de leur nature ou de leur ampleur, remettre en cause sa
conception générale. Si le permis modificatif affectait l’économie générale du
permis initial, il constituerait lui-même un nouveau permis. « Si l’économie générale du projet est
atteinte, seule une annulation totale, et par voie de conséquence le dépôt d’un
nouveau permis, se conçoivent » (J.-M. Staub, « L’annulation partielle du permis de
construire », Dr. Adm. 2014, n° 2, comm.
16). Mais, comme nous l’avons indiqué, le Conseil d’État retient une
conception souple de la notion de conception
générale de la construction projetée, ce qui accroît les possibilités de
régularisation.
C) Les
pouvoirs du juge dans le cadre de l’article L. 600-5 du code de
l’urbanisme
Relativement aux pouvoirs du juge, l’article L. 600-5, et particulièrement son alinéa 2, ne lui confère par lui-même aucun pouvoir d’exécution (CAA Lyon, 8 novembre 2011, Société investissements internationaux et participations, n° 10LY01628). En outre, pour statuer, le juge n’est pas tenu de solliciter l’avis des parties pour savoir s’il peut ou non procéder à une annulation partielle et si l’illégalité pourra être régularisée par la suite, contrairement à ce qui est nécessaire pour les moyens soulevés d’office (CE, 4 octobre 2013, Andrieu et Perrée, n° 358401, T. point 10) : dans le cadre de l’article L. 600-5, « le juge administratif, compte tenu de son expérience de la vie administrative, est parfaitement à même de mesurer seul si l’illégalité décelée, qui est d’ailleurs connue des requérants et sur laquelle ils ont pu échanger leurs points de vue, est susceptible d’être corrigée ensuite par l’autorité administrative » (J.-M. Staub, « L’annulation partielle du permis de construire », Dr. Adm. 2014, n° 2, comm. 16).
Une fois que le juge a prononcé l’annulation partielle à caractère conditionnel, l’article L. 600-5 précise que « l’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ». C’est au bénéficiaire du permis d’en demander la régularisation à l’administration, mais celle-ci est tenue de délivrer le permis modificatif demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle : elle est en situation de compétence liée. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée (CE, 1er mars 2013, Fritot, n° 350306, Rec.).
Un tel mécanisme, on le voit, sauvegarde la sécurité juridique de l’opération envisagée en garantissant la pérennité de l’autorisation d’urbanisme qui, sans ce mécanisme, serait remise en cause par la détection d’illégalités par le juge. Rappelons que l’article L. 600-6 du code de l’urbanisme dispose que « lorsque la juridiction administrative, saisie d’un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l’État dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction ». L’article L. 600-5 constitue donc une échappatoire possible à cette conséquence radicale qu’est la démolition de la construction réalisée. L’inconvénient, comme nous y avons insisté, est bien sûr que la légalité n’est qu’artificiellement respectée, par une régularisation qui n’est jamais équivalente au plein respect de la légalité ab initio.
Conclusion
Il est certain
que, en droit de l’urbanisme, la recherche d’une régularisation des actes
administratifs fait la part belle à la sécurité juridique, à tel point que l’on
a pu redouter une « absolution
automatique » (F. Bouyssou, « La sécurisation des autorisations
d’urbanisme. Du territoire contentieux à l’absolution automatique », AJDA 2006, p. 1268) des
irrégularités commises par l’administration.
Un tel constat peut être mis en perspective avec d’autres dispositifs juridiques qui cherchent à préserver les permis de construire de toute remise en cause. Il en est ainsi de la définition donnée de l’intérêt à agir par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit qu’une personne ne peut demander l’annulation de l’autorisation d’urbanisme « que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe ». Or l’arrêt Brodel (CE, 10 juin 2015, n° 386121, Rec.) a interprété cette disposition comme imposant au requérant « de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien », même si le voisin immédiat possède en principe un intérêt à agir (CE, 13 avril 2016, Bartolomei, n° 389798, Rec.). La restriction de l’intérêt à agir ainsi opérée, en limitant le risque contentieux, est un facteur indéniable de la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme.
Néanmoins, on peut s’inquiéter de cette prévalence de la sécurité juridique au détriment de la légalité. M. Benjamin Hachem s’est fait l’écho de ces préoccupations : « Depuis déjà plusieurs années, on constate ce qu’il faut bien appeler une dérive visant à museler les contestations à l’encontre des autorisations d’urbanisme. Ce phénomène est d’autant plus inquiétant que les différents gouvernements, mais également les différents groupes de travail, généralement présidés par un conseiller d’État, donnent de la résonance à ce mouvement de fond instigué par les professionnels de l’immobilier. (…) Pour ces derniers la lutte contre les recours en matière d’urbanisme, notamment dirigés contre les permis de construire autorisant la création de logements collectifs, constitue une grande cause nationale au motif que ces recours seraient le principal frein à la production de logements neufs en France » (B. Hachem, « Lettre ouverte à ceux qui souhaitent (encore) restreindre le droit au recours en matière d’urbanisme », JCP A 2018, n° 24).
Il s’opère ainsi
un mouvement qui dépasse assez largement le seul droit de l’urbanisme : la
prévalence d’une conception instrumentale du droit, mis au service d’intérêts
divers, notamment économiques, au détriment des exigences du principe de
légalité et de l’intérêt général que sert ce principe. « La conception classique du droit de
l’urbanisme était en effet la prééminence de la règle, sur laquelle devaient
s’aligner les projets individuels, sous peine d’illégalité. Or, de plus en
plus, le projet préexiste, de manière collective ou individuelle : la
règle est écrite pour permettre la réalisation de ce projet, ou la révision
simplifiée est ordonnée en vue de permettre un projet déterminé » (F.
Bouyssou, « La sécurisation des autorisations d’urbanisme. Du territoire
contentieux à l’absolution automatique », AJDA 2006, p. 1268). Il est bien évident que le droit ne doit
pas être un frein au développement urbanistique et qu’il doit au contraire
sécuriser les opérations immobilières. Il faut toutefois éviter l’écueil
inverse, qui subordonnerait le maintien des règles juridiques à la réalisation
de différents projets et placerait ainsi le droit dans une situation
d’instabilité qui, outre l’atteinte qu’elle porterait au paradigme du principe
de légalité, serait in fine néfaste à
la sécurité juridique elle-même.
Il s’opère ainsi un mouvement qui dépasse assez largement le seul droit de l’urbanisme : la prévalence d’une conception instrumentale du droit, mis au service d’intérêts divers, notamment économiques, au détriment des exigences du principe de légalité et de l’intérêt général que sert ce principe. « La conception classique du droit de l’urbanisme était en effet la prééminence de la règle, sur laquelle devaient s’aligner les projets individuels, sous peine d’illégalité. Or, de plus en plus, le projet préexiste, de manière collective ou individuelle : la règle est écrite pour permettre la réalisation de ce projet, ou la révision simplifiée est ordonnée en vue de permettre un projet déterminé » (F. Bouyssou, « La sécurisation des autorisations d’urbanisme. Du territoire contentieux à l’absolution automatique », AJDA 2006, p. 1268). Il est bien évident que le droit ne doit pas être un frein au développement urbanistique et qu’il doit au contraire sécuriser les opérations immobilières. Il faut toutefois éviter l’écueil inverse, qui subordonnerait le maintien des règles juridiques à la réalisation de différents projets et placerait ainsi le droit dans une situation d’instabilité qui, outre l’atteinte qu’elle porterait au paradigme du principe de légalité, serait in fine néfaste à la sécurité juridique elle-même.
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2019, Dossier 06 : « La régularisation en droit public » (dir. Sourzat & Friedrich) ; Art. 241