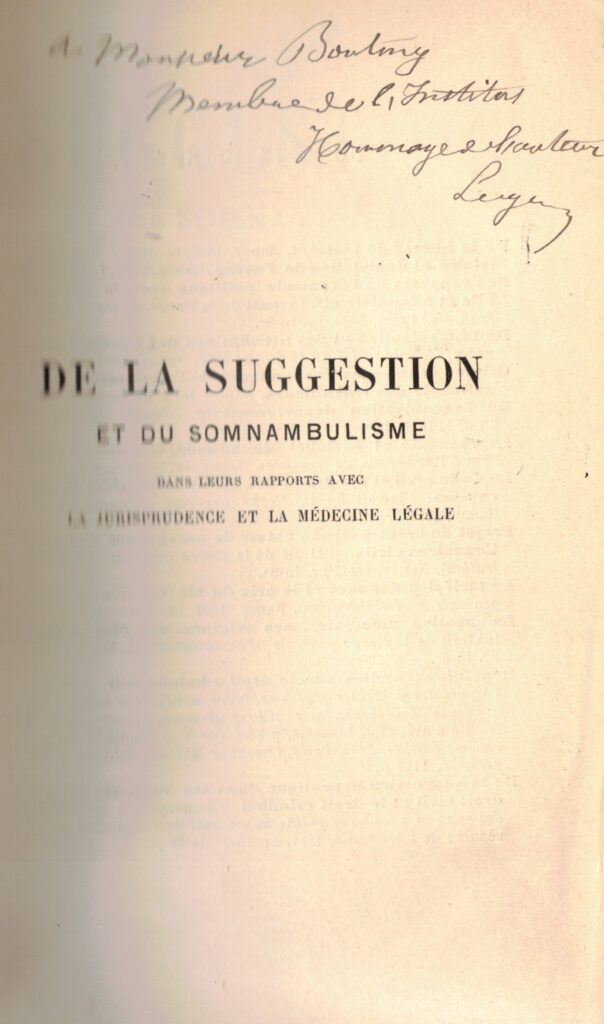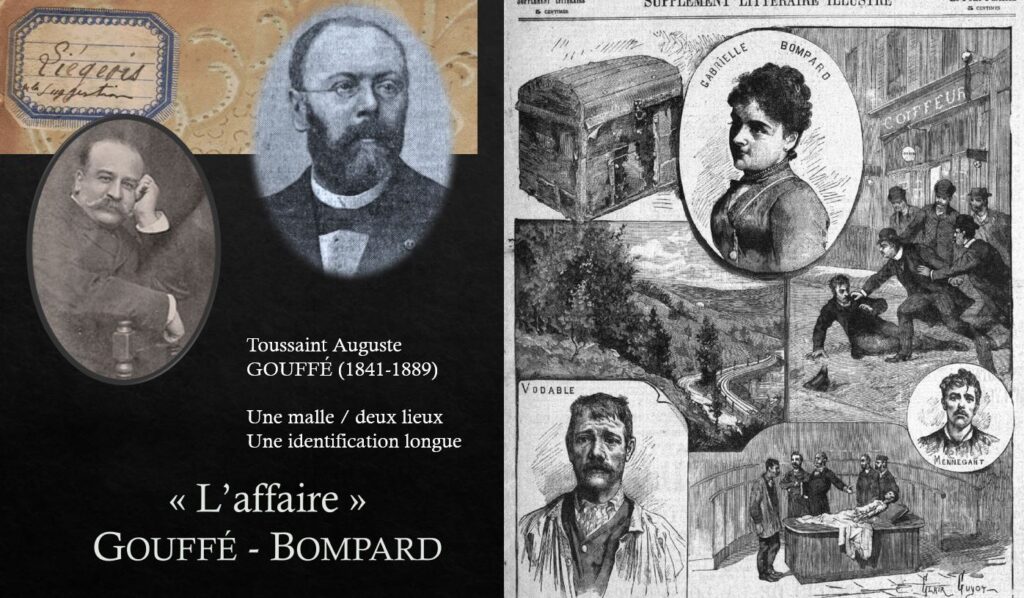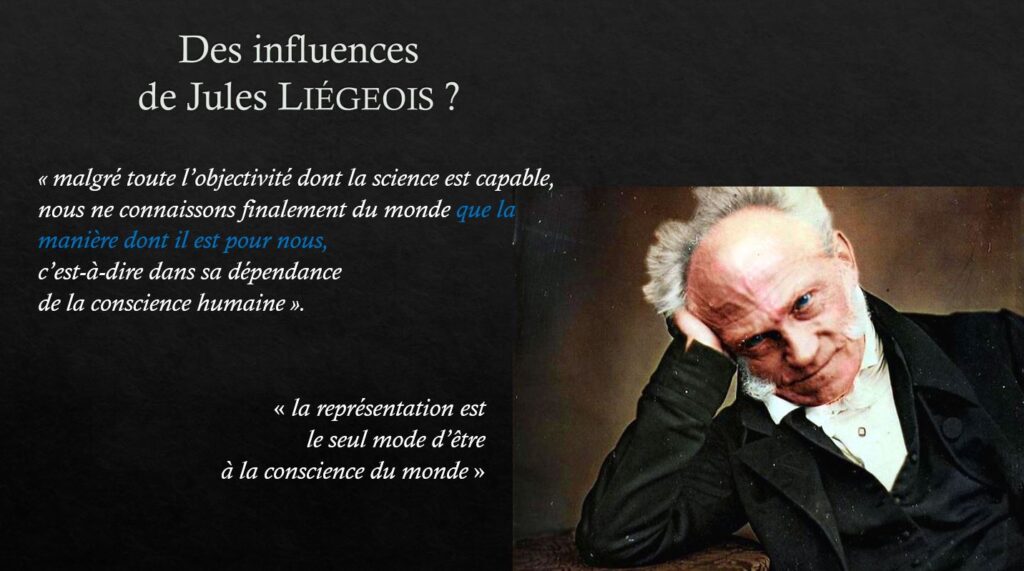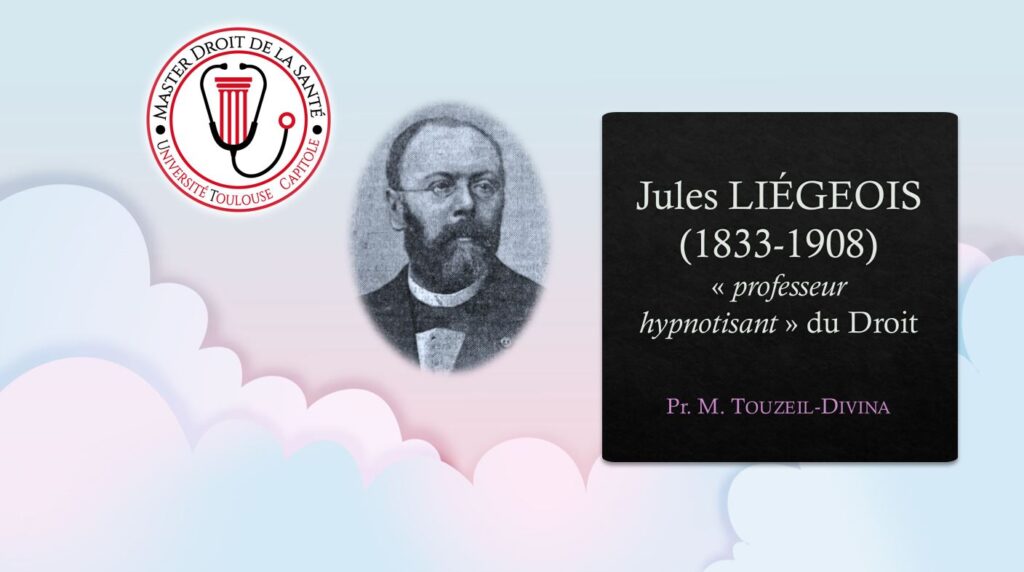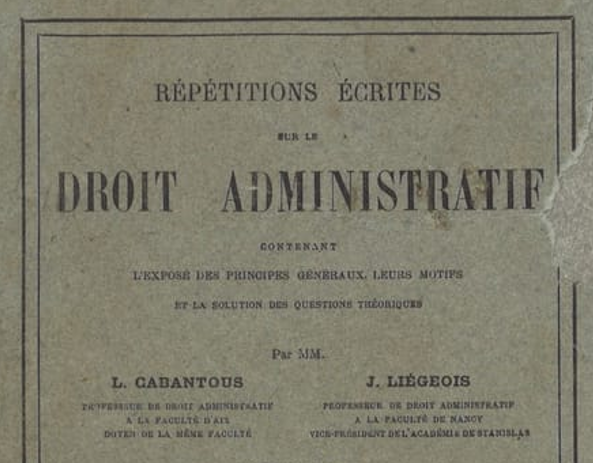Art. 418.
Le présent article rédigé par M. Théo Fautrat, étudiant en Master 1 droit de la santé, Université Toulouse Capitole s’inscrit dans le cadre de la 8e chronique en Droit(s) de la santé (janvier 2024) du Master Droit de la Santé (Université Toulouse Capitole) avec le soutien du Journal du Droit Administratif.
L’auteur remercie pour ses conseils et relectures Mme Alizée FAYOT, doctorante en droit privé et sciences criminelles, école doctorale de droit et de science politique, Pierre Couvrat, équipe de recherche en droit privé EA1230, Université de Poitiers.
Le débat sur le du suicide médicalement assisté est comme un océan tumultueux dans lequel des vagues émotionnelles se heurtent, chacune apportant une perspective et une sensibilité distinctes face à cet acte délicat qui questionne notre éthique et nos valeurs fondamentales. Il nous confronte aux fondements mêmes des interdits sociaux et moraux, ce qui en fait un sujet d’ampleur qui touche tous les domaines de la société : médicales, juridiques, philosophiques ou encore religieux. Un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène en France et qui a fait une entrée remarquée le 22 avril 2002 en Europe, à la suite d’un arrêt rendu par la Cour Européenne des droits de l’homme[1]. En 2023, plus de 800 000 soignants ont publié un avis éthique et pratique sur les conséquences d’une telle législation. Ils affirment que ces pratiques ne peuvent en aucune manière relever du soin et alertent le législateur sur les menaces que ferait peser cette nouvelle pratique sur des personnes vulnérables.[2]
Mais que recouvre en réalité la notion de Suicide Médicalement Assisté (ci-après SMA), fréquemment confondu avec l’euthanasie. Il consiste à fournir, à la suite de la demande d’un patient, une substance létale que celui-ci s’injectera[3] et qui nécessite que la personne soit capable et consciente. A contrario, l’euthanasie se rapporte au fait qu’un médecin administre une substance létale afin de soulager les souffrances d’un patient en fin de vie.
La première difficulté est que la société, marquée par une influence significative de la chrétienté, considère le suicide comme un acte condamnable. La personne est coupable de crime envers Dieu selon le cinquième commandement qui énonce que : « la vie est un don sacré de Dieu, dont Dieu est seul à pouvoir disposer ». C’est pourquoi, aucune justification du suicide ne saura être tolérée puisque cela témoignerait d’un « attentat envers Dieu » selon Saint Thomas d’Aquin, qui est seul propriétaire de notre vie[4]. C’est grâce à la Révolution française que cette rupture avec l’église s’est instaurée, puisque dès 1789 avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), mais aussi la loi du 18 août 1792 supprimant les congrégations séculières, de premiers pas ont été franchis dans l’acceptation du suicide.
L’article 5 de la DDHC dispose que “La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société”[5]. Or, celui qui souhaite en finir avec la vie ne lui cause directement aucun tort et ne doit donc plus être mis à l’écart. C’est dans ce sens qu’en 1810, Napoléon décide de décriminaliser le suicide dans le code civil.
Depuis, nos sociétés occidentales n’ont eu de cesse de s’interroger sur le fait de savoir si, comme l’énonçait Albert Camus en 1965, “la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue”[6]et si la dépénalisation du suicide n’ouvre pas la voie à un « droit au suicide ». Ce questionnement est encore aujourd’hui sujet à de nombreuses controverses plus ou moins virulentes.
L’intérêt pour le SMA se manifeste juridiquement en France par diverses tentatives de légalisation. Le 7 avril 2021, le député français, Olivier Falorni, porte une nouvelle proposition de loi devant l’Assemblée nationale dans le but de disposer d’une assistance médicalisée active pour mourir. Cette dernière sera contrecarrée dès son émergence par trois mille amendements, puis finalement rejetée.
Dès lors, de nombreux mouvements juridiques et religieux se manifesteront contre l’idée même d’une quelconque légalisation. Pour beaucoup, le suicide reste un acte blasphématoire, qui ne peut être valider par la loi. De plus, en février 2024, la ministre déléguée aux Professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo, prévoit de présenter le projet de loi sur « le modèle français de la fin de vie ». Cette initiative fait suite à la requête d’Emmanuel Macron visant à élaborer ce projet avant la fin de l’été 2023. Toutefois, une extension du calendrier a été nécessaire afin d’approfondir la stratégie des soins d’accompagnement.[7].
Au vu de cette conjecture, en quoi l’instauration d’une législation assurant l’accès à un suicide médicalement assisté peut-être perçu comme une progression de nos libertés fondamentales ?
Bien sûr, vaincre les réticences pour qu’il soit légaliser ne se fera pas sans parcourir un chemin semé d’embûches. Mais on peut toutefois espérer car les changements sociétaux sont tels, que ces difficultés pourraient être aisément surmontées. Il suffirait d’invoquer explicitement, dans le cadre de la défense des libertés fondamentales, les droits au respect de la dignité de la personne humaine. Cela fait l’objet de nombreux textes juridiques internes, régionaux et internationaux qui les dotent d’un caractère jus cogens (I), comme en atteste l’évolution progressive des lois qui tendent à aller dans ce sens et qui ne cesse de démontrer que le droit positif poursuit son élan (II).
I. Un obstacle surmontable à l’interdiction du suicide médicalement assisté
Selon un sondage émanant de l’Institut Français d’Opinion Public (IFOP)[8] du 8 avril 2021, quatre-vingt-neuf pour cent des Français seraient favorables à la légalisation du suicide médicalement assisté en France, pour les personnes souffrant de maladies incurables ou insupportables, tel que : la sclérose en plaque, le cancer des poumons, etc. Au vu de ces chiffres, se pose alors la question des motifs faisant barrage à l‘entrée en vigueur dudit droit (A). Nonobstant ces écueils, la société française témoigne ainsi d‘une avancée considérable dans la quête d’une construction de la légitimité d‘une fin de vie digne (B).
A. L’approbation d’un droit au suicide médicalement assisté : des entraves considérables.
En 1707, un édit royal, acte législatif émanant du roi[9], dispose que toute personne diplômée devra lors de sa soutenance de thèse en médecine se soumettre au serment d’Hippocrate[10]. Cet engagement épouse la forme d’une promesse proclamée de manière solennelle. Par cette déclaration, le médecin s’engage à respecter les devoirs gouvernant sa fonction. Différentes règles sont alors énoncées, telles que le fait de ne pas provoquer la mort d’un patient délibérément[11], mais aussi l’obligation du secret médicale[12]. Toute la complexité de l’exercice réside à trouver le bon équilibre entre deux règles majeures : assurer une fin de vie, tout en préservant la dignité de l’intéressé. Le personnel de santé doit ainsi trouver les moyens nécessaires pour répondre de la manière la plus adéquate possible à cette question. Déontologiquement, le suicide médicalement assisté, ne peut trouver sa place sans remettre en cause l’une des lois fondamentales de ce serment. Celui-ci ayant une valeur purement éthique, il instaure tout de même des principes tel que le respect de la vie, la confidentialité, l’intégrité professionnelle. C’est sur ces grands principes, que des règles déontologique et le code de conduite professionnelle pour les médecin ont été établis. Dès lors, il sera nécessaire de le moderniser afin de répondre à une demande croissante d’une forte majorité de la population.
Confrontés à ces problématiques, s’adjoint une difficulté supplémentaire, celle de l’évaluation de la maladie. Quel spécialiste de la santé peut, avec certitude, se prononcer sur une durée exacte de fin de vie. Parfois, les certitudes sont confrontées à des réalités extraordinaires. Quel médecin n’a pas un jour été confronté à une guérison dite « spontanée » ou « miraculeuse » ?
Ainsi, le 18 novembre 2021, en Argentine, la communauté scientifique a déclaré qu’une personne séropositive avait guéri du sida sans avoir suivi aucun traitement[13].
Le patient alors atteint d’une maladie dont tous les médecins estimaient la guérison impossible, s’est rétabli définitivement. Le corps humain est doté d’un système immunitaire hors du commun qui confirme que nul ne peut prophétiser une fin de vie. Dès lors, autoriser et justifier un SMA comporte certains risques face au syllogisme exposé ci-dessus.
Dans la perspective d’une éventuelle légalisation, cet argument « d’être proche de la mort » ne peut être considérer comme une justification puisque des « guérisons miraculeuses » ou « spontanées » existent et montrent que rien ne peut être réellement définitif en ce domaine. Elles invitent à ne pas considérer pour acquis les pathologies des malades et à rechercher un cadre légitime dans lequel le SMA pourra voir le jour.
D’un point de vue culturel, la société française, basée sur des valeurs judéo-chrétiennes, voit d’un regard réprobateur les différentes formes de suicide. Le cinquième commandement[14] proscrit toute forme de suicide chez le croyant. Il considère que se suicider va à l’encontre de l’amour de soi et donc de l’amour de Dieu.[15]
Le Donum Vitae, publié en 1987 par la Congrégation pour la doctrine de la foi dirigée par le Cardinal Ratzinger (futur pape Benoit XVI), renvoi au respect de la vie humaine. Il dispose qu’elle doit être respectée et protégée de manière absolue de la « conception jusqu’à la mort »[16]. D’un point de vue strictement judéo-chrétien, le SMA est considéré comme une infraction à l’interdit public, car nul n’a le droit de prendre la vie d’un autre, seul Dieu peut créer ou mettre fin à la vie.[17] Le droit pénal vient appuyer ses propos en précisant que le « fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre » (Article 221-1 du code pénal). Dans la tradition biblique, transgresser cet interdit revient de fait à rompre la relation de l’homme avec l’omnipotence de Dieu : l’Homme se substituant à son créateur.
Légalement, l’assistance au suicide est prohibée par le code pénal. L’article 223-13 le réprime d’une peine d’emprisonnement et du versement d’une amende[18]. Dans l’éventualité d’une dépénalisation du suicide médicalement assisté, cette loi devra faire l’objet d’une profonde révision. Certains auteurs tels que Ruwen Ogien[19] estiment que la pénalisation du suicide médicalement assisté n’est pas licite[20]. Ce philosophe allègue que l’humanisme se place au-dessus des dogmes et des principes religieux. L’être humain est en mesure de choisir le moment de sa mort puisqu’il ne nuit à personne d’autre que lui. Ruwen Ogien développe de facto un nouveau courant de pensée. Celui de l’éthique minimal dont le but est de respecter le principe de « non-nuisance ». Ce dernier se fonde sur l’idée qu’on ne peut « contraindre un individu que pour une seule raison, l’empêcher de causer du tort à autrui ». Si ce n’est pas le cas, nul ne peut interférer sur sa décision[21].
Pour finir, avant 2005, la France autorisait l’acharnement thérapeutique. (Article L1110-5 alinéa 4 du Code de Santé Publique, ci-après CSP). Issu de la loi[22] du 5 mars 2002, Il précisait que le médecin devait tout mettre en œuvre pour prolonger la vie de son patient dans la dignité.
De nombreux problèmes se sont alors posés et plus particulièrement dans les services de réanimation où les moyens mis en œuvre pour sauver des vies sont parfois très invasifs. A titre d’exemple, dans les mois suivant un séjour en réanimation, entre 14 et 41% des patients sont atteints d’un État de Stress Post Traumatique (ci-après ESPT) et entre 10 et 30 % ont des symptômes de dépression. Le problème lié à ces pathologies est également lié au défaut de prise en charge préventive et curative lié à ces symptômes[23]. La question primordiale est d‘identifier avec exactitude le moment où l’acharnement thérapeutique peut avoir lieu. En 2005, la loi Léonetti a intégré un alinéa à l’article L1111-11 du CSP[24] permettant opportunément au patient de se prononcer sur l’issue de son état de santé au moyen d’un outil spécifique : les directives anticipées. C’est un document dans lequel le patient écrit ses dernières volontés sur les soins qui lui seront apportés en fin de vie. Cette loi représente un véritable pas en avant pour l’effectivité du droit à l’autodétermination.[25]
Depuis ce premier élan en faveur d’un choix délibérément humaniste et non plus soumis à une contrainte dogmatique, la question des directives anticipées, qu’a apporté la loi Léonetti a permis de donner un premier coup de boutoir à l’interdiction du suicide médicalement assisté.
Toutefois, une brèche non négligeable persiste qui consiste en l’absence formelle de définition précise du droit à la vie en droit français. Ce vide juridique permet potentiellement de revêtir la forme d’un fondement en faveur de l’instauration française du suicide médicalement assisté. Mais il suppose un profond remaniement du droit pénal, du serment d’Hippocrate et du Code de Santé Publique.
Malgré les freins constatés, le droit de disposer de son corps fait l’objet de nombreuses évolutions, que ce soit d’un point de vue religieux, juridique ou même philosophique. C’est en 2005 qu’une véritable progression va avoir lieu dans le droit de disposer de son corps grâce au combat mené par un député français du nom de Jean Léonetti.
B. L’élargissement d’un droit de disposer du corps humain, des difficultés surmontables.
Au début du XXe siècle, le pape Pie XII vantait l’utilité des soins palliatifs. Il estimait que lorsqu’un patient arrivait en fin de vie et que plus aucun soin curatif n’était possible, ils étaient nécessaires de trouver un moyen d’atténuer les souffrances. Les traitements mis en place permettant de réduire les douleurs physiques et psychologiques (comme l’injection de morphine). Le 25 mars 1995, dans l’Evangelium Vitae, lettre encyclique écrite par Jean Paul II dans laquelle est réitéré le souhait de Pie XII, il est écrit : « est licite de supprimer la douleur au moyen de narcotiques, même avec pour effet d’amoindrir la conscience et d’abréger la vie s’il n’existe pas d’autres moyens, et si, dans les circonstances données, cela n’empêche pas l’accomplissement d’autres devoirs religieux et moraux ».[26]Jean Paul II confirme ainsi la position de l’église sur la question du traitement de la fin de vie.
Cette déclaration montre clairement un nouveau cheminement de pensée. Le courant juridique partisan du suicide médicalement assisté rejoint celui de la philosophie et de la religion. Il faut désormais privilégier une fin de vie digne en administrant des médicaments au patient afin de soulager ses douleurs, plutôt que de privilégier un acharnement thérapeutique. C’est l’ébauche de l’acception d’une euthanasie passive que le député Jean Leonetti reprendra quelques années plus tard.
Très fortement impliqué sur les questions d’éthique médicale, Jean Leonetti et Alain Claeys établissent un premier rapport concernant les besoins des professionnels de santé et de la population sur la question du traitement de la fin de vie[27]. Ce compte rendu a permis d’établir le 22 avril 2005 des lois concernant “les droits des malades et de la fin de vie”[28]. Parmi ces lois, se trouve l’article L1111-4[29] du CSP qui autorise le droit à une euthanasie passive. Ce privilège appelé ”directives anticipés” confère au patient le choix sur les interventions du corps médical à poursuivre ou non le maintien en vie du patient en fonction des décisions que le malade aura lui-même fourni au médecin. Elles permettent de faciliter le recours à l’euthanasie passive, puisque les dispositions formelles de rédaction desdites directives sont particulièrement aisées à faire : il suffit de les rédiger par écrit, les dater, les signer et les transmettre à son médecin généraliste ou auprès du corps médical avant une intervention. Et il est bien sûr possible de les modifier à tout moment.
Ainsi, si l’état de santé d’un patient se trouve fortement dégradé et nécessite une intervention lourde, les médecins ne peuvent plus aller à l’encontre de sa volonté si celui-ci ne souhaite pas entrer dans un processus thérapeutique[30].
Le 24 septembre 2000 alors que ces directives n’existaient pas encore, une affaire très fortement médiatisée a présenté des difficultés similaires et a permis de faire naître ce projet de loi. Cette affaire appelée « Vincent Humbert », du nom du patient impliqué, témoigne d’un jeune homme de 22 ans devenu tétraplégique, muet et presque aveugle à la suite d’un accident de voiture.
Il avait réclamé “le droit de mourir” au président de la république en novembre 2002, qui le lui avait refusé. Le 24 septembre 2003 la mère de Vincent Humbert accompagnée de son médecin, décidaient de lui injecter une dose massive de barbituriques, qui le plongeait dans le coma. À la suite de cela, un non-lieu avait été conclu en 2006[31]. A l’époque, les directives anticipés n’existaient pas et des conflits déontologiques étaient apparus. Les médecins devaient-ils laisser le patient souffrir ou lui accorder le droit de mourir. Les directives, auraient pu permettre au médecin de suivre la volonté de son patient si elles avaient existé, et c’est grâce à cette affaire que la loi Léonetti a pu voir le jour.
La légalisation française du SMA encore à l’état de droit prospectif, aurait un retentissement mondial considérable et obligerait l’Organisation Mondiale de la Santé (ci-contre OMS) à revoir sa définition de référence de la santé au sein de sa Constitution du 7 avril 1948. Elle y est définie comme un « état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »[32] et a permis de revisiter le droit positif français à la suite d’affaires européennes tel que l’arrêt Pretty.[33]
Dans cette arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a accordé un droit à l’autodétermination. Il s’agissait de savoir si le droit à la vie pouvait plus généralement signifier, le droit d’avoir une vie décente, et par extension, de pouvoir choisir sa mort.
Grâce à la décision judiciaire qui a été rendu, la cour européenne des droits de l’homme a reconnu, pour la première fois, un droit à l’autodétermination à la vie et admis, que l’interdiction du suicide assisté par le droit pénal d’un État pouvait être une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des personnes concernées.[34]
La France en tant que pays signataire dudit texte, devrait adopter les mesures positives s’y référent tel que l’arrêt de l’acharnement thérapeutique en milieu hospitalier.
La légalisation relative au SMA permettrait donc aux patients en grande souffrance de mettre un terme à ses douleurs et donc de facto à sa pathologie incurable. Enfin, la santé mentale du patient, très souvent oubliée au profit de la dimension physique de la santé, se doit d’être remise au centre des soins afin de trouver un équilibre entre les deux et de mettre en adéquation la France avec ses obligations internationales[35]. En effet, elle ne peut être oublié. C’est un aspect fondamental que nul ne peut négliger, surtout lorsqu’un patient décide de demander un SMA où aucun retour en arrière n’est possible. Pour ce faire, il faudrait organiser des rendez-vous avec au moins deux psychologues, deux avis différents et neutres, pour déterminer l’état mental de la personne qui le demande.
Le SMA est encore un sujet controversé en France, a contrario, certains pays européens tendent à le légaliser. C’est pourquoi, l’impact de l’Union Européenne (UE) pourra dès lors être un élément essentiel dans la légalisation de ce droit en France grâce au principe de primauté du droit européen. Enfin, de nouvelles libertés individuelles commencent à voir le jour dans nos sociétés, en lien direct avec un droit à l’autodétermination tel que l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) ou encore la Procréation Médicalement Assistée (PMA).
II. Un contexte propice à la légalisation française du suicide médicalement assisté
L’union européenne ayant un droit de primauté sur le droit national, a de facto une incidence sur la législation française (A). Certaines de nos libertés individuelles actuelles, telles que l’Interruption Volontaire de Grossesse (ci-joint IVG), ou la Procréations Médicalement Assistées (ci-contre PMA) ont permis de changer des lois en les légalisant. Au vu de toutes ces avancés, un droit au suicide médicalement assisté pourrait potentiellement voir le jour (B).
A. L’impact considérable du droit européen sur la législation française
En tant que membre de l’Union européenne, la France est soumise à un système juridique complexe, rappelant la théorie de Hans Kelsen sur la hiérarchie des normes.
Dans son livre de 1934, « The Pure Theory of Law », Kelsen présente une organisation pyramidale de règles juridiques qui permet de résoudre d’éventuels conflits de normes en déterminant la supériorité relative des normes.[36] Au sommet de la pyramide, le bloc de constitutionnalité, composé de l’ensemble des normes juridiques à valeur constitutionnelle[37] suivi du bloc de conventionnalité qui se rapporte aux lois et traités internationaux et pour finir le bloc de légalité se référant aux lois et ordonnances de l’état.
Dans l’arrêt Costa c. Enel du 15 juillet 1964, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a retenu un principe de primauté du droit de l’union européenne[38]. Ce principe a pour but de faire prévaloir le droit de l’UE par rapport aux droits nationaux des États membres. Ces derniers ne peuvent manifester leur désaccord, sauf si un État décide de ne pas ratifier le texte litigieux ou pose une réserve relative au texte[39]. L’UE travaille donc à harmoniser les lois des pays y adhérant, afin de permettre aux citoyens européens de suivre des règles communes. Le fait de devoir s’adapter aux lois de chaque pays européen tend à disparaître et permet également d’atténuer les voix des courants nationalistes ou religieux rigides en la matière.
En France, le Conseil constitutionnel par sa décision du 27 juillet 2006[40] a disposé qu’une loi de transposition ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti[41]. Cela signifie donc que si la norme européenne porte atteinte à la Constitution, le système français est en droit de la rejeter. Mais en matière de SMA, rien dans la constitution ne l’interdit et ce principe de primauté pourrait permettre son entrée en vigueur.
Un second arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme[42], a estimé qu’une Nation devait protéger les personnes vulnérables en évitant de rendre le recours à la mort trop systématique. Les juges ont également disposé que les lois nationales pouvaient rendre illégale la pratique du suicide médicalement assisté.[43]
Depuis cet arrêt, une évolution législative a eu lieu dans plusieurs pays européens. En Belgique, la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, réglemente cette pratique médicale. La personne demandeuse doit faire état de souffrances physiques ou psychiques constantes et insupportables, qui ne peuvent être apaisées et résultent d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable[44]. En France le droit à l‘euthanasie est toujours interdit. Néanmoins, en acceptant les valeurs de l’Europe, la France pourrait aller vers une acception du SMA par effet d’entraînement, poursuivant le mouvement amorcé par ses voisins.
D’autres pays ont déjà suivi le chemin belge. L’Italie a voté en 2017 une loi[45] légitimant le droit au suicide médicalement assisté. Celle-ci a été adoptée à la suite des dispositions de l’article 2[46] et 32[47] de la Constitution italienne qui permettent au patient de refuser d’être maintenu en vie artificiellement et qui pourrait être source d’inspiration pour le droit français. En s’appuyant sur l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1976 qui garantit un droit à la santé pour tous, notre pays pourrait s’engouffrer dans la brèche. Pour cela, il est nécessaire de définir clairement les termes de « vie » et de « mort ».
Ainsi, l’article 580[48] de la loi n°219 du code pénal italien précise qu’elle ne peut être appliquée que sous certaines conditions. Le patient doit tout d’abord formuler une intention de suicide de façon libre et autonome, et cela implique également que sa pathologie cause des souffrances physiques ou psychologiques intolérables. Ce trait, parce que subjectif, est un argument qui pourrait être une « arme » brandie en défaveur du SMA.
Pour finir, le malade doit être en mesure de prendre des décisions libres et conscientes.[49] Le patient peut ainsi demander une aide au suicide malgré l’interdiction édictée par l’article 580 du code pénal.
Quelques années après la promulgation de cette loi, le Portugal à la suite d’un décret parlementaire[50], réglemente à son tour les conditions de la mort médicalement assistée en modifiant son Code pénal, et ce malgré la forte opposition de la Conférence Épiscopale Portugaise (ci-joint CEP) qui avait tenté de l’empêcher.
Au niveau européen, les pays commencent donc à accepter l’idée d’une aide active à la fin de vie et c’est probablement grâce à eux, en tant que membres de l’Union Européenne, qu’ils pourront exercer une influence dans l’acceptation de ce nouveau droit, appuyé par le principe de primauté.
La France, en tant qu’État membre, pourrait ainsi à son tour adopter un texte allant dans ce sens, et pourquoi pas l’Union européenne elle-même, pourrait se voir dotée d’une loi applicable par tous les états. Bien que cette option s’avère complexe, il semble que l’on puisse raisonnablement penser qu’elle puisse être intégrer au droit européen mais aussi international grâce aux droits internes.
Les nouvelles lois en lien avec le développement des libertés fondamentales, tel que la procréation médicalement assistée ou encore l’interruption volontaire de grossesse permettent de poursuivre le mouvement de progression opéré.
B. L’élargissement d’une libertés individuelles, une possibilité accrue d’adoption d’un droit au suicide médicalement assisté français.
Le 16 décembre 1966, à New York, un pacte international relatif au droit civils et politiques a été adopté par l’assemblée générale des Nations unies. Ce pacte a pour but de protéger les particuliers contre les ingérences de l’état en établissant des lois, tel que celles permettant de préserver la vie prévue par l’article 6.[51]
Le droit à la vie n’a pas de définition commune dans tous les pays. En France, elle se réfère à l’ensemble des disposition légales qui concourent à garantir le respect de la vie humaine sans plus de précision. L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que tout individu a droit à la vie[52]. De plus, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi[53]. Enfin, l’article 16 du code civil dispose que la loi assure la primauté de la personne, interdit tout atteinte à la dignité de celle-ci et garantie le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Cet article est l’un des fondements de la définition du droit à la vie.
En France, une avancée progressive des libertés individuelles a été constatée avec l’instauration du droit à l’avortement ou de la loi sur la procréation médicalement assistée. Le droit à l’avortement est entré en vigueur en 1975 grâce à la loi Veil du 17 janvier[54]. Quant au droit à la PMA, c‘est grâce à la loi du 2 août 2021 qu’elle a vu le jour.[55]. Ces règles ont permis de mettre en avant l’autodétermination des individus. Les êtres humains sont désormais maître de leur destin ce qui n’était pas concevable au début des années 1990. Aujourd’hui, une nette évolution a eu lieu. Tout homme est maître de son existence et peut choisir de créer ou d’interrompre sa vie.
À la suite de cela, de nombreuses controverses sont apparues. C’est ainsi qu’en ce qui concerne le droit à l’avortement, l’article 6 va en deçà de l’IVG qui consiste à retirer la vie du fœtus. Pour remédier à ce problème, le droit français considère que le fœtus n’a pas de personnalité juridique et ne peut bénéficier des droits mentionnés dans les Chartes, dont le droit à la vie[56]
Il n’empêche que ce pacte a permis d’avancer considérablement vers un droit au suicide médicalement assisté.
Contrairement à l’avortement où la fin de vie portait sur l’embryon, le SMA pose la question de l’appartenance de son propre corps. Il s’agit de déterminer si nous sommes libres de choisir pour nous-même notre propre fin. Et dans le cas où le patient choisirait d’en finir dignement, selon sa volonté, il pourrait alors s’administrer lui-même la dose létale. Contrairement à l’euthanasie qui implique un tiers, le SMA donne au patient la maîtrise de son destin et renforce ainsi nos libertés individuelles.
Tout reste bien sûr à faire en France, mais au vu de l’évolution suivie par les pays voisins, tout reste possible. Nous pouvons envisager que prochainement une nouvelle proposition de loi favorisant les libertés fondamentales soit mise en avant, tout comme le souhaitaient certains candidats aux dernières présidentielles, lorsque l’association pour le droit à mourir dans la dignité a demandé aux différents partis politiques de se positionner sur le sujet, quitte à organiser un référendum citoyens.
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Fautrat Théo, « Le SMA : la quête de la justification éthique »
in Journal du Droit Administratif (JDA), 2024 ; Art. 418.
[1] Wikipedia contributors. (2021b, janvier 28). Affaire Pretty contre Royaume-Uni. Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Pretty_contre_Royaume-Uni
[2] Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 13 février, du 20 février et du 27 février 2023 – Karima Haroun, rédactrice spécialisée, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives – 16 mars 2023, Dalloz Actualité.
[3] Cédric Daubin. (2019, 8 février). Euthanasie et suicide médicalement assisté : un débat au-delà de celui de l’accompagnement de la fin de vie | La base Lextenso. labase-lextenso, N°029. https://www.labaselextenso.fr/petites-affiches/LPA138j8
[4] Deutéronome 32 : 39 « Sachez donc que c’est moi qui suis Dieu, et qu’il n’y a point de Dieu près de moi ; je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » (s. d.). https://saintebible.com/deuteronomy/32-39.html
[5] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. (1789, août 26). Legifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527431/
« La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas »
[6] Camus, A. (1985). Le Mythe De Sisyphe Essai Sur Labsurde (Collection Folio / Essais) (French Edition) (GALLIMARD éd.). Gallimard. pp17- 18
[7] Liberation, & Afp. (2023, 8 décembre). Le projet de loi « fin de vie » sera présenté « courant février » . Libération. https://www.liberation.fr/societe/sante/le-projet-de-loi-fin-de-vie-sera-presente-courant-fevrier-annonce-agnes-firmin-le-bodo-20231208_LRMREKIF2ZAEVCOSESPFIDXKEE/
[8] Regard des Français sur la fin de vie. (2021, 8 avril). IFOP. https://www.ifop.com/publication/le-regard-des-francais-sur-la-fin-de-vie-2/
[9] Édit de Marly portant Règlement pour l’étude et l’exercice de la médecine registré en Parlement le 18 mars 1707. (s. d.). Gallica. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86022352/f10.item
[10] Larousse, Ã. (s. d.-b). Serment d’Hippocrate – LAROUSSE. Larousse. https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Serment_dHippocrate/143995#:%7E:text=Ensemble%20des%20r%C3%A8gles%20morales%20de%20l%27art%20de%20gu%C3%A9rir%2C,l%27%C3%A9dit%20royal%20de%201707%2C%20qui%20est%20toujours%20appliqu%C3%A9.
[11]Serment d’Hippocrate | Conseil départemental du Val de Marne de l’Ordre des médecins. (s. d.). https://conseil94.ordre.medecin.fr/content/serment-dhypocrate-1
“Je ne remettrai à personne du poison, si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une pareille suggestion”
[12] Serment d’Hippocrate | Conseil départemental du Val de Marne de l’Ordre des médecins. (s. d.). https://conseil94.ordre.medecin.fr/content/serment-dhypocrate-1
”Quoi que je voie ou entende dans la société pendant, ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas”
[13] R. (2021, 17 novembre). Sida : une patiente argentine guérie « naturellement » sans traitement. RFI. https://www.rfi.fr/fr/science/20211117-sida-une-patiente-argentine-gu%c3%a9rie-naturellement-sans-traitement
[14]Godet, F. (s. d.). Exode 20 – Commentaire biblique du verset 13 Bible annotée. Levangile.com. https://www.levangile.com/Bible-Annotee-Exode-20-Note-13.htm
« Tu ne tueras point »
[15] Luc. (s. d.). Luc 10 : 27 « Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même. » | La Sainte Bible par Louis Segond 1910 (LSG) | https://www.bible.com/fr/bible/93/LUK.10.27.LSG
[16] Joseph Card. Ratzinger, & Alberto Bovone. (1987, 22 février). Instruction sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation. Réponses à quelques questions d’actualité. Vatican.Va.https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_fr.html
[17] Bernhard Meuser. (2020, 10 juillet). Le suicide est-il autorisé du point de vue de la Bible ? | YOUCAT. Youcat. https://www.youcat.org/fr/credopedia/suicide/
L’Église catholique le considère comme une contradiction fondamentale des lois de Dieu, qui est le seul Seigneur sur la vie et la mort.
[18] En vertu de l’article 223–13 qui dispose que “Le fait de provoquer le suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.”
[19] Né le 24 décembre 1949 puis mort le 4 mai 2017 Ruwen Ogien était un philosophe libertaire français
[20] Ogien, Ruwen. « La vie, la mort, l’État », Martine Gross éd., Sacrées familles ! Changements familiaux, changements religieux. Érès, 2011, pp. 251-262.
“Le suicide assisté sous ses différentes formes, la gestation pour autrui, l’aide médicale à la procréation pour les gays et les lesbiennes et les femmes jugées « trop âgées », et même le clonage reproductif ne visent nullement à causer des torts à quiconque. Ce sont, par conséquent, des « crimes sans victimes » qu’il est injuste de pénaliser.”
[21] Ogien, Ruwen. Penser la pornographie. Presses Universitaires de France, 2008
[22] Article L1110-5 РCode de la sant̩ publique РL̩gifrance. (2002, 5 mars). Legifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006685747/2002-03-05/
“Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sans préjudice de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort.”
[23] Pochard, F., Kentish-Barnes, N., & Azoulay, E. (2007, 1 octobre). Évaluation des conséquences psychologiques d’un séjour en réanimation. Elsevier. https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2015/11/0710-Reanimation-Vol16-N6-p533_537.pdf#:~:text=Le%20contexte%20de%20stress%20v%C3%A9cu%20lors%20du%20s%C3%A9jour,sur%20la%20vie%20relationnelle%2C%20affective%20et%20sociale%20despatients.
[24] Article L1111-11. (2020, 1 octobre). Legifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721077
“Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative
[25] S-M., F. (2018). Le droit à l’autodétermination de la personne humaine (French Edition). IRJS.
“le pouvoir de choisir, entre plusieurs options, celle qui correspond à ses aspirations personnelles”
[26] II, J. P. (1995, 25 mars). Evangelium vitae (25 mars 1995) | Jean Paul II. Vatican.Va. §79 https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
“qu’Est licite de supprimer la douleur au moyen de narcotiques, même avec pour effet d’amoindrir la conscience et d’abréger la vie pousuivant que s’il n’existe pas d’autres moyens, et si, dans les circonstances données, cela n’empêche pas l’accomplissement d’autres devoirs religieux et moraux”
[27] Vie publique.fr. (2021, 4 octobre). Rapport de présentation et texte de la proposition de loi de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. https://www.vie-publique.fr/rapport/34495-rapport-de-presentation-et-texte-de-la-proposition-de-loi-de-mm-alain-c
[28] LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (1) – LégiFrance. (s. d.). https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000001291462
[29] Arrêt d’acharnement thérapeutique. (2002, 5 mars). Legifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006685766/
”Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.”
[30] Marchesini, Silvane Maria. « Le suicide assisté : la nouvelle « peine de mort » induite par la société contemporaine ? Une analyse à la frontière entre droit et psychanalyse », Études sur la mort, vol. 141, no. 1, 2012, pp. 37.
“Elle ouvre un espace pour une analyse concrète de l’arrêt de « l’acharnement thérapeutique » à travers la consultation de « directives anticipées » éventuellement formulées par le malade, en maintenant la limite que constitue « l’homicide », sans décriminaliser ou dépénaliser l’euthanasie à travers le suicide assisté consenti.”
[31]Affaire Vincent Humbert. (2015, 8 mars). Dans Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Vincent_Humbert
[32] Santé mentale : renforcer notre action. (2018, 30 mars). Organisation Mondial de la Santé. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
Le préambule de la constitution de l’OMS dispose que “La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité”
[33] Affaire Pretty c. Royaume-Uni / Suicide assisté – Institut Européen de Bioéthique. (2019, 16 janvier). Institut Européen de Bioéthique. https://www.ieb-eib.org/fr/justice/fin-de-vie/euthanasie-et-suicide-assiste/affaire-pretty-c-royaume-uni-suicide-assiste-66.html
“Mme Pretty, qui est paralysée et souffre d’une maladie dégénérative incurable, alléguait dans sa requête que le refus par le Director of Public Prosecutions d’accorder une immunité de poursuites à son mari s’il l’aidait à se suicider et la prohibition de l’aide au suicide édictée par le droit britannique enfreignaient à son égard les droits garantis par les articles 2 portant sur le droit à la vie, 3 ayant pour thème l’interdiction à la torture, 8 sur le respect de la vie privée et familiale, 9 énonçant la liberté de pensée, de conscience et de religion et l’article 14 sur l’interdiction à la discrimination de la Convention européenne des droits de l’homme dans le Titre 1 Droits et libertés.”
[34] E. (2022, 3 mars). Droits de L’Homme : Cours Magistral PDF. eBoik.com. https://eboik.com/droits-de-homme/#ib-toc-anchor-0
[35] Méthode de l’interview, Alizée Fayot.
[36] PROTIERE Guillaume, CHAMBARDON Nicolas, MALBLANC Matthias et al., « Fiche 9. La hiérarchie des normes », dans : , Les indispensables du droit constitutionnel. sous la direction de PROTIèRE Guillaume, CHAMBARDON Nicolas, MALBLANC Matthias et al. Paris, Ellipses, « Plein Droit », 2016, p. 57-62. URL : https://www.cairn.info/les-indispensables-du-droit-constitutionnel–9782340013148-page-57.html
[37] Qu’est-ce que le bloc de constitutionnalité ? (2020, 28 juillet). Vie-publique. https://www.vie-publique.fr/fiches/275483-quest-ce-que-le-bloc-de-constitutionnalite
[38] Arrêt de la Cour de justice, Costa/ENEL, affaire 6–64 (15 juillet 1964). (1964, juillet). CVCE. https://www.cvce.eu/obj/arret_de_la_cour_de_justice_costa_enel_affaire_6_64_15_juillet_1964-fr-cb4154a0-23c6-4eb5-8b7e-7518e8a2a995.html
[39] Primauté du droit de l’Union européenne – Fiches d’orientation – juin 2020 | Dalloz. (2020, juin). Dalloz. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F001065#_
Le principe de primauté signifie que le droit de l’Union prévaut sur les droits nationaux des États membres. Il bénéficie à toutes les normes de droit européen disposant d’une force obligatoire et s’exerce à l’égard de toutes les normes nationales.
[40] Décision n° 2006–540 DC du 27 juillet 2006. (2006, 27 juillet). Conseil constitutionnel. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006540DC.htm
[41]Décision n° 2006–540 DC du 27 juillet 2006. (s. d.). Conseil constitutionnel. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006540DC.htm
Considérant, en premier lieu, que la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti
[42] Cour européenne des droits de l’homme 29 avril 2002 n° 2346-02 affaire Pretty
[43] Wikipedia contributors. (2021, 28 janvier). Affaire Pretty contre Royaume-Uni. wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Pretty_contre_Royaume-Uni#:%7E:text=L%27%20arr%C3%AAt%20Diane%20Pretty%20contre%20Royaume-Uni%20du%2029,l%27%20euthanasie%20ayant%20eu%20un%20retentissement%20international%20
Considérant, en premier lieu, que la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti
[44] C. (2021, 1 juin). Euthanasie, suicide assisté, la législation en Belgique. Confiance en soin. https://confiance-en-soin.com/euthanasie-ou-suicide-assiste-en-belgique/
[45] Loi n° 219 du 22 décembre 2017
[46] Art. 2 costituzione. (s. d.). Brocardi.it. https://www.brocardi.it/costituzione/principi-fondamentali/art2.html
La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme [4, 13 et suiv.], tant en tant qu’individu que dans les formations sociales où sa personnalité a lieu [18, 19, 20, 29, 39, 45, 49 ; c.c. 14 ff., 2247 et suiv.], et exige l’accomplissement des devoirs obligatoires de solidarité politique, économique et sociale [4, 23 , 41-44, 52-54; vers .c. 834-839, 1175, 1176, 1900 3]
[47]Art. 32 costituzione. (s. d.). Brocardi.it. https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-ii/art32.html
La République protège la santé en tant que droit fondamental de l’individu [38 2] et l’intérêt de la communauté, et garantit la gratuité des soins aux plus démunis.
Personne ne peut être astraint à un certain traitement de santé sauf par la loi. En aucun cas, la loi ne peut violer les limites imposées par le respect de la personne humaine
[48] Art. 580 codice penale – Istigazione o aiuto al suicidio. (s. d.). Brocardi.it. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art580.html
« Toute personne qui incite d’autres personnes à se suicider ou renforce l’intention d’autrui de se suicider, ou facilite leur exécution de quelque manière que ce soit, est puni, en cas de suicide, d’une peine d’emprisonnement de cinq à douze ans. Si le suicide ne se produit pas, il est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans, à condition que la tentative de suicide entraîne des blessures graves ou très graves. »
[49] Giuridica, R. (2019, 29 septembre). REDAZIONE GIURIDICA. Brocardi.it. https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/consulta-apre-strada-suicidio-assistito/2036.html
[50] Décret parlementaire n° 199/XIV du 5 novembre 2021
[51] Wikipedia contributors. (2022b, février 16). Pacte international relatif aux droits civils et politiques. wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_international_relatif_aux_droits_civils_et_politiques
Article 6 : droit à la vie et sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide à la privation de la vie.
[52] Déclaration des Droits de l‘Homme et du Citoyen de 1789 (1789). Légifrance.Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
[53] E. (s. d.). European Convention on Human Rights – Official texts, Convention and Protocols. European Court of Human Rights. https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=
[54] Loi n°75-17 relative à l’interruption volontaire de grossesse (1975, 17 janvier) Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
[55] Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (2021, 2 août) LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
[56] Conditions d’accès, d’utilisation et mise en garde | Vos droits en santé. (s. d.). vosdroitsensante. http://www.vosdroitsensante.com/1499/le-statut-juridique-du-foetus#:%7E:text=Avant%20toute%20chose%2C%20signalons%20qu%27aujourd%27hui%2C%20il%20est%20bien,s%C3%Bbret%C3%A9%20et%20%C3%A0%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20de%20sa%20personne.
SOURCES :
Bibliographie :
Livres :
Camus, A. (1985). Le Mythe De Sisyphe Essai Sur Labsurde (Collection Folio / Essais) (French Edition) (GALLIMARD éd.). Gallimard. pp17- 18
Godet, F. (s. d.). Exode 20 – Commentaire biblique du verset 13 Bible annotée.
Luc. (s. d.). Luc 10 : 27 Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même. | La Sainte Bible par Louis Segond 1910 (LSG)
Ogien, Ruwen. « La vie, la mort, l’État », Martine Gross éd., Sacrées familles ! Changements familiaux, changements religieux. Érès, 2011, pp. 251-262.
Ogien, Ruwen. Penser la pornographie. Presses Universitaires de France, 2008
Articles :
Cédric Daubin. (2019, 8 février). Euthanasie et suicide médicalement assisté : un débat au-delà de celui de l’accompagnement de la fin de vie
Revues :
Gallopin, Christian. « Un suicide n’est jamais accompagné », VST – Vie sociale et traitements, vol. 98, no. 2, 2008, pp. 94-99.
Marchesini, Silvane Maria. « Le suicide assisté : la nouvelle « peine de mort » induite par la société contemporaine ? Une analyse à la frontière entre droit et psychanalyse », Études sur la mort, vol. 141, no. 1, 2012, pp. 37-53.
Journal de presse :
Morel, S. (2021, 30 janvier). Au Portugal, le Parlement légalise l’euthanasie. Le monde
Méthode de l’interview :
Alizée Fayot doctorante en droit de la santé
Sitographie :
Légifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000446240/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006071194
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006685747/2002-03-05/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721077
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006685766/
LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000001291462
Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_concile_de_Braga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Vincent_Humbert
Affaire Pretty contre Royaume-Uni — Wikipédia (wikipedia.org)
Pacte international relatif aux droits civils et politiques — Wikipédia (wikipedia.org)
Larousse :
Définitions : serment – Dictionnaire de français Larousse
Brocardi :
Art. 2 costituzione – Brocardi.it
Art. 32 costituzione – Brocardi.it
Art. 580 codice penale – Istigazione o aiuto al suicidio – Brocardi.it
La Consulta apre la strada al suicidio assistito – Diritto penale – Notizie Giuridiche – Brocardi.it
Autres :
https://conseil94.ordre.medecin.fr/content/serment-dhypocrate-1
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86022352/f10.item
https://saintebible.com/deuteronomy/32-39.html
Europe : Quels sont les pays qui autorisent le suicide assisté ? (soin-palliatif.org)
Le regard des Français sur la fin de vie – IFOP
https://www.conseilnational.medecin.fr/medecin/devoirs-droits/serment-dhippocrate
https://www.bible.com/fr/bible/93/LUK.10.27.LSG
Evangelium vitae (25 mars 1995) | Jean Paul II (vatican.va)
doi:10.1016/j.reaurg.2007.09.011 (srlf.org)
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
Affaire Pretty c. Royaume-Uni / Suicide assisté – Institut Européen de Bioéthique (ieb-eib.org)
https://eboik.com/droits-de-homme/#ib-toc-anchor-0
https://www.cairn.info/les-indispensables-du-droit-constitutionnel–9782340013148-page-57.html
Arrêt de la Cour de justice, Costa/ENEL, affaire 6-64 (15 juillet 1964) – CVCE Website
Primauté du droit de l’Union européenne – Fiches d’orientation – juin 2020 | Dalloz
Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr)
Euthanasie, suicide assisté, la législation en Belgique ~ Confiance en soin (confiance-en-soin.com)
Art. 2 costituzione – Brocardi.it
Art. 32 costituzione – Brocardi.it
Art. 580 codice penale – Istigazione o aiuto al suicidio – Brocardi.it
La Consulta apre la strada al suicidio assistito – Diritto penale – Notizie Giuridiche – Brocardi.it
Primauté du droit de l’Union européenne – Fiches d’orientation – juin 2020 | Dalloz
Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr)
Euthanasie, suicide assisté, la législation en Belgique ~ Confiance en soin (confiance-en-soin.com)
European Convention on Human Rights – Official texts, Convention and Protocols (coe.int)
Conditions d’accès, d’utilisation et mise en garde | Vos droits en santé (vosdroitsensante.com)
https://www.vie-publique.fr/fiches/275483-quest-ce-que-le-bloc-de-constitutionnalite